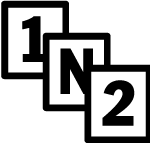- Espagne
- Décès de Quini
Quini, la première disparition

Attaquant légendaire du Barça et de Gijón, huitième meilleur buteur de l'histoire de la Liga et cinq fois pichichi, Quini s'est éteint mardi à 68 ans des suites d'une crise cardiaque. Au printemps 1981, au sortir d’un match gagné au Camp Nou contre Hercules, Enrique Castro, dit "Quini", est enlevé par trois inconnus, embarqué dans le coffre d’une voiture et déposé dans une cave humide. Dont il ne ressortira que vingt-cinq jours plus tard. Récit d’une traque, sur fond de flics en santiags, d’écoutes téléphoniques à l’ancienne, de remises de rançon foireuses et de... Julio Iglesias.
Une voiture file à travers la nuit sur l’autoroute reliant Barcelone au poste frontière de La Jonquera, qui délimite l’Espagne et la France. Pleins phares sur la ligne blanche, en cinquième sur la file de gauche. Les deux mains sur le volant, Alexanko conduit un œil sur la route, l’autre dans le rétroviseur, afin de s’assurer que la valise qui trône sur la banquette arrière est toujours en place. À quelques heures d’un match capital contre Salamanque, le défenseur central du Barça s’offre une nuit blanche. Aucune des cent millions de petites coupures que contient la mallette en cuir n’est pourtant destinée à finir sous l’élastique d’une quelconque strip-teaseuse. Alexanko a d’autres chats à fouetter que l’amour : cette escapade nocturne est peut-être la dernière chance de retrouver en un seul morceau son meilleur ami et collègue du Barça, l’attaquant Enrique « Quini » Castro, séquestré depuis près de quinze jours. À l’approche du panneau « La Jonquera » , Alexanko finit par rétrograder, stationne sa voiture devant le Park Hotel et franchit la porte d’entrée. Le téléphone de la réception sonne, c’est pour lui. « On se voit de l’autre côté de la frontière » , lui intime sèchement son interlocuteur.
La nuit commence à être longue pour le joueur. « J’étais parti tard, et j’avais déjà dû me rendre à Gérone, puis à Figueras, précise-t-il aujourd’hui. Voilà que je devais maintenant aller jusqu’à Perpignan. » Alexanko compose alors un autre numéro, celui du chef de la police de Barcelone. Le boss est emmerdé. L’époque n’est pas encore à la coopération policière transfrontalière et les inspecteurs en civil qui filent le joueur du Barça ne peuvent pas s’aventurer sur le territoire français. L’opération est annulée. Qu’à cela ne tienne, Alexanko laisse l’argent dans une voiture et décide quand même d’y aller, lui et son sang-froid de défenseur central. « Je suis parti tout seul à Perpignan. Là-bas, ils m’ont contacté de nouveau, mais je leur ai dit que je n’avais pas pu passer la frontière avec 100 millions de pesetas. Ils m’ont alors renvoyé à Barcelone avec des mauvais mots. » Fin de la séquence course-poursuite et, avec elle, fin des espoirs de ramener rapidement Quini au bercail. « C’était une histoire comme on n’en voit seulement au cinéma, précise encore Alexanko. Je ne sais pas si c’était de la peur ou de l’inconscience, mais je devais le faire et je l’ai fait, même si tu ne sais jamais dans quel guêpier tu te fourres. J’étais jeune, j’avais seulement 24 ans, et il se passait des trucs impensables à l’époque. »

Bernd Schuster, George Best et un colt 45
L’action de ce film noir se situe à Barcelone, en mars 1981. « Les trucs impensables » dont parle Alexanko, c’est tout simplement l’Espagne de la transition démocratique post-franquiste.
Une époque où des colonels, conduits par Antonio Tejero, peuvent encore entrer au parlement le flingue à la main tandis que le général Milans del Bosch se balade en tank dans les rues de Valence, proclamant l’état d’exception. Une époque où ETA et le groupe maoïste GRAPO se tirent la bourre au concours du meilleur terroriste. Une époque, enfin, où la délinquance est à son apogée. « La situation sociale de la fin des années 1970 était terrible, surtout dans les quartiers de la périphérie de Barcelone comme La Mina, détaille Jori, alors jeune inspecteur. Il y avait parfois cinq braquages par jour, des fusillades, des attaques de bijouterie à l’arme à feu. La plupart de mes collègues se sont pris des balles. » Preuve que tout fout le camp, l’Atlético de Madrid, qui n’a plus remporté la Liga depuis 1977, est en tête du championnat. Le Barça, lui, revient de l’enfer. Précisément : d’un début de saison désastreux marqué par une élimination 4-0 face à Cologne en coupe de l’UEFA. Mais comme on peut être un grand joueur et un médiocre entraîneur, et inversement, Helenio Herrera a remplacé Kubala sur le banc, et les choses sont progressivement revenues en ordre. Pour autant, le véritable homme providentiel du retour du club catalan ne s’appelle ni Herrera, ni Schuster, ni Simonsen, mais Enrique « Quini » Castro. Un type qui ne connaît pas le besoin : 16 buts au compteur, une gueule de cinéma à faire péter la rétine des minettes, et le charisme qui va avec.
« Quini était une personne spéciale. Très spéciale. C’est simple, tout le monde l’adorait » , confie Antonio Olmo, le capitaine de l’époque. À dire vrai, Quini semble sorti d’une autre époque. Un fils d’ouvrier des Asturies, et l’homme d’une seule femme, Maria Nieves, qu’il épouse alors qu’il se remet à peine d’un coup de coude de George Best, lequel lui a cassé une côte et perforé le poumon. « C’était surtout quelqu’un de terriblement généreux. Il aidait toujours les gens qui lui demandaient de l’argent. Il fallait même parfois le freiner » , détaille Alexanko, le joueur le plus proche de l’attaquant dans le vestiaire. Ce dimanche 1er mars, au Camp Nou, Quini n’a pourtant pas beaucoup de pitié pour les jeunots de l’Hercules Alicante. 35e minute : après un coup franc de Simonsen sur la transversale, il pousse la balle au fond des filets. Trois minutes plus tard, rebelote, passe de Simonsen pour Quini qui claque son deuxième but de la tête. 6-0 finalement pour le Barça, qui se hisse à deux points seulement du leader, l’Atlético de Madrid, qu’il doit rencontrer le dimanche suivant. Homme du match, Quini est l’un des derniers Barcelonais à quitter le Camp Nou après avoir répondu aux questions de la télévision espagnole. Il s’installe au volant de sa Ford Granada, fait un crochet par la maison pour y déposer son sac de sport et lance l’enregistrement de la rediffusion du match, avant de reprendre la route, direction l’aéroport, pour récupérer femme et enfants de retour de week-end.
Avant de s’élancer sur l’autovia de Castelldefels, Quini s’arrête à la station essence de la place Comas. C’est là que Victor, Eduardo et Fernando, les trois passagers de la fourgonnette DKW qui suivent la Ford Granada depuis plusieurs minutes, décident de passer à l’action. Fernando braque le joueur avec son colt 45. « Tout a été très vite, ça a duré deux minutes. Ils m’ont mis une capuche sur la tête et m’ont jeté sur la place passager de ma voiture. On a fait un petit tour et ils m’ont ensuite mis dans une fourgonnette » , se souvient aujourd’hui Quini. À l’arrière de ladite fourgonnette, les malfrats ont disposé une caisse en bois. Une cagoule sur la tête et de l’adhésif sur la bouche, Quini suffoque pendant les deux heures d’un trajet à haute vitesse sur l’autoroute. « Je ne savais pas où on allait, reprend l’ancien attaquant de Barcelone. Je pensais qu’ils me sortaient d’Espagne. C’était horrible, j’avais la tête qui tournait. Je ne savais pas du tout ce qui se passait, et ça me semblait durer une éternité. Quand on s’arrêtait aux péages, ils mettaient la radio à fond, au cas où j’aurais voulu crier. La musique était très, très forte. »
Au bout du trajet, Quini est poussé dans une cave qui sent le moisi et l’humidité. Les clés tournent dans la serrure, il est prisonnier. À l’aéroport, sa femme, Maria Nieves, s’inquiète et patiente avec les bagages dans une main, les gamins dans l’autre. Elle sait que son mari n’est pas homme à arriver en retard, encore moins un coureur de jupons parti fêter la victoire dans un tripot. C’est Alexanko qui reçoit le premier coup de fil. « Maria Nieves m’a appelé directement, confirme l’ancien joueur. J’ai cherché Enrique partout, sans succès. On s’est rapidement douté qu’il était arrivé quelque chose, j’ai averti le Barça, j’ai passé la nuit à la maison et, le lendemain, les ravisseurs nous ont fait savoir qu’ils détenaient Quini. » Une carte écrite de la main du joueur est laissée comme preuve dans une cabine téléphonique de L’Hospitalet de Llobregat avec, dessus, un montant : 100 millions de pesetas.
Ray-ban, cheveux longs et pantalons de cow-boys
Le Barça entre en crise. « Je suis prêt à donner ma vie pour sa liberté » , déclare Nicolau Casaus, vice-président du club.
Maria Nieves reçoit les visites de soutien de joueurs et de personnalités, au premier rang desquelles Juan Antonio Samaranch. « C’était très compliqué, se souvient Juan José Estella, alors milieu de terrain du Barça. Il y avait une peur générale dans l’équipe, on était placés sous surveillance. La première semaine, on ne s’est quasiment pas entraînés, on ne pouvait pas penser à jouer au football, on attendait seulement des nouvelles de Quini. » Au milieu de l’angoisse généralisée, des mecs répriment un sourire derrière leurs Ray-ban. Ce sont les flics. Pour la jeune police espagnole, ce scénario hollywoodien représente en effet l’occasion de vivre sous les flashs de la célébrité. « Dans la brigade, on était tous du Barça, confesse Jori. T’imagines ? Le rêve ! J’avais 27 ans et j’ai pu connaître Kubala, Amador, Migueli. Une fois, ils m’ont invité et je me suis retrouvé assis à côté de Cruyff. À l’époque, nous les flics, on voulait tous être comme Al Pacino. Alors on s’habillait comme dans les films. Cheveux longs et pantalons de cow-boys. » Un bémol quand même, Jori et ses collègues sont dépourvus de moyens. « On était une vingtaine seulement dans notre brigade, continue Jori. Le chef supérieur nous a confié le dossier parce qu’il n’y avait pas vraiment de groupe anti-enlèvement à ce moment-là. »
Après avoir écarté la piste terroriste et mené une enquête infructueuse sur l’entourage de Quini, les inspecteurs ratissent la ville, questionnent leurs indics, vont à la pêche au tuyau auprès des putes et des junkies de tout Barcelone. Chou blanc. « Les types avaient bien planifié leur affaire, ils nous ont rendu fous » , confesse la voix grave de Jori. Las de voir l’affaire faire les gros titres, le gouverneur civil de Barcelone, Josep Cordech, donne l’ordre de mobilisation générale. Via Laietana, au siège de la police, Francisco Álvarez Sánchez, a.k.a « Le Cerveau », rappelle la cavalerie pour creuser la seule piste crédible menant à l’attaquant culé : un coup de téléphone quotidien entre Fernando Martin Pellejero, l’un des ravisseurs, et Alexanko. Pourquoi Alexanko ? Pour une raison très simple, si l’on en croit l’ancien défenseur : « Quand les ravisseurs ont demandé à Quini qui il voulait appeler, il leur a dit qu’il souhaitait parler avec moi. Donc j’étais celui qui décrochait le téléphone. C’était difficile, mais je me suis mis dans le rôle. » « Alexanko était parfait, confirme Jori. C’était un type avec de l’aplomb. Il n’avait jamais peur et se passionnait pour l’enquête. Il venait même parfois avec moi pour vérifier les appels anonymes de voisins qui appelaient et qui pensaient avoir vu Quini ou des mouvements bizarres dans le quartier. Alexanko était très impliqué, il me disait : « Laissez-moi y aller, voir si je ne reconnais pas quelqu’un là-bas. » » Le reste du temps, Alexanko le passe assis près du téléphone : « Ils appelaient tous les jours. Il fallait que je sois là quasiment tout le temps, même si au fur et à mesure, on s’était mis d’accord sur une heure, entre 17 et 19h. »
Chaque soir, Alexanko tient le crachoir pour donner le temps à l’opérateur Telefonica de remonter l’origine des appels, une première dans la jeune histoire de la police démocratique. À l’époque, le système téléphonique espagnol est encore électromécanique. Pour retracer l’appel, une impulsion électrique court dans les câbles jusqu’à l’immeuble qui héberge le commutateur électromécanique Rotary 7A. Là, un électroaimant est mis sous tension par l’arrivée du signal, relâchant la pression exercée sur la roue dentée flexible en maillechort qui embraie sur le pignon.
Puis la machine se met en branle dans son tintamarre caractéristique, cloung, cloung, pour faire sonner, quelques instants plus tard, le téléphone du 50-52 de la Gran Via Carlos III, au domicile des Quini. Quand Alexanko décroche, l’inspectrice Nina, postée à ses côtés, appuie sur le bouton rouge de la machine qui enregistre la conversion tandis que Jori se saisit de sa radio. « El Pajaro esta en la jaula » (L’oiseau est dans la cage), adresse-t-il à l’ensemble des unités policières mobilisées pour l’opération. « Le « Pajaro en la Jaula » était un système qu’on avait mis en place avec Telefonica, détaille Jori. Ils nous avaient dit que les appels venaient du sud de Barcelone, de la zone du port. Donc quand le téléphone sonnait, je donnais le mot-clé et si un policier avait vu une personne rentrer à ce moment là, il devait arrêter le mec et prendre le combiné pour voir si Alexanko était au bout du fil. » En gros, la police barcelonaise va à la pêche au maquereau avec un baleinier. Sans surprise, l’enquête n’avance pas d’un poil et l’oiseau continue de gazouiller chaque jour. « Peu à peu s’était installé un grand silence dans la maison, explique Alexanko. On attendait toujours le prochain appel, en espérant qu’il apporte une solution. Mais elle ne venait jamais. Les ravisseurs ont alors commencé à devenir agressifs. Ils ont menacé de couper un doigt de Quini et de nous l’envoyer. »
« Éteignez-moi la lumière »
Dans ce genre d’histoire, les films disent vrai. Plus on attend, plus on a de chances de retrouver la victime saucissonnée façon petit Grégory. Les jours passent et au Barça, on commence donc à s’inquiéter sérieusement. Et à perdre. Le 8 mars, une semaine après la disparition, l’équipe amputée de son numéro 9 se rend au Vicente-Calderón pour affronter le leader.
« Ce match, ils nous ont obligé à le jouer » , affirme Estella, qui se plie comme les autres aux consignes, sans qu’on ne sache vraiment si elles sont données par la Fédération ou par le Barça. Bernd Schuster, bien évidemment, ne manque pas l’occasion d’ouvrir sa gueule. « Je ne jouerai pas. À part des jambes, j’ai un cœur, et je veux seulement que revienne Quini » , déclare-t-il avant un match qu’il finira par disputer. Sur le terrain, les fantômes du Barça prennent un honnête 1-0 avant d’aller pleurer dans les vestiaires. À l’aéroport, 5 000 supporters accueillent les joueurs au cri de « Quini, Libertad ! » Peine perdue. Le 15 mars, quelques jours après l’expédition d’Alexanko à La Jonquera et toujours sans Quini, le Barça perd 2-1 à Salamanque. Le 22 mars, match nul à domicile contre Saragosse. Les Catalans ont déjà perdu la Liga et les chances de retrouver Quini avec ses deux pieds s’amenuisent. « Dans un enlèvement, tu es toujours préoccupé, surtout quand ça dure un mois. Tu ne sais jamais, tu peux arriver là-bas et le retrouver mort » , analyse Jori, qui passe ses journées au domicile de Quini, où il assiste Alexanko. « Les ravisseurs ne savaient pas comment terminer l’affaire, comment encaisser la rançon, explicite le défenseur. Ça devenait de plus en plus compliqué pour eux car l’argent qu’ils avaient économisé pour monter le coup commençait à s’épuiser. Ils étaient de plus en plus nerveux. »
Pour autant, Quini confesse ne jamais avoir été vraiment en danger. « Ils essayaient toujours de me tranquilliser, ils me disaient qu’il n’allait rien m’arriver, qu’ils espéraient eux aussi que ça allait durer le moins de temps possible. On n’a pas beaucoup parlé, mais ils savaient que c’était une situation difficile pour moi et ils se faisaient du souci. Ils s’apercevaient que je perdais du poids, et ça se voyait que les mecs ne voulaient pas que ça se passe mal pour moi. Par exemple, ils m’avaient mis à disposition un haut-parleur. Je pouvais l’utiliser pour leur demander des choses. Quand je leur disais :« Éteignez-moi la lumière », ils me l’éteignaient et quand je disais : « S’il vous plaît, vous m’allumez la lumière? », ils me l’allumaient. »
Après plusieurs tentatives pour remettre la précieuse valise et des milliers de cabines téléphoniques sous surveillance, c’est finalement loin de l’Espagne que se dessine une solution. Alors que la Roja plie pour la première fois de son histoire les Anglais à Wembley, une autre victoire se prépare en Suisse. « Tout ce truc du téléphone n’a finalement jamais marché, balaye Jori. Mais, un jour, ils nous ont demandé de déposer de l’argent en Suisse. Je suis alors parti à Genève. Là-bas, on a parlé au juge et au directeur de la banque, qui nous a suppliés de ne jamais révéler qu’il avait levé le secret bancaire. Il nous a donné la photocopie du passeport du ravisseur qui avait ouvert le compte courant, et on a arrêté le type à l’aéroport. » Jori et son collègue Constanzio interrogent le coupable qui ne tarde pas à craquer et donne l’adresse où est détenu Quini. Surprise : c’est à Saragosse, loin des cabines indiquées par Telefonica. « Leur algorithme d’inversion des recherches dans les appareils électromécaniques devait être foireux, c’est hyper classique, décrypte Sébastien Crozier, directeur de la stratégie et de l’innovation chez Orange. Les années 1970-80, celles de l’électromécanique, c’est la période la plus compliquée pour les écoutes. Le système n’était pas prévu pour passer d’un appelé vers un appelant. »

Ce 25 mars, à 22h05, la police barcelonaise venue procéder elle-même à la libération de Quini pénètre dans la rue Jéronimo Vicens par le paseo Echegaray. Marugan, un flic gigantesque, sort son 357 Magnum et balance un pointu du droit dans la porte d’entrée. Son pied transperce le contre-plaqué dans lequel il reste bloqué. Les autres membres du groupe le vannent et pénètrent à leur tour dans l’habitation. Dans sa cave, Quini entend l’agitation au rez-de-chaussée et se cache sous son matelas.
« J’ai entendu des bruits bizarres en haut, et j’ai pensé qu’il ne me restait plus beaucoup de temps à vivre, se rappelle Quini. Je me suis mis dans un coin et je me suis caché sous le matelas en mousse. Puis, la porte s’est ouverte, et j’ai aperçu un pistolet pointé sur moi. Là, je me suis dit« Madre Mia ». J’ai cru qu’ils allaient me tuer. Puis une voix m’a dit : « Tout est fini, je suis de la police ». Là, je me suis évanoui. » Quand il se réveille, Quini pleure. « Vingt-cinq jours, c’était quand même beaucoup, dit-il rétrospectivement.L’endroit où je me trouvais était tout petit. J’étais dans une cave. Il y avait juste une ampoule électrique et un matelas en mousse qui prenait toute l’humidité. »
Trois anonymes et une occase
Trente ans plus tard, la cave où le n° 9 du Barça a vécu pendant vingt-cinq jours fait désormais office de salle de répétition pour un groupe de rock local. Les briques rouges de ce quartier ouvrier qui sent l’huile de friture et les nappes à carreaux n’ont pourtant pas disparu.
Manuel Royo non plus. Pilier du 13 rue Jéronimo Vicens depuis plus de trente-cinq ans, le grand-père a bonne mémoire : « Quand les flics sont venus les arrêter, on n’y croyait pas. Tout le monde pensait que Quini était à l’étranger, pas sous ma salle à manger. » Mais la police ne s’est pas seulement plantée sur la localisation des trois oiseaux, elle a surtout mal cerné sa proie. « Les ravisseurs? Des bons voisins, aimables et travailleurs, poursuit Royo. Ils réparaient des motos et puis ils se sont retrouvés au chômage. C’est là qu’a dû leur venir l’idée de l’enlèvement de Quini. » Victor Manuel Diaz, Fernando Martin Pellejero et José Eduardo Sendino, qui prirent dix ans de prison pour leur coup foireux, n’étaient donc pas des gangsters, mais des chômeurs. Deux mécanos et un électricien, trois anonymes perdus dans la ville espagnole de General Motors, qui se disaient que le Barça avait beaucoup et eux très peu. Voilà pourquoi aucun indic n’avait entendu parler d’eux. Voilà pourquoi les remises de rançons furent mal menées et voilà pourquoi Quini se fit réveiller chaque matin au son des chansons de Julio Iglesias. Voilà aussi sans doute pourquoi Quini, qui reprendra rapidement le jeu sous le maillot du FC Barcelone, laissera la cage de l’oiseau ouverte dès sa sortie : « Une fois en prison, l’un d’entre eux a demandé à la police s’il pouvait me voir. Alors j’y suis allé, ils me l’ont sorti dans le couloir. On a discuté plusieurs heures et il m’a présenté ses excuses. Mes ravisseurs avaient besoin d’argent et ils ont eu cette mauvaise idée, mais ils l’ont fait pour aider leur famille. Au fond, c’étaient des gens bien. »
Par Pierre Boisson, à Barcelone
Tous propos recueillis par PB (cet article est extrait du So Foot hors-série faits divers sorti en décembre 2012)