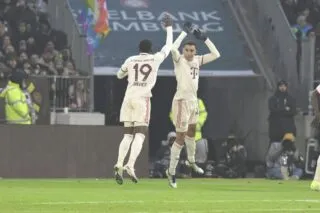- Billet d'humeur
- Réflexion comparative autour du football
Pourquoi le foot est-il meilleur que la NBA ?

Pour vous, Tony Parker n'évoque pas grand-chose d'autre qu'un très mauvais rappeur, un débardeur se range obligatoirement dans la penderie de madame, et Joakim Noah est avant tout le petit-fils de Zacharie. Normal, votre opium, c'est le foot. Un sport où la balle doit rester au fond du filet.
Onze heures du mat’ au bureau. Bientôt deux heures que vous avez avalé votre premier café Selecta. Le plus important, celui qui détermine une journée réussie. Bientôt deux heures aussi que vous tentez de joindre votre collègue. Le type qui, en partant hier soir, vous a répondu plein d’assurance : « T’inquiète pas, on voit ça tranquillement demain matin… » Il est sympa d’habitude, avec ses grosses Nike orange et sa casquette des Knicks retournée sur le scalp. Sauf qu’aujourd’hui, il fait un peu chier. Trois appels en absence plus tard, le voilà qui se pointe dans l’open space, la gueule en vrac. « Ouais désolé mec, y avait un petit Portland/Memphis cette nuit, j’ai pas pu résister… Bon, on s’y met ? » . La pendule au-dessus de sa tête pointe désormais sur 11h30, mais les sacoches sous ses yeux semblent encore peser bien lourd. Plutôt que de s’en remettre immédiatement aux insultes, vous la jouez philosophe. Mais diable, comment est-ce possible de vivre constamment en plein jet lag, lorsqu’on habite à trois stations de métro ?
Pat Ewing, Michael Jordan, nuque longue et paire de Pump…
La réponse tient en trois lettres : NBA. Cette énième association de millionnaires ricains qui vampirise les nuits de tout bon fan de basket à travers le monde. Lorsque le foot peut, au pire, vous flinguez votre lundi matin parce que votre Espérance Sportive Troyes-Aube-Champagne a cogné l’OM en prime time et que vous avez fêté ça sans dignité aucune, la NBA, elle, remet ça tous les soirs. Ou plutôt toutes les nuits. Dès une heure du mat’ à l’Est, et vers quatre ou cinq heures pour la West Coast. Où comment égarer son horloge biologique chez l’oncle Sam, quelque part entre Boston, LA, Dallas et Miami. Un comble pour un sport qui n’a, lui-même, aucune notion du temps. Car un match NBA, c’est avant tout un incroyable vortex temporel. Une rupture du continuum espace-temps où jouer quatre fois douze minutes peut prendre jusqu’à trois heures, entrecoupées d’interminables temps morts tous destinés à écouler le poulet frit du Colonel plutôt qu’à regonfler les joueurs, et dont les trente dernières secondes de jeu peuvent paraître aussi longues qu’un Nancy/Sochaux en hiver. Un peu comme si Tony Chapron infligeait vingt minutes de purge supplémentaires, là où le tableau lumineux n’en demandait que trois ou quatre. Le fameux « money time » . Inconcevable pour vous qui peiniez déjà à rester éveillé devant 100% Foot.
Pourtant, à bien y réfléchir, vous gardez toujours un bon souvenir de la dernière fois où vous êtes tombé sur un match NBA. Sans trop savoir pourquoi. Peut-être parce que c’était en 1996, que Michael Jordan dunkait encore sur Pat Ewing et que, ce soir-là, vous rentriez torché du night-club où votre nuque longue et vos Pump avaient fait fureur. Depuis, plus rien. Ou presque. Lebron James vous dit vaguement quelque chose, mais vous êtes toujours aussi infoutu de comprendre pourquoi « il a encore fait un triple-double » . Un mal pour un bien. Car dans le cas contraire, vous seriez également capable de répondre à des questions totalement folles, du genre : « T’as vu le match de mammouth de Kevin Love hier soir ? 38 points à 57% de réussite aux shoots, 19 rebonds, 7 assists, 4 blocks et 2 steals en 38 minutes. Sacrée perf, non ? » Qu’importe. Le seul truc dont vous êtes certain là-dedans, c’est que le foot ne glorifiera jamais un dénommé « Kevin Amour » , et ça, vous en êtes fier. Au rayon faute de goût, toujours, cette dégueulasserie de maillot sans manche. Non content de taquiner le plus beau ballon de la création sur un parquet parfaitement ciré, les basketteurs ont préféré tout sacrifier sur l’autel du combo marcel/tatouages/bandeau-éponge. Un must outre-atlantique. Sans parler du célèbre « dress code NBA » , un règlement draconien qui impose aux joueurs de se pointer en costard à chacune de leurs apparitions publiques. Imaginez, un instant, notre bonne vieille Ligue 1 sans la jupe de Djibril Cissé, le décolleté de Rio Mavuba ou le calebard apparent de Mathieu Valbuena en zone mixte. Une hérésie. La classe du footballeur, oui, mais sur le terrain seulement.
« Boomshakalaka! »
Et puis c’est quoi cette obsession de sanctionner le moindre petit contact ? Une manie d’autant plus incompréhensible pour un championnat dont le meilleur joueur étranger est un Allemand. Certes, le duel à l’épaule avec un type de 2m10 peut s’avérer périlleux, mais même pour vous qui êtes bien loin des mensurations d’un Shaquille O’Neal, ne pas se défiler est avant tout un devoir. Il n’y a qu’à regarder Johan Cavalli s’accrocher au short de Zlatan pour bien saisir le concept. Bref. La vérité, c’est que la NBA a peur du risque. C’est pourquoi elle ne laisse quasi aucune place à l’imprévisible, cet inévitable facteur chance qui fait – et surtout défait – les saisons des clubs de foot. Pas de relégation pour pleurer, ni de montée pour rêver. Juste une Ligue fermée où tout est fait pour piper les dés. Quant aux fameux play-offs, à quoi bon s’abimer les genoux à bondir pendant 82 matchs pour finalement jouer l’essentiel de sa saison sur un mois ? Autant gagner du temps et éliminer d’office la quinzaine de sparring partners qui complète le tableau. Histoire d’annihiler définitivement le peu de suspens restant avant l’ultime arnaque de la saison : une finale qui se joue au meilleur des sept matchs (le premier à gagner quatre matchs l’emporte, et l’intégralité des play-offs NBA est basée sur ce modèle, ndlr). Soyons sérieux. Si un footeux avait eu cette idée à la con, Lorient, Guingamp ou Gueugnon n’auraient probablement jamais existé. Pire. Le coq sur notre liquette nationale aurait pu voir une deuxième étoile brodée au-dessus de sa crête. Et les poteaux carrés de Glasgow se seraient peut-être enfin arrondis pour Sainté, privant ainsi plusieurs générations de supporters d’une partie de leur mémoire. Ou comment vider le football de son essence, de sa substantifique moelle, de cette perpétuelle et universelle impression de s’être fait carotte…
Au fond, outre le droit de porter fièrement le numéro 0, s’il y a bien deux choses que le foot pourrait éventuellement pomper à la NBA, c’est d’abord le fait de pouvoir choisir son nom. N’importe lequel. Dernier exemple en date, Ron Artest, ce joueur des Lakers qui, en un été, s’est transformé en Metta World Peace. Littéralement, « Amour bienveillant et Paix dans le monde » . Un peu comme si Joey Barton, en débarquant à l’OM, avait floqué sur son maillot « Amitiés éternelles et Pose ta kalach » . Le second truc, c’est cette histoire de All-Star Game. Parce que réunir les meilleurs joueurs de la planète dans une parodie de match commentée par George Eddy, avec tout plein de cheerleaders autour du terrain, même Michel Platini n’y resterait pas insensible. L’occasion aussi pour Cristiano Ronaldo d’assouvir un peu plus sa soif de record en devenant le premier footballeur sponsorisé par Jordan – à condition, toutefois, de célébrer chaque but inscrit de la tête d’un « Boomshakalaka! » portugais. Car oui, « les manchots » aussi savent sauter.
Par Paul Bemer