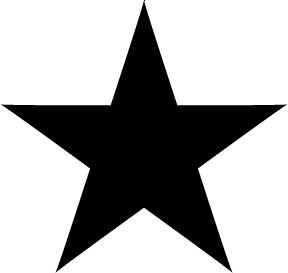- France
- Légende
Pierre Laigle : « 1998 restera la plus grande déception de ma carrière »

À 50 printemps, Pierre Laigle coule des jours heureux dans un patelin de 4500 âmes, dans le Rhône. Marchand de biens immobiliers, conseiller municipal, il a totalement tiré un trait sur le football. Mais dix-sept ans après s’être retiré du monde pro, le temps était venu de rouvrir le placard à archives. De Lens à la Sampdoria en passant par son éviction du groupe d'Aimé Jacquet à la veille de la Coupe du monde 1998, retour sur la carrière de l’homme le mieux brossé de l'histoire du football français.
Il y a 30 ans, vous débutiez en pro, à Lens, sous les ordres d’Arnaud Dos Santos, en D2…Ça fait un bout de temps ! C’était assez soudain. Je faisais partie du groupe pro, mais je ne m’attendais jamais à des débuts pareils. J’avais fait le stage de préparation d’avant-saison et tout s’est précipité. L’arrière gauche de l’époque, dont j’ai oublié le nom, s’est blessé. Je n’évoluais pas à ce poste, plutôt ailier gauche ou milieu offensif. Et je me retrouve à jouer toute la deuxième mi-temps du premier match de préparation. Ça se passe bien, ensuite je deviens titulaire et je ne quitte plus l’équipe. Tout est allé très vite. J’ai profité d’une blessure pour m’imposer, mais il fallait saisir sa chance.
Peut-on parler d’un rêve de gosse pour un gamin du bassin minier ?Clairement. Mais ça n’a pas été si simple. J’arrive à Lens vers 10-11 ans et j’intègre le sport-études. Vers 16 ans, je redouble ma seconde, et à la fin de ma deuxième seconde, on me dit : « Soit tu intègres le centre de formation, soit tu continues les études. » Il fallait faire un choix, ce n’est pas comme maintenant où, dans un centre de formation, on t’accompagne jusqu’au bac. Pour mes parents, c’était très compliqué. C’était un risque énorme d’arrêter l’école pour tout donner au football.
Juste avant cet entretien, Gervais Martel nous expliquait qu’il était intervenu à l’époque pour que le club vous garde, malgré le scepticisme de certains…Je n’ai pas eu écho de ça. Après, c’est vrai que j’étais un bon joueur, régulier, mais je n’ai grillé aucune étape. J’en ai connu plein qui, à 16 ans, étaient en équipe de France de jeunes et n’ont finalement jamais percé au plus haut niveau. Dans ma génération, à Lens, je suis l’un des seuls à avoir basculé pro. Ce que dit Gervais est certainement vrai. Il a eu raison d’insister. J’avais des qualités, mais je n’étais pas un surdoué. Je n’ai rien lâché et ça a payé.
Pour vos parents aussi, c’était un sacrifice ?Mon père était maçon, il ne pouvait pas me conduire la semaine. Heureusement, ma mère ne travaillait pas parce qu’on était nombreux à la maison. Au début, elle m’amenait à Lens deux fois par semaine, puis mon père le week-end, et ensuite, c’est devenu chaque jour. Si mes parents ne s’étaient pas sacrifiés, jamais je n’aurais pu faire carrière.
Durant votre première saison, vous vous retrouvez avec pas mal de jeunes de la formation lensoise…Des vrais gars du cru, de la région. Sikora, Wallemme, ils étaient du coin. Le début de saison 1990-1991 est compliqué, mais finalement on fait une superbe deuxième partie et on accroche les barrages. Là, on est surclassés par Toulouse, mais on décroche la montée sur tapis vert (après les relégations administratives de Nice, Bordeaux et Brest, NDLR). La saison d’avant, je fais à peine deux apparitions en pro sous les ordres de Marcel Husson. J’étais pris pour faire le nombre, je ne joue quasiment pas, et un an plus tard, on arrache la montée et je me retrouve titulaire en D1.
Avec ce groupe lensois, vous allez jusqu’à retrouver l’Europe au milieu des années 1990…Jouer la Coupe d’Europe avec Lens, c’est ce qu’on voulait tous. Année après année, un groupe s’est construit, s’est étoffé. Il y a eu d’énormes affiches, notamment ce jour où on bat Marseille 2-1, en 1992, avec le record d’affluence de Bollaert (48 912 spectateurs, record du championnat de France à l’époque, NDLR). Il fallait voir Bollaert ce soir-là. Nous avons pu aider à remettre Lens sur le devant de la scène avec une vraie stabilité. Patrice Bergues (entraîneur de 1992 à 1996) a aussi été un très bon relais d’Arnaud Dos Santos.
À l’époque, vous aviez déjà cette frappe de mule ? On se souvient notamment d’une belle praline au Parc de Princes, en quarts de finale de Coupe de France contre Paris en 1994…J’ai toujours eu cette frappe, naturelle. On dit que les gauchers ont toujours une meilleure frappe que les droitiers, pour le coup c’était vrai. (Rires.) À l’entraînement, je bossais ça, idem pour les coups francs. C’est vrai que face à Paris, en coupe, on se retrouve face à l’ogre. On est menés 1-0 à la mi-temps et on renverse tout. Je marque du droit, ce qui n’était pas vraiment mon point fort, d’une frappe de vingt mètres. C’était un moment fort, un coup d’éclat. Même si après, on se fait éliminer en demi-finales par Montpellier.
Au printemps 1996, vous quittez Lens. Vous sentiez déjà en fin de saison que vous alliez partir ?Ça faisait cinq-six ans que j’étais là en pro. Je voulais progresser et voir autre chose. Je m’étais mis en tête que c’était ma dernière saison à Lens. Mais je pensais rester en France. Les négociations étaient en cours avec le Paris Saint-Germain, et puis la Sampdoria est arrivée, et en trois jours, le dossier était réglé.
Gervais Martel explique notamment que ça traînait avec le PSG parce que Michel Denisot était au festival de Cannes durant les discussions…Oui, c’est ça. Les dirigeants parisiens n’étaient plus vraiment disponibles pour les négociations, car Michel Denisot était au festival de Cannes. Voilà pourquoi la Sampdoria est venue toquer à la porte. Là, j’ai été surpris. Ce n’est pas qu’un changement de club, c’est aussi un changement de pays, de culture, de manière de vivre. Pour quelqu’un qui n’était jamais parti du Nord, c’était un sacré défi. Je ne parlais pas un mot d’italien. C’était un risque, mais dans l’effectif, il y avait Christian Karembeu et ça a pesé dans ma décision.

Justement en parlant du vestiaire, vous débarquez sous les ordres de Sven-Göran Eriksson avec dans l’équipe des noms comme Juan Sebastian Verón, Roberto Mancini, Siniša Mihajlović. Que du costaud…C’était la grosse équipe. Je ne vais pas dire que ça me faisait peur, mais j’étais intimidé de faire partie de ce groupe. La première fois que je rentre dans le vestiaire, je ne sais pas vraiment quelle place prendre. Heureusement, il y avait donc Karembeu et Vincenzo Iacopino, un jeune Italien qui habitait à Vintimille et qui m’a bien aidé. L’intégration s’est bien passée. Niveau boulot, c’est un changement radical. Lors du stage de préparation, je vois un staff plus complet, beaucoup plus de séances de travail, quelque chose d’extrêmement poussé avec un temps d’avance sur la France.
Vous découvrez aussi un autre calibre d’entraîneur avec Sven-Göran Eriksson…Déjà, c’était un étranger, il parlait un italien assez simple. Ce n’est pas plus mal parce que généralement en Italie, ça parle vite avec des patois dans chaque région. Avec lui, je comprenais facilement. Sven-Göran était un personnage, même si niveau caractère, il n’avait pas l’habitude de crier. Il paraissait un peu réservé, mais il m’intimidait. J’hésitais à l’approcher, je me demandais où j’étais tombé, il y avait une vraie appréhension. Même s’il avait ses petites lunettes et ses tenues sobres, il en imposait. Pour le premier match de championnat, il ne me met pas titulaire. Il ne me connaissait pas vraiment, il voulait me jauger, savoir si j’allais être à la hauteur. Et puis sur le deuxième match il m’aligne, ensuite c’était parti.
Et d’un point de vue tactique, c’était comment ?Impressionnant. Il y avait un nombre de répétitions à l’entraînement incalculable. Parfois, c’était chiant de refaire je ne sais combien de fois le même schéma de jeu. Il n’y avait pas trop de vidéo hormis quand ça se passait mal sur une rencontre. La souplesse n’existait pas vraiment, c’était très strict. Même si c’était un entraîneur étranger qui n’avait pas été éduqué au Catenaccio toute sa vie, il fallait être attentif sur tout. Tu voyais dans son regard qu’il avait besoin de ton attention. On évoluait quand même dans le meilleur championnat du monde à ce moment-là.
Et dans le groupe, il y a un joueur à part, un certain Roberto Mancini…C’était le relais de Sven-Göran sur le terrain. Il y avait des cadres dans le vestiaire, mais lui c’était le numéro un, à la fois en raison de son âge, de sa carrière, de son charisme. Mancini, c’était presque un entraîneur-adjoint, hallucinant. Il discutait beaucoup avec le coach avant les matchs, il avait même un œil sur la compo et Sven-Göran s’appuyait énormément sur lui, aussi pour faire passer des messages au groupe. Il ne parlait pas beaucoup, mais sur le terrain, il avait un caractère particulier. Techniquement, c’était du costaud et il avait du mal à accepter que certains joueurs ne soient pas comme lui et ratent des passes. Ça en devenait pénible par moment et c’était paradoxal avec son attitude en dehors du terrain, où il était très calme, très gentil. Il était tellement perfectionniste… Quand je prenais une remarque venant de lui, j’étais obligé d’accepter. Idem pour mes équipiers. C’était pour le bien de l’équipe.
Vous n’avez pas connu qu’Eriksson sur le banc…Au bout d’un an, Sven-Göran Eriksson est parti à la Lazio. Après, on nous a mis César Luis Menotti, ça s’est moins bien passé. Il reste aussi un an et Luciano Spalletti est nommé. Il commence alors sa carrière d’entraîneur. Au bout de six mois, il est viré, remplacé par David Platt, qui lui aussi est viré deux mois après pour remettre Spalletti ! C’était compliqué dans tous les sens. Et puis Spalletti était très particulier, notamment dans sa relation avec les joueurs. Il avait toujours l’impression qu’on parlait de lui. Dès qu’on était quelques joueurs à discuter ensemble, il se sentait épié. Il faisait attention à tout, il avait l’impression de voir des complots partout.
Vous avez aussi vu Juan Sebastian Verón débarquer à la Sampdoria…Quand il arrive à la Sampdoria, Verón n’a que 18 ans. Immédiatement, tu vois le charisme du gars. Il arrivait libre d’Argentine et découvrait l’Europe. Il avait une telle maturité et ne faisait pas son âge. Il m’a impressionné, quelle personnalité ! Franchement, j’avais l’impression qu’il avait 25-30 ans, c’était un homme quoi. Les deux premiers mois ont été compliqués, mais Mancini l’a aidé à intégrer véritablement le groupe. Il arrive d’Argentine, à 18 ans, et devient notre meneur très rapidement. C’est costaud.
En équipe de France, vous côtoyez aussi un autre grand nom, Zinédine Zidane. Comment se passent les débuts ?Qui n’était pas impressionné par lui ? C’était la star chez les Bleus et en Italie. Il faisait ce qu’il voulait du ballon. Moi, j’arrivais dans le groupe, à chaque entraînement, je devais montrer ce que je valais, montrer que ma place était là. Lui était déjà un titulaire à part entière, il s’entraînait un peu comme il voulait. Il suivait les exercices, mais il était tellement fort, sa technique suffisait. C’est la classe, que veux-tu dire de plus ? C’était plus simple pour lui que pour d’autres, c’est logique. Quand moi je tentais de prouver ce que je valais, lui était déjà plusieurs crans au-dessus.
Pendant les deux années qui précèdent la Coupe du monde, vous cravachez…Je donne tout. Nous n’avions que des matchs amicaux parce que l’équipe de France était déjà qualifiée. Aimé Jacquet cherchait encore son équipe, il y avait beaucoup de changements de système de jeu, de joueurs. Il était très critiqué et l’équipe aussi. On n’avait pas d’attaquants, Jacquet est reparti de zéro. Il y a eu des blessés comme Lizarazu et Petit qui sont revenus peu avant la Coupe du monde. L’un de mes regrets, c’est de m’être blessé juste avant l’inauguration du stade de France contre l’Espagne (le 28 janvier 1998, NDLR). Après je ne suis pas repris avant avril-mai. Je ne le saurai jamais, mais ce match d’inauguration que j’ai raté a peut-être eu une influence sur la suite des événements. Enfin, je ne sais pas, mais c’est un gros regret.
Parlez-nous du moment où on vous annonce que l’aventure s’arrête d’un coup…Il y avait pas mal de joueurs qui jouaient en Italie à l’époque. Nous étions arrivés un peu plus tard au stage de préparation à la Coupe du monde parce que le championnat s’était terminé après les autres. On fait une semaine d’entraînement et le vendredi soir, on donne rendez-vous à six joueurs. À partir du moment où on est six dans la chambre avec Aimé Jacquet, on savait très bien qu’on ne participerait pas à la Coupe du monde. Je n’avais même pas envie d’écouter Jacquet. Il a simplifié les choses, il nous a demandé si on était quand même dispo en cas de blessure dans la suite de la préparation. Je n’avais pas envie de donner de réponse, je voulais juste partir, idem pour Letizi, Anelka et les autres. Qu’on me dise que j’étais un bon joueur, qu’on me fasse des compliments, ça ne m’intéressait pas. Les excuses, je m’en fichais, on n’était pas dans les 22. Ce n’était pas la meilleure manière de faire que de prendre 28 joueurs pour en écarter six ensuite. L’ambiance était très pesante. Pour tout le staff, quand tu y penses, ce n’était pas simple de l’annoncer non plus. Une fois le discours terminé, on se lève et on part, voilà, la Coupe du monde s’arrête là. Pas de bruit, pas de cris, on part, je ne me souviens même pas d’avoir discuté avec les autres. Je fais ma valise, je quitte Clairefontaine et je rentre à Lens où j’avais encore un appartement. On nous a proposé de passer la journée du lendemain avec le groupe, mais je ne pouvais pas. Il y a un sentiment d’avoir été pris pour un bouche-trou, parce que je suis convaincu que Jacquet avait déjà son groupe en tête et que c’était écrit. 1998 restera la plus grande déception de ma carrière. Heureusement, au même moment, j’ai eu la naissance de mon fils, ça m’a permis de penser à autre chose et de relativiser. Et la saison a repris très tôt avec la Sampdoria parce qu’on jouait la Coupe Intertoto, donc je suis aussi vite reparti en Italie.
Et à vie, vous vous retrouvez avec cette étiquette de banni de 1998…À chaque Coupe du monde, quand le sélectionneur convoque un groupe élargi, on me repasse un coup de fil pour ça. J’avoue en avoir un peu marre, je n’aime plus en parler. C’est comme le collectif France 98. J’y ai participé au début et puis j’ai arrêté il y a quelques années. C’était sympa de revoir les joueurs, de faire des matchs de bienfaisance, mais j’ai toujours dit que je ne faisais pas partie de ce groupe, de la famille championne du monde. Je ne me suis jamais considéré comme un champion du monde même si j’ai fait la préparation. Eux, ils ont vécu un truc qui les a amenés jusqu’à l’Euro 2000 pour une partie d’entre eux. À chaque rassemblement de France 98, c’était compliqué au fond, on n’évoquait pas ce moment où les six ont été écartés. Le groupe sait bien que ça avait été douloureux, il ne fallait pas remuer le couteau dans la plaie. Avec Aimé Jacquet, on n’en a jamais reparlé.

Aviez-vous tout de même regardé le sacre des Bleus ?Oui, notamment le quart de finale face à l’Italie que j’ai vu en Italie, dans le vestiaire, avec Oumar Dieng. Je ne pourrais pas dire que j’ai célébré cette victoire en 1998, ce serait trop, mais j’étais content pour notre pays. Les joueurs n’y étaient pour rien, j’en voulais juste à Jacquet qui a fait ces choix-là sans vraiment s’expliquer, mais quand on voit le résultat, on ne peut rien dire.

Pour revenir sur Lyon, trois ans après votre retour en France, vous êtes sacré champion de France en 2002 et, clin d’œil du destin, c’est face à Lens…J’aurais franchement préféré que ce soit face à un autre club. Mais j’étais un joueur lyonnais, et le club n’avait jamais été champion. Je ne pensais pas au passé. Ce qui est fort, c’est que ça s’est fait sur une vraie finale, ce qui ne s’était jamais vu. Tout le monde à Lyon attendait ça depuis plus de 50 ans, l’engouement était très fort.
Et c’est vous qui crucifiez votre ancien club…C’était assez serré tout de même parce que si on mène rapidement 2-0, Lens revient à 2-1 avant la mi-temps. Là, on sait que si on marque une troisième fois, ce sera fini. Et puis je tente cette frappe, contrée par Jean-Guy Wallemme, et ça rentre. Je pense vraiment que le scénario était écrit. Sur le premier but, Guillaume Warmuz glisse, sur le deuxième, Philippe Violeau, qui ne met pas un but de la saison, marque. C’était notre soirée, rien ne pouvait nous arriver.
Est-ce le but le plus important de votre carrière ?Oui. J’aurais aimé ne pas le manifester aussi ouvertement, mais il y a tellement de choses qui me passent par la tête à ce moment-là, c’était impossible de ne pas célébrer. C’est le but du titre, une véritable délivrance.
Ça va faire 17 ans que vous avez quitté le monde pro, quel regard portez-vous sur votre parcours ?On peut toujours faire mieux, mais j’ai fait ce que j’ai voulu durant ma première carrière. J’ai voulu être pro je l’ai été, je n’ai pas non plus gagné 50 titres, mais j’ai une Coupe de la Ligue et un championnat de France. J’ai participé à la Coupe d’Europe et j’ai joué en équipe de France (8 sélections, 1 but), donc oui je suis fier de mon parcours. Pour ce qui est de ma deuxième vie, c’est pareil, je suis dans un métier qui me plaît, où je bosse pour moi, où je m’organise comme je veux en tant que marchand de biens, promoteur immobilier autour de Lyon. À la fin de ma carrière de footballeur, j’en avais marre. Toujours me déplacer, partir le week-end, ne pas pouvoir profiter des vacances l’été, être en vacances avant les autres. C’est un beau métier, mais il a ses avantages et ses inconvénients. J’avais besoin de me stabiliser, de me poser quelque part, de profiter pleinement de ma famille.
Vous n’auriez donc pas pu devenir entraîneur ?Entraîneur, c’est comme joueur, on est toujours à droite à gauche, toujours parti, c’est le même rythme qu’un joueur voire pire. Je n’en avais vraiment pas envie. D’ailleurs, je n’ai pas du tout passé mes diplômes.
L’arrêt de votre carrière a été compliqué à vivre…Il fallait trouver un autre métier. C’était une période assez difficile, pendant deux années environ. Du jour au lendemain, tout s’arrête. J’allais tous les jours à l’entraînement, là j’étais tous les jours chez moi sans savoir ce que j’allais faire. Je m’y étais préparé, je suis assez carré dans ma tête, mais c’était dur. Il y a bien l’UNFP qui peut nous aider à faire des tests de compétences pour savoir ce qu’on peut faire par la suite, mais je ne savais pas du tout. J’étais en période de chômage et il a fallu attendre ce déclic avec l’immobilier qui m’a totalement relancé. Des agents de joueurs m’ont contacté pour rester dans le milieu, mais je ne voulais vraiment pas rester là-dedans.
Quand vous voyez l’évolution du foot depuis, est-ce que ça vous conforte dans votre choix ?Clairement. La mentalité des joueurs a bien changé, chez les jeunes surtout. J’aurais eu du mal à jouer au foot en 2021. Certes, il y a plus d’argent dans le foot, mais je sens qu’à notre époque, il y avait plus de mecs issus des clubs en pro et ça formait de vrais groupes. Tu vois maintenant les gars avec le casque sur les oreilles, tu vois qu’il y a moins de dialogue qu’auparavant. Pour autant, je regarde toujours encore pas mal de matchs et les résultats de Lens notamment, qui est à sa place, et c’est très bien pour ses supporters. La Sampdoria aussi, Montpellier et Lyon bien sûr.
Il vous arrive encore de remettre les crampons ?Quand j’ai arrêté en 2004, je suis revenu m’installer du côté de Lyon où j’avais une maison et j’ai repris une licence en amateur pendant deux ans, à Saint-Priest, en CFA. Ça m’a permis de continuer de m’entraîner très régulièrement et de passer la période compliquée d’après-monde pro. Cinq-six ans plus tard, j’ai signé en vétérans dans un club du coin où j’habite, à Chaponost. Je ne suis plus vraiment au même poste, un peu plus derrière, un peu entre la défense et le milieu. Je n’ai plus les jambes que j’avais à 20 ans. Mais à 50 ans, je cours encore. Je n’ai plus les mêmes attentes que lorsque j’étais jeune. J’aime bien jouer un bon petit match le vendredi soir, entre potes et faire une bonne troisième mi-temps. Malheureusement, avec la Covid-19, ça fait un moment qu’il n’y en a pas eu. Tant que je peux, je continuerai à jouer, même si un jour je sais bien que je devrais arrêter.
Vous vous êtes aussi impliqué dans la vie de votre commune à Charly, en devenant conseiller municipal en mars 2020…Ça fait 13 ans que j’habite là-bas. Je ne m’intéressais pas trop à la vie du village, mais lors des dernières élections, le maire Olivier Araujo (Divers droite) m’a proposé d’intégrer son équipe. Le fait qu’il me contacte directement, ça m’a plu. C’est assez intéressant. Avec un autre ami, on a une délégation liée aux associations et à l’événementiel.
L’une des marques de fabrique de Pierre Laigle était sa fameuse coupe de cheveux à la brosse. Elle est toujours en place. Quel est votre secret ?Il n’y a pas de secret. (Rires.) Je l’ai depuis que j’ai commencé pro à Lens. Je ne voulais pas être embêté par les cheveux. J’aimais bien être coiffé rapidement, cheveux courts, et ça m’allait bien. C’est pour ça que je n’ai jamais eu envie de changer. J’ai une petite brosse qui me permet de redresser les cheveux et de mettre le gel. C’est pratique à faire, ça ne prend pas de temps et c’est ma marque de fabrique. Il y a encore des gens qui me reconnaissent juste grâce à cette coupe. Cette coupe, je ne la changerai jamais.
Propos recueillis par Florent Caffery