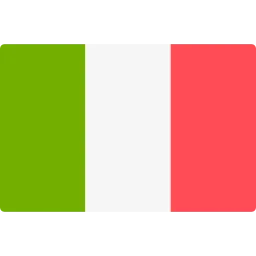- Italie
- Disparition de Paolo Rossi
Paolo Rossi, l’homme qui fit pleurer (tout) le Brésil

Le meilleur joueur de la Coupe du monde 1982 est donc mort quinze jours après celui du Mondial 1986. Paolo Rossi et Diego Maradona ont en commun d'avoir eu des vies et des carrières en forme de montagnes russes, d'avoir été des parias avant d'être des icônes nationales, ou inversement. Retour sur l'existence de l'avant-centre italien le plus létal de l'histoire.
Il est parti comme il était arrivé, sur la proverbiale pointe des pieds. À sa façon, discrète et effacée. Sa femme, Federica Cappelletti, a annoncé la nouvelle d’un post sur Instagram avec une photo et deux mots qui résument tout : « Per sempre ». Paolo Rossi serait mort « d’une maladie incurable », comme disent les gazettes, soudainement pudiques. Toute l’Italie, sa diaspora, et partant tous les fans de la Nazionale de par le monde, pleurent le héros de la Coupe du monde 1982, revenu alors des limbes et d’une longue suspension de deux ans, sept semaines avant le début du tournoi planétaire en Espagne. Après des débuts difficiles (trois nuls de rang au premier tour), il y sera aérien, crucial, impitoyable. « Je n’étais pas un phénomène athlétique, ni encore moins un fuoriclasse, mais quelqu’un qui a mis ses qualités au service de la volonté », nuançait-il en répondant à La Repubblica, au moment de la sortie de son autobiographie, J’ai fait pleurer le Brésil, en 2002.
Dans le Piémont en pleine adolescence
Quand il commence le foot au début des années 1960 à Santa Lucia dans sa Toscane natale, l’Italie est en pleine révolution industrielle, se remettant à peine des divisions de la Botte lors de la Seconde Guerre mondiale. Sur le terrain, tous les tifosi vivent encore dans la nostalgie des deux titres mondiaux acquis sous Benito Mussolini. Heureusement, bientôt les deux clubs de Milan inscriront leur nom au promontoire continental en remportant la Coupe d’Europe des clubs champions (l’Inter en 1964 et 1965 ; le Milan en 1963 et 1969). La Juve, qui se défend dans la péninsule, existe à l’époque si peu dans les compétitions internationales, malgré deux finales de coupe d’Europe des villes de foire, l’ancêtre lointain de la Ligue Europa. Cela ne saurait durer. Pendant que le pays va connaître une des décennies les plus abrasives de sa riche histoire, Pablito commence à faire des siennes. À douze ans, en 1968, deux mois après que l’Italie gagne avec pas mal de réussite son Euro, il intègre Cattolica Virtus, un des meilleurs clubs amateurs de Florence, la grande ville qui aimante tout dans la région. Quatre ans plus tard, c’est la Juve qui frappe à la porte de chez ses parents. « Cela n’a pas été facile, rapporte-t-il à Giorgio Dell’Arti et Massimiliano Bonino dans une biographie en 2014. Mes parents avaient encore en mémoire l’expérience de mon frère, renvoyé de Turin au bout d’un an. Ma mère ne voulait rien entendre. Mon père a conseillé à un dirigeant de la Cattolica d’exiger un chiffre élevé, histoire de dissuader les Juventini. Finalement, Italo Allodi(directeur sportif bianconero, futur mentor de Luciano Moggi) est venu à la maison, et j’ai fait ma valise pour 14 millions et demi de lires (soit 248 000€ en euros constants). »

Il débarque dans le Piémont en pleine adolescence, l’année où la Juve joue sa première finale européenne, perdue au printemps 1973 (0-1), contre l’intouchable orchestre rouge ajacide, le FC Van Gogh de Johan Cruyff. À Turin, Rossi accumule les blessures (trois opérations du ménisque en deux automnes), mais cela ne l’empêche de débuter en mai 1974 avec l’équipe fanion en Coupe d’Italie contre Cesena. Ses coéquipiers s’appellent Dino Zoff, Franco Causio ou Claudio Gentile, ceux-là mêmes avec qui il sera champion du monde, huit ans plus tard. Il compile encore deux matchs avec les grands avant d’être prêté à Côme. Il n’y jouera que six rencontres (0 but). Pourtant, les dirigeants turinois continuent confusément d’y croire. Le natif de Prato n’est pourtant qu’un chat efflanqué (1,75m, 67 kg, des mensurations qu’il gardera toute sa carrière), une promesse insondable, mais ils le proposent en copropriété au Lanerossi Vicenza, lors de l’été caniculaire de 1976. Banco.
Meilleur buteur de Serie A à 21 ans
En Vénétie, Pablito trouve le cadre idéal, qui lui rappelle sa Toscane originelle. Il s’épanouit dans le système de Giovan Battista Fabbri, son coach, et pactise en dehors avec Giuseppe Farina, le président visionnaire du Lanerossi, qu’il retrouvera dix ans plus tard au Milan. « Ces deux-là m’ont fait grandir », dira-t-il plus tard. D’emblée, l’entraîneur émilien le change de poste, le déplace de l’aile au poste de centre-avant, comme on roque aux échecs, comme Wenger l’a fait vingt ans plus tard avec Henry. Bonne pioche. Lors de sa première saison comme Biancorosso, il explose tous les compteurs. Avec 21 buts, il permet à Vicenza d’accéder à la Serie A. Contre toute attente, la Juve, qui vient de gagner la Coupe de l’UEFA, ne lève pas l’option, tandis que Farina en profite pour quintupler son salaire.

L’année suivante, le promu n’est pas loin de l’exploit du siècle : il lutte pour le Scudetto, termine à la deuxième place, et Paolo Rossi (21 ans) devient capocannoniere (24 buts) pour la seule fois de sa carrière. Ses performances stratosphériques lui valent ses premières convocations fin 1977 avec l’équipe nationale italienne. Mieux, il joue tout le Mondial argentin comme avant-centre titulaire. La Nazionale sort en tête d’un groupe compliqué en battant la France, la Hongrie et l’Argentine, le pays hôte, futur vainqueur. La sélection italienne – qui compte quelques marquis qui seront champions du monde quatre ans plus tard (Zoff, Cabrini, Gentile, Scirea, Tardelli, Causio, Antognoni, Rossi) – échoue dans une demi-finale officieuse au deuxième tour contre les Pays-Bas (1-2) et se désintéresse du match de classement contre le Brésil (1-2). Les doubles champions du monde transalpins ne s’intéressent jamais aux accessits.
Naples snobé, Perugia embrassé
Au retour d’Argentine, à l’été 1978, tout le pays se pâme, s’amourache de cet avant-centre à peine sorti de l’adolescence, taciturne, étranger au tumulte qui l’entoure. L’état de grâce ne passera pourtant pas les vacances, à la suite de l’affaire des enveloppes qui doit déterminer son avenir proche entre Piémont et Vénétie. Cette intersaison va laisser des traces. Le Lanerossi sort au premier tour de la Coupe UEFA, éliminé par le Dukla Prague, et s’enfonce dans les profondeurs du classement du championnat. Au moment du clap de fin, le club veneto finit à la pire des places, la quatorzième, la première des condamnés.

Vicenza veut le vendre au Napoli avant de descendre à l’étage inférieur. Rossi ne l’envisage pas une seconde. Face à la tifoseria parthénopéenne parfois trop envahissante, il déclare illico à Giorgio Vitali, le directeur sportif du club biancorosso : « Pour moi, la vie personnelle passe avant le foot, et si je devais inverser l’ordre des choses, je devrais y penser cent fois. Qu’irais-je faire à Naples ? Sauveur de la patrie ? Je ne suis pas la bonne personne pour ça. Je pourrais laisser mon âme sur le terrain, jouer mon meilleur football, ça ne suffirait pas. » Paolo file in fine à Pérouse, un autre club qui n’appartient pas aux grandes métropoles de la Botte, c’est à croire que le futur Ballon d’or se complaît dans la lenteur gazeuse des provinces italiennes. Pour s’attacher ses services et acquitter un prêt pour deux ans, les Griffonivont devenir la première formation italienne à avoir un sponsor maillot. Perugia, second l’année précédente, termine néanmoins cinq places plus bas avec Rossi (3e meilleur buteur, pourtant). À croire que le Toscan porte la poisse…

Totonero, cheveux courts et résurrection
Au printemps 1980, le scandale du Totonero lui explose en pleine face. En décembre 1979, à quelques jours d’un Pérouse-Avelino (pour lequel il signera un doublé), il est approché par un négociant de légumes en gros, « l’ami d’un ami d’un de [s]es coéquipiers » pour fausser le résultat dans le cadre des paris clandestins. Avec trois de ses coéquipiers, il feint d’accepter avant de se rétracter. La rencontre a furtivement lieu en marge d’une partie de cartes entre Grifoni. « Je me suis tout de suite senti mal. Cela a duré à peine deux minutes, ca a été les deux minutes les plus angoissantes de ma carrière », dira-t-il plus tard. Mécontent, le marchand des quatre saisons l’attaque en justice. « J’ai suivi le procès comme quelque chose d’irréel, comme s’il y avait quelqu’un d’autre à ma place. J’ai compris que tout était vrai quand je suis rentré à la maison et que j’ai vu les visages des miens », peste-t-il à l’époque. La Fédération italienne lui inflige trois ans de suspension. Rossi rate l’Euro italien de juin 1980, où la Nazionale ne termine que quatrième, et s’enfonce dans la déprime tout en conservant une dignité de pharaon. Un an plus tard, Sandro Mazzola pour l’Inter et Giovanni Boniperti reviennent à la charge. Maligne, la Federcalcio a ramené la suspension à deux ans pour le cas où… il serait opérationnel pour le Mondial 1982.
Au bout du compte, Boniperti et Giovanni Trapattoni le rattrapent par le col pour le ramener a casa. Le président de la Juventus le rassure : « Tu viendras avec nous au stage d’avant-saison. Tu t’entraîneras avec les autres, plus que les autres. » La convocation indique même qu’il doit s’y présenter « les cheveux courts » et ce qu’il faut manger et boire. Boniperti lui conseillerait même de se marier au plus vite, « comme ça, tu seras plus calme ». La Juve n’appartient pas à la famille Agnelli pour rien. Plus tard, au moment de la sortie de Ho Fatto piangere il Brasil, Paolo Rossi reviendra sur le point noir de sa carrière : « À travers moi, on a voulu faire un exemple et défendre le pureté du football italien, mais pour cela, on m’a sali. Je n’ai pas de squelettes dans le placard. J’ai pris deux ans de suspension sans rien faire de mal. Une morale de l’histoire subsiste néanmoins : on peut être écrasé par quelque chose qui nous rattrape sans que nous ayons rien fait pour que cela advienne. On peut devenir des victimes et ne pas réussir à le démontrer. » Le 29 avril 1982, l’ex et néo-Bianconero revient à la vie. Il reprend la compétition là où il l’avait laissée ou presque. Trois matchs de championnat plus tard et un amical contre la Suisse, Paolo Rossi fait partie des vingt-deux Italiens pour la Coupe du monde en Espagne. Le monde entier allait finir par le savoir.

Bearzot le têtu
D’une certaine façon, le numéro 20 de la Squadra en a fini – ou presque – avec son pain noir, en dépit d’un premier tour fantomatique, où de Vigo à la Corogne, l’équipe nationale ne fait rien de bon. Dans un groupe 1 compact, tout le monde se tient. Après trois matchs nuls, l’Italie passe au deuxième tour au bénéfice des bus marqués (2 contre 1) aux dépens du Cameroun, derrière la Pologne. Quasiment toute l’histoire de la Nazionale en Coupe du monde peut se résumer à ces moments-là. Elle hérite donc d’un groupe impossible au deuxième tour : Argentine, Brésil et Italie, que des champions du monde. Toute la presse transalpine se demande encore comment ce vieux grognard de Causio (33 ans, aux fraises) peut être encore là, exige d’Enzo Bearzot, le directeur technique plutôt conservateur de la sélection, qu’il dégage Zoff (40 balais au moment des faits) au profit d’Ivano Bordon, le portier de l’Inter et enfin qu’il se débarrasse de Rossi, cet elfe diaphane qui campe sur la ligne de front.
Problème, Bearzot est têtu, voire obtus, et ne déteste rien plus qu’on lui dise ce qu’il doit faire. La suite allait lui donner raison. Comme en 1938 (vainqueur), en 1970 (finale), en 1994 (finale), voire dans une moindre mesure en 2006 (vainqueur), la tortue transalpine avance à pas comptés : chi va piano, va sano, va lontano. Elle commence par tordre l’Albiceleste de Kempès et Passarella (2-1) avec un traitement de cheval infligé par Gentile au Pibe de Oro. Pablito n’est pas encore sorti des marécages, mais il va mieux. Dino Zoff démontre qu’il n’est pas qu’un dinosaure. L’immense Gaetano Scirea, qui a relégué sur le banc le juvénile Franco Baresi, articule la toile d’araignée dans laquelle viennent se perdre les attaquants argentins avec ses collègues turinois (Gentile, Cabrini) et Collovati, son bras droit milanais. Il n’y a pas que des soutiers dans cette équipe ; au milieu, Bruno Conti et l’insaisissable Giancarlo Antognoni, le presque homonyme de Michelangelo Antonioni, le cinéaste incandescent de l’incommunicabilité, font des différences énormes.
Trois matchs et demi et un Ballon d’or
Au match suivant, c’est le Brésil de Zico, Sócrates, Toninho Cerezo, Falcao, Junior, à leur acmé, qui se presse devant la Nazionale. Rien de moins que la meilleure équipe du tournoi, et de loin. Les Italiens ont l’avantage de savoir qu’ils n’ont jamais rien obtenu dans la facilité ; dans cette Coupe du monde, comme depuis toujours. Un nul suffit aux Auriverdes. Sauf que cette Seleção, sans doute la meilleure de toutes celles qui n’ont pas été championnes du monde, se montre suffisante, veut punir la concurrence comme elle l’a fait depuis le début du Mondial. Ce 5 juillet 1982, ce serait la journée de Paolo Rossi, l’avant-centre létal par excellence qui préfigure tous les Inzaghi à venir, qui inscrirait trois buts d’avant-centre, what else ?, deux du droit, un de la tête. Antognoni en marquera bien un quatrième, mais il sera refusé pour un hors-jeu litigieux. Comme s’il était écrit que cet après-midi ensoleillé au stade de Sarria appartiendrait au natif de Prato pour toujours.
En demi-finales, la Pologne de Zbigniew Boniek (suspendu pour l’occasion) ne ferait pas le poids. Une rapine et un coup de chaudron sur un caviar de Conti et Rossi enverrait l’impitoyable Squadraen finale. Contre une RFA recuite par la demi-finale de Séville, la Nazionale ne laissera pas passer l’occasion de coudre une troisième étoile (1) au-dessus du cœur azzurro. Rossi ouvrira le score d’une tête plongeante après un centre vicelard de Gentile dans les six mètres. C’était la première fois que Karl-Heinz Förster, l’intraitable central de la Mannschaft et futur joueur de l’OM, concédait un but à son adversaire direct en quarante sélections. Tardelli et Altobelli saleraient ensuite l’addition. Le banni du Totonero du printemps 1980 deviendrait le héros de tout un pays. Cette année, le Juventinoraflerait tous les prix : meilleur joueur du Mondial, Soulier d’or (6 buts) et Ballon d’or en fin d’année, le tout en trois matchs et demi. « Je crois que j’ai bien fait de lui maintenir ma confiance », salivera au bout du compte Enzo Bearzot, en tirant sur sa bouffarde. Paolo Rossi sera ainsi Il ragazzo dell’82 pour l’éternité.

Pas de reconversion en tant qu’entraîneur
Cela ne le rendra pas plus expansif. Il n’aura rien oublié de toutes les critiques qu’il a dû endurer lors du Totonero et du premier tour en Espagne. Il demeurera jusqu’au bout une sorte de Greta Garbo en culottes courtes, drapé dans son silence, n’y contrevenant que pour quelques confidences polies et dénuées d’affects. Le temps joue pour lui. Il gagne enfin des titres avec la Juve, flanquée de ses six champions du monde et des capitaines des équipes classées troisième et quatrième (Boniek et Platini) : Coupe d’Italie 1983, Coupe des coupes 1984, Scudetto 1984, Supercoupe d’Europe 1984, Coupe d’Europe des clubs champions 1985 (finale en 1983)…. Après la finale du Heysel contre Liverpool, il quittera le club piémontais pour le Milan où il retrouve son président Farina. La suite ne sera qu’une litanie de blessures, d’abord en Lombardie, puis à Vérone. Il ajoutera une dernière cape, la quarante-huitième, juste avant le Mondial 1986, auquel il participera en restant sur le banc. Ses blessures auront raison de sa carrière.

Il quitte la scène en même temps que Platini, son aîné d’un an, au printemps 1987, à 31 ans (comme Cantona). Il ne sera pas entraîneur, ni même dirigeant d’un club professionnel. « Ce n’est pas pour moi tout cela. J’aime trop la vie pour continuer à stresser au quotidien. Il y a des choses plus essentielles dans l’existence », expliquera-t-il plus tard. Sa trajectoire tourmentée lui aura appris à relativiser, lui qui est passé en peu de temps du statut de paria à celui de héros national. Sa reconversion aura épousé quelques tours étonnants : investissements dans l’immobilier, président honoraire de Santa Lucia là où tout a commencé, consultant pour la RAI et Sky et même une candidature aux Européennes pour la très droitière Alleanza nazionale, la suite du MSI, une organisation d’extrême droite. La postérité, souvent amnésique, ne retiendra, elle, que ce parcours empreint de montagnes russes, comme Maradona ; cette carrière relativement courte (sept saisons pleines à tout casser), lui qui, enfant, admirait Kurt Hamrin, un Suédois qui finira à trente-huit ans dans son pays, après quinze ans en Italie. Surtout, les Italiens retiendront cette semaine dingo, du 5 au 11 juillet 1982, où en sept jours et trois matchs, il inscrit six buts. Pour cela et pour toujours, il restera « l’homme qui a fait pleurer le Brésil » ainsi que d’innombrables supporters de toute la planète de cette Seleção-là.

Par Rico Rizzitelli
(1) : en ce temps-là, les sélections attendaient d'avoir gagné trois Coupes du monde pour coudre des étoiles sur leur maillot.