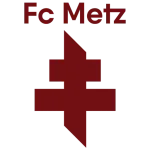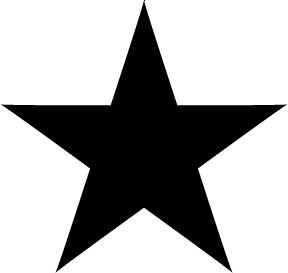- France
- Interview
Luc Sonor : « Je représentais la France, mais la Guadeloupe aussi… »

Émouvant, inspirant est le parcours de Luc Sonor. L’ancien international français, passé par Sedan, Metz ou encore Monaco, était réputé, et craint, pour son style rugueux. Dépaysement, racisme, abnégation, le Guadeloupéen a accepté la souffrance pour atteindre son objectif, son rêve.
Être guadeloupéen, qu’est-ce que ça signifie ?C’est une grande fierté, une richesse extraordinaire. On est français, mais on a la possibilité de vivre autre chose que ce que les métropolitains vivent. On a un diamant entre les mains. On a la chance de vivre sur une île extraordinaire. Il n’y a pas mieux que d’être antillais. On est né dans un paradis. Je resterai toujours guadeloupéen. Si j’ai fait ma carrière, c’est aussi pour les Guadeloupéens. Quand je portais le maillot de l’équipe de France, au moment de La Marseillaise, très souvent dans ma tête, j’avais presque l’impression de la chanter en créole. Je représentais la France, mais la Guadeloupe aussi.
Quels éléments ont contribué à votre réussite ?La première chose, c’est le fait qu’on soit venu me chercher aussi jeune en Guadeloupe. Je ne savais pas où j’allais, je n’avais jamais voyagé. Déjà, il faut que vous réussissiez parce que vos parents ont eu le courage de vous laisser partir sans savoir où vous alliez. Je leur dois toute ma carrière. Ils avaient dix enfants. J’étais l’avant-dernier, je n’avais même pas quatorze ans, j’allais à Sedan. Personne ne savait où c’était. Il fallait du courage pour laisser partir son fils comme ça. Il n’y avait pas de portables, ni internet. La deuxième chose était par rapport à tout ce que j’ai pu souffrir à Sedan. Tout n’est pas simple. On ne voit que l’aboutissement d’une carrière, mais il y a pas mal de sacrifices à faire, de souffrances à endurer. J’ai énormément souffert. J’avais très froid, j’étais seul. J’ai vécu des moments très difficiles. Il y avait un racisme à cette époque qui n’était pas simple à vivre pour un enfant, j’étais interne… Il n’y avait rien qui pouvait laisser penser qu’on puisse vivre un bonheur là-bas. Ma réussite, je la dois au fait que j’ai su m’accrocher à tout, m’endurcir, parce que c’est ce que j’aimais. J’aimais le football. À quatorze ans, je ne pouvais pas dire que j’allais être pro, mais le simple fait de jouer au foot, d’être en métropole, je représentais déjà la Guadeloupe. Je me mettais déjà dans la peau du Guadeloupéen qui avait réussi. J’avais franchi l’Atlantique.
Vous parliez de souffrances…Ce sont des choses qu’on ne peut pas oublier. Je suis arrivé à Charleville-Mézières. À l’école, j’ai été victime d’un racisme incroyable. J’étais un des seuls noirs à l’école. J’ai été battu, devant l’école, par de gros racistes, je suis resté six jours à l’hôpital. On m’a mis nu dans la neige. J’en ai bavé. J’ai dû aussi passer par des moments difficiles parce que je ne savais où loger, j’ai dû vivre dans une petite cave de même pas dix mètres carrés. Il n’y avait pas de chauffage. Il n’y avait absolument rien. Tout cela, je l’ai enduré parce que je ne voulais pas le dire à mes parents. Ils n’étaient pas au courant. Si je leur disais, ils allaient me faire rentrer, et la carrière, j’aurais dû l’oublier, oublier le football. Je leur ai caché pendant des années. Je voulais réussir. S’il y avait des choses à endurer, j’étais prêt à les endurer. Il m’est arrivé de faire du stop pour aller à l’entraînement, il faisait très froid. J’ai même fait du stop pour aller jouer le dimanche matin en jeune. J’ai dû passer par ça, subir tout ça.
Tout ce que vous avez enduré se matérialisait dans votre style, rugueux.Bien sûr. Je m’en suis servi pour y arriver. Ça m’a forgé un caractère. Ça m’a montré que dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, si tu n’as pas la combativité, cette rage de vaincre, tu n’y arrives pas. Bien entendu, après on m’a taxé de joueur rugueux, presque dangereux. Je n’étais pas dangereux non plus. Je n’ai jamais cassé une jambe, je n’ai jamais blessé quelqu’un. J’avais envie d’être respecté. Petit, je n’avais jamais pu le faire, donc ma première pensée lorsque j’étais sur le terrain, c’était : « Fais-toi respecter. »
Pourtant, il est tentant de convertir ce désir en violence.Je voulais être la fierté de mes parents. Je voulais vaincre sans pour autant y mettre de la méchanceté. Je voulais mettre de la rigueur, il en faut quand on joue, quel que soit le poste. C’est tout. Je n’avais pas de rage en moi. J’avais juste cette envie de revanche, montrer que malgré tout ce que j’ai pu vivre, j’ai réussi. J’ai surmonté tout ça.
Pourquoi avoir quitté Sedan pour Metz ?À Sedan, j’ai eu la chance de connaître M. Charlot qui, malheureusement, n’est plus de ce monde. C’est lui qui m’avait repéré. À Sedan, j’étais l’un des seuls internationaux minimes et dans les autres catégories de jeunes. Un jour, il m’a dit : « Sedan, ce n’est pas assez fort pour toi, il faut qu’on t’emmène dans un club plus huppé. » Il m’a donc emmené faire des stages, des détections partout. On est allés à Lyon : j’ai été refusé, puis Monaco : refusé. Bordeaux : refusé. Nice : refusé. Six clubs m’ont recalé, quand même ! Puis on est allés à Metz. Je m’en rappellerai toujours, j’avais quinze ans et demi. On me fait disputer un match sur un terrain rouge, gelé. Sur le premier ballon reçu, retourné, but. Là, l’entraîneur du centre, qui était à l’époque Marcel Husson, me lance : « Tu sors, petit. » Je me suis dit : « Encore une fois je suis recalé, c’est fini. » Hé non ! Metz me voulait. J’ai eu cette chance. Je crois qu’ils m’ont acheté 50 000 francs. Je n’oublierai jamais le geste de mon père. Il a donné cet argent à mon tuteur, M. Charlot. Il avait pris soin de moi. J’ai adoré ce geste. C’était remarquable, remarquable !
Racontez-nous ce fameux périple en Coupe de France en 1984 avec Metz. Vous n’étiez plus payés depuis quatre mois. C’était la crise sidérurgique en Lorraine.Gagner une Coupe de France sans être payé depuis plus de trois mois, en arrivant comme des clochards au stade avec des survets qu’on nous avait achetés, face aux Monégasques pour reprendre Maître Gims sapés comme jamais, très classe, vous vous dites : « Ce n’est pas possible. On va souffrir ! » Eh non ! En même temps, je me suis dit : « Luc, il y a de gros problèmes sidérurgiques à Metz, les gens n’ont pas le sourire depuis très longtemps. » C’était d’une tristesse… Pourtant, Metz est une ville géniale, il y a de la vie, de l’ambiance. Ça faisait deux, trois mois que les gens étaient en souffrance. Ils ne riaient plus, c’était sombre, atroce. On s’est dit : « Si quelqu’un peut redonner le sourire à cette région, c’est bien nous, mais pour ça, il faut battre Monaco. » Et le discours d’avant-match était axé là-dessus. À l’origine, j’étais remplaçant, mais Philippe Thys s’est blessé au bout d’un quart d’heure. Je l’ai remplacé et j’ai pu vivre ce bonheur avec tout le monde. De toute ma vie, jamais je n’oublierai ce qu’on a réussi. Vous gagnez une Coupe de France, vous n’avez pas de prime de match, ni salaire. Tout ça, toute la sueur qu’on a déversé a été récompensée par le sourire des gens. On a fait revivre une région ! Tout le monde nous attendait. C’était presque un carnaval. Les problèmes se sont arrangés petit à petit. Les gens nous « idolâtrent » par rapport à ça. Pendant quinze jours, on avait l’impression de re-gagner la Coupe.
Cette victoire face au Barça 4-1 au Camp Nou après une défaite 4-2 à l’aller, ça reste un immense souvenir, non ?Lorsqu’on apprend qu’on tombe sur Barcelone, je suis blessé, Marcel Husson me dit : « Quoi qu’il arrive, Luc, il faut que tu joues. » Je dis : « Coach, je ne sais pas, j’ai une blessure sérieuse. » J’avais deux mois et demi pour récupérer. On est en stage, on rigole tous en disant : « Aïe, aïe, aïe, on va prendre une volée, se ramasser ! » Mais on se dit aussi : « On va peut-être perdre, mais ne passons pas pour des cons auprès de la France. Il faut qu’on perde avec les honneurs, mais qu’on donne le maximum. » Quand je vous dis ça, on est deux mois et demi avant. Ensuite, il y ce fameux match, on joue d’abord chez nous. Marcel Husson me fait jouer, j’avais repris depuis dix jours. Premier ballon, je marque contre mon camp. J’ai fait venir mon père, ma mère, il y a tout le monde dans les tribunes… Vous imaginez un peu le stade blindé, on attend ce match avec impatience et la seule chose que je trouve à faire, c’est une passe en retrait mal ajustée, Michel Ettorre est battu. 1-0 pour Barcelone.
À ce moment-là, qu’est-ce que vous ressentez ? « Punaise, je n’aurais jamais dû jouer. Je n’aurais pas dû être rétabli. (Rires) Je suis en train d’enfoncer mon équipe, j’ai les boules. » On était une bande de copains, de potes, on mangeait ensemble, faisions des karaokés ensemble, notre vie était extraordinaire à Metz. Et puis on en prend deux, trois, et puis il y a un but contre son camp d’un joueur de Barcelone, ce fameux penalty de Jean-Philippe Rohr. Il marque, juste à la fin. 4-2. On se dit : « On va aller là-bas pour le match retour, ce n’est même pas la peine. » Marcel Husson dit : « Les gars, on va emmener les femmes, tout le monde, on va faire les touristes et puis advienne que pourra. On va faire le maximum, on n’est pas les favoris, personne ne nous attend, on s’en fout. » On avait été hyper vexé parce aucune télé, aucune radio n’avaient retransmis ce match. Personne n’était venus, on nous avait pris pour des cons. On est partis l’avant-veille à Barcelone, on voulait être tranquilles. Dans l’hôtel, il y avait Yannick Noah, Henri Leconte. Le soir, on déconnait, on s’en foutait. Lorsqu’on est entrés sur le terrain, je me souviens de nos têtes, nous n’étions pas du tout stressés. On avait presque un petit sourire en coin. Mais on prend un but très vite par Carrasco. Derrière, un Barcelonais marque contre son camp. 1-1, 1-2, 1-3. À un moment, on se dit : « Ce n’est pas possible. » « Mais les gars, si on en met un 4e, on est qualifiés ! » Tout le monde se regarde alors. Mais il faut pouvoir le mettre, et puis on se dit : « Comment va-t-on faire pour ne pas en prendre un non plus. » Entre-temps, je me re-blesse à la cuisse et sors du terrain. Et il y a ce quatrième but. Jules Bocandé, mon ami, paix à son âme d’ailleurs, qui me manque énormément, fait un exploit formidable et sert Tony Kurbos pour le quatrième but. On est, à ce moment-là, qualifiés. Mais on ne réagit pas encore. Fin du match, on se félicite. Ce qui m’a marqué, c’est la haie d’honneur des Barcelonais. Schuster avait promis : « Si jamais cette équipe-là nous élimine, j’offre un jambon à tout le monde. » Il l’a fait. Une fois dans le vestiaire, on ne réalise pas tout de suite. Il nous faut cinq, six minutes, on récupère. On commence à chanter, danser… mais le pire, c’était l’arrivée à l’aéroport de Frescaty à Metz. Je n’avais jamais vu ça. Il y a eu la Coupe de France, ça derrière, c’est comme si on avait déjà gagné la Coupe d’Europe. Le monde à l’aéroport, partout sur la route, sensationnel ! Metz est un club qui me tient énormément à cœur, que j’aime et que j’aimerai toujours. J’aime les Messins, la Lorraine, ça fait partie de ma vie.
Vous quittez Metz en 1986. Vous ne vouliez pas signer à Monaco, mais au Racing, jusqu’à ce qu’Arsène Wenger ne vous convainque : « Non seulement tu vas jouer à ton poste, mais je vais faire de toi un international. » C’est quand même extraordinaire. Je voulais absolument venir à Paris. Dans ma tête, c’était le Racing. Vu les propositions financières qu’ils me faisaient, c’était difficile à refuser. Jusqu’au jour où je reçois un coup de fil d’Arsène, jeune entraîneur de Nancy, qui va descendre en D2. Il m’annonce que, dans un an, il va à Monaco et qu’il faut que je vienne dès maintenant. Je lui réponds : « Comment puis-je te faire confiance ? » Je n’ai pas envie d’y aller. En plus, j’apprends que Kovács va entraîner l’année où j’arrive en 86. J’ai beaucoup de respect pour lui, mais je regarde le recrutement, je le trouve bizarre. Il me fera jouer stoppeur plutôt que latéral. Je n’étais pas bien, mais je pensais à cette phrase d’Arsène Wenger : « Attends-moi, j’arrive dans un an, non seulement tu vas jouer à ton poste, mais je vais faire de toi un international. » C’est exactement ce qu’il s’est passé. En plus, j’ai eu la chance d’être champion dès la première année ! C’est un monsieur, Arsène, quelqu’un à qui je voue une admiration sans faille. C’est un homme de parole, de convictions, il a la classe. Il m’a traité de façon extraordinaire. Il m’a énormément aidé. Sincèrement, quand il est arrivé, je n’étais pas en bon état. Kovács s’en fichait complètement que je sois latéral. Je ne sais même pas s’il me connaissait, d’ailleurs. Il ne voyait que par les internationaux. Il me fait jouer stoppeur, et encore, parce que le titulaire n’amenait pas ce qu’il voulait au départ. Lorsqu’Arsène est arrivé à Monaco, ma vie a changé.
Vous êtes champion de champion de France en 1988. Quels sont les ingrédients du succès ?Le recrutement. On avait une équipe de qualité, des internationaux, des joueurs d’expérience : Battiston, Amoros, Dominique Bijotat qui était en pleine forme à cette période, Daniel Bravo, les deux Anglais que personne n’attendait. Ils sont arrivés à Monaco, même moi, je disais : « On fait venir des Anglais en France et on me parle d’ambition ? » Il n’y avait à l’époque pas d’Anglais qui venaient en France ou ailleurs. Ils ne s’exilaient pas trop. Et puis, Arsène Wenger nous ramène Mark Hateley et Glenn Hoddle. Deux super joueurs. Glen Hoddle est l’un des plus grands phénomènes avec qui j’ai joué. Un phénomène technique, quelle classe ! Arsène Wenger a su réunir tout ce monde, faire l’équipe type. Il ne changeait pas beaucoup son équipe. On avait Claude Puel, Marcel Dib qui étaient en pleine forme. On a été champions très tôt, car notre jeu était beaucoup porté vers l’attaque. On a mis un bon mois et demi à comprendre ce que voulait Arsène. Mais lui, c’était le travail, l’abnégation et puis surtout quand le mec vous expliquait une tactique, en deux secondes vous l’aviez comprise. Il nous a ressoudés, nous a appris à vivre en communauté, nous suggérait de sortir, d’aller manger ensemble et puis il avait une hygiène de vie hors du commun. Quand il est arrivé, ça nous a fait drôle. Dans les pâtes, il n’y avait plus de beurre. Il fallait boire de l’eau, il faisait attention à tout. « Ce sont les petits détails qui font les grands joueurs » , disait-il souvent. Il a raison. Il était très porté sur la diététique. Il n’y a qu’à voir comme il est. Il est long et sec. À chaque fois, on lui disait : « Mais ce n’est pas possible, tu ne grossiras jamais, toi. » Il a su nous inculquer cette hygiène et de vie et on ne le remerciera jamais assez pour ça.
Par Flavien Bories