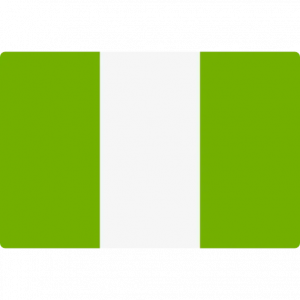- Pagaday
- Anniversaire de Paganelli
- Interview
Laurent Paganelli : « Je suis resté dans un trou noir »

Le 25 août 1978, Paganelli remplace Rocheteau à la mi-temps du match PSG Saint-Étienne. À quinze ans, dix mois et cinq jours, le Petit Mozart devient le plus jeune joueur à fouler une pelouse de première division, record qu’il détient encore aujourd’hui. Si ces débuts précoces peuvent laisser présager une belle et longue carrière, il n’en est rien. Presque quarante ans plus tard, l’ancien ailier en reste meurtri.
Laurent, tu détiens encore le record du plus jeune joueur à avoir foulé une pelouse de première division. Qu’est-ce que tu ressens lorsque tu y repenses ? C’était quelque chose d’extraordinaire, d’irréel, d’inattendu, que j’ai vécu à fond, avec un plaisir intense, sans penser aux conséquences. C’est un peu moi, ça. Mais avec le temps, tu te dis : « Putain ! Ce n’était peut-être pas le bon moment, la bonne période. » Peut-être que ça m’a déboussolé. Finalement, ça n’a pas peut-être pas été la meilleure des choses. Peut-être que les gens autour de moi n’ont pas compris qu’à quinze ans et demi, c’était juste une passe et pas une finalité de carrière. C’était trop tôt, trop tôt.
Quel genre de joueur étais-tu ? Ce n’est pas compliqué (rires) !
Tu prends une cour de récréation, tu y mets un joueur au milieu qui fait ce qu’il a envie, comme il a envie. C’est un gros souci pour les gens qui te gèrent, mais c’est un plaisir pour toi-même. J’étais un joueur de passion, de plaisir, d’improvisation, d’insouciance, de risques. Je voulais marquer des buts, tenter des choses. J’étais ce joueur-là, très indiscipliné, mais qui vivait par le plaisir, la joie. Entendre le bruit des filets… J’étais un joueur libre dans sa tête, libre avec ses pieds.
Un joueur dans lequel tu te reconnais ?J’étais un peu comme Eden Hazard, Ribéry ou Ben Arfa. Un mélange de tout ça, mais ils ont peut-être, sûrement, plus de talent que moi. Ces trois joueurs se ressemblent et ont quand même quelque part un problème de gestion. Tu es dans un monde peut-être inadapté à ce que tu es ou c’est peut-être toi qui n’es pas adapté pour ce monde. Ben Arfa, Ribéry, Hazard… Même si Hazard a un peu plus de réflexion.
Comment ton rapport au football s’est-il développé ?Déjà, je n’étais pas voué et je n’ai jamais eu dans ma tête la vocation à faire une carrière de footballeur. J’ai toujours été incité, que ce soit par mes entraîneurs ou par moi-même, à garder la liberté d’être ce que j’étais, alors que le football demande, à un certain moment, une réflexion, que ce soit tactique, de recadrage, de discipline, de comportement. Mais à mon époque, on ne se préparait pas à tout ça. On était un peu comme Obélix, plongé dans la potion magique, et du jour au lendemain, tu débarques, tu es footballeur professionnel. Je collais les images Panini. À aucun moment, je ne me suis dit qu’un jour je serais sur ces mêmes images. Quelque part, je n’étais pas préparé à l’environnement et à une carrière de footballeur. On pensait que c’était irréalisable, que c’était pour les autres. On se limitait à notre club, notre ville, notre cour de récréation, à notre quartier.
Quel métier voulais-tu faire ?Je ne sais pas (rires). On n’était jamais dans la projection dans le futur. On vivait toujours le moment présent. C’est un peu notre époque qui voulait ça. On n’était pas carriéristes. On était comme ça et il fallait nous prendre comme on était. C’est une fois dans les clubs que les mecs se rendaient compte de ce qu’on était et de ce qu’il fallait faire de nous. Pour mon cas, je pense que le chemin était trop grand pour les entraîneurs.
Justement, Di Meco, sur RMC, disait que tu « étais trop pur et trop original pour ce milieu » .
Dans le foot, ce que j’aimais avant tout, c’était prendre du plaisir. Le football, cette pureté, c’était tout ce dont je rêvais, tout ce que j’imaginais, tout ce que j’aimais faire avec le ballon. Cette vocation à construire, à être ingénieux dans tout ce que je faisais, tenter de jour en jour des choses qui étaient inenvisageables pour un entraîneur.
Si on dribblait trois mecs la veille, il fallait en dribbler quatre le lendemain. Pareil pour les petits ponts. J’aimais ça. Je ne vivais que pour ça. À la récré, je faisais du foot. Quand je rentrais chez moi, je ne faisais pas mes devoirs, mais tapais avec le ballon contre le mur. Mon enfance, je ne l’ai liée qu’au foot. Le ballon, le ballon, toujours le ballon. Mais pas le ballon qu’il fallait récupérer, qu’il fallait aller chercher, pas l’effort qu’il fallait faire. Mon originalité vient plutôt de ma nature. J’aime ce qui est différent. Je ne rentre pas dans le moule. Lorsqu’on est différent, c’est très difficile de se faire accepter. J’étais trop différent. À l’entraînement je mettais une chaussette jaune et une verte. J’étais différent dans mon comportement, dans ma façon de penser et de voir les choses. Je crois que c’était dans mes gènes. Mais ça n’allait jamais à l’encontre des camarades, de l’adversaire ou de l’arbitre.
C’était une conception assez brésilienne du football.J’ai appelé mon fils Junior en référence à un ancien joueur brésilien. Le Brésil, c’était le foot sur la plage, l’utilisation du ballon en permanence, tenter des choses, voir du spectacle. J’ai toujours considéré le foot comme un spectacle, pas comme une corvée ou de la rigueur. Tout ce qui se dégage de ce côté Brésil, c’est ce plaisir. Même le gars le plus rigoureux du monde se fera un plaisir de voir un Brésilien faire trois petits ponts, deux sombreros, un grand pont, se mettre à genoux quand il marque… Pour moi, le Brésilien, comme l’Africain, dégage du plaisir et du bonheur pour lui-même et pour les autres, et amener du bonheur aux autres a toujours été ma vocation. Je me disais toujours : « Putain, les mecs viennent au stade, ils veulent voir des trucs, voir des gens heureux, marquer des buts, s’embrasser, faire des gestes avec ou sans ballon. » Les Brésiliens que j’ai connus ne jouaient qu’au Brésil. Malheureusement, ils se sont un peu transformés parce qu’ils viennent en Europe. À mon époque, on refaisait les mimiques de Sócrates et Zico. On avait ça dans le sang. On était brésilien, africain dans l’âme.
Dans un entretien accordé àFootengo42, tu déclarais : « Avoir été encensé comme je l’ai été, puis descendu aussi violemment[…]j’ai morflé et j’en garde encore une cicatrice intérieure profonde. » C’est vrai. Je suis quelqu’un d’intérieurement très émotif. Moi, je n’ai rien demandé. Je n’ai pas demandé qu’on m’encense, donc j’ai très mal compris qu’on me descende. Je n’ai jamais dit : « Je serai un grand joueur » ou « Je ferai une grande carrière » . Un moment, je me suis retrouvé dans une spirale de jugements, de réflexions. C’est vrai que ça, je n’ai jamais pu l’emmagasiner. Ces cicatrices intérieures…
Je te jure, parfois je rêve la nuit que je m’engueule avec Herbin. Enfin, ce n’est pas que je m’engueule, mais je ne comprends pas, je n’ai pas de réponse. Ce qui m’a fait le plus souffrir, c’est que je n’ai jamais eu de réponses d’Herbin sur cette période-là. Je n’ai jamais eu quelqu’un pour me dire : « Ce que tu vis est normal, logique, il faut faire ça, il faut comprendre ça. » Le jour où Herbin ne m’a plus fait jouer sans m’expliquer, que la presse m’a descendu, enfin ce n’est pas le mot, mais a dit que je n’étais pas bon. Le fait que je ne correspondais au football professionnel, je le comprends très bien. La chose qui m’a embêté, c’est de ne pas avoir de réponse. J’ai toujours rêvé qu’Herbin me téléphone et me dise : « On a manqué ça, on a raté ça. » Mais tu sais, je n’en veux à personne. Je regrette simplement qu’à un moment donné, les gens fassent une démarche pour venir chercher des jeunes… On n’a que quinze ans ! On ne peut pas connaître à cet âge la marge de progression du joueur. Je regrette simplement que les gens n’aillent pas au bout des choses, comme avec Hatem Ben Arfa. Ce n’est pas parce que le mec a du talent qu’il comprend tout ce qu’il se passe autour de lui. C’est ça qui m’a le plus emmerdé. Une simple discussion de cinq minutes avec les personnes qu’il fallait et les problèmes étaient résolus. Et moi, depuis tout ce temps, je suis resté dans un trou noir et n’en suis jamais ressorti. D’ailleurs, ça m’influence dans mon travail. Ça a modifié ma nature, mon comportement, ma réflexion… j’en souffre encore.
Quelle question aimerais-tu poser à Robert Herbin ? « Pourquoi à un moment tu m’as laissé tomber ? » On ne parle pas de foot, mais de rapports humains. Il peut me répondre : « Pour savoir comment tu allais réagir dans le dur. » Mais je pense que tu ne peux pas agir de cette façon avec tout le monde. Pourtant, si je n’avais pas eu autant d’amour pour Robert Herbin, je ne demanderais pas cette réponse. C’est quelqu’un que j’admire. Mais peut-être qu’il n’a pas la réponse, peut-être qu’il ne s’est pas rendu compte. Peut-être que ce n’était pas le meilleur moment de sa vie non plus. Mais c’est vrai que ça m’a (il souffle)… je te jure, je suis passé d’un joueur qui avait des capacités, « de talent » , à un joueur quelconque, en l’espace de 90 minutes.
Quel match ?Je joue un match où ça se passe super bien, c’était en huitièmes de Coupe d’Europe, en mars 1981. On joue la rencontre suivante le mercredi contre Ipswich. Le samedi, Michel Hidalgo, le sélectionneur de l’équipe de France, a appellé Robert Herbin pour lui dire : « Je prends Paga en équipe de France pour jouer les Pays-Bas. » Herbin a refusé. Il a pris la décision seul, sans m’en parler. Contre Ipswich, on perd 4-1.
Il reste le match retour, plus huit ou neuf rencontres de championnat et là, il ne me parle plus, ne m’aligne plus. C’était hard. On perd chez nous et je suis le seul joueur écarté jusqu’à la fin de saison. J’avais dix-huit ans. Depuis ce jour-là, d’ailleurs, plus un mot. Plus rien. Je suis toujours là, et ma vie footballistique s’est arrêtée à ce moment-là. Je n’ai jamais eu le caractère pour remonter. C’est comme une droite de Tyson, tu ne t’en remets jamais. Et puis cette année, on termine meilleure attaque, champion et il recrute, je crois, trois attaquants à l’intersaison. C’est une situation aberrante. En 2016, il n’y aurait pas de soucis. On peut changer de club facilement. Mais à l’époque, si tu étais lié huit ans avec un club, tu y restais. J’étais dans les 28 pour la Coupe du monde en 1982. La plus grosse punition qu’on pouvait m’infliger était de ne pas jouer et comme j’ai un caractère à la con, je pense que je me suis braqué. J’ai aussi ma part de responsabilités.
Tu ne veux pas aller le voir pour discuter ?Non. Je pense que ma souffrance, il la connaît puisque c’est lui qui l’a provoquée.
Ça pourrait quand même te libérer.Tu as raison. Quand tu as une relation père-fils, tu attends que la démarche vienne du père, mais quand elle ne vient pas, la logique c’est qu’à un moment, l’enfant se rapproche, mais je crois que je n’en ai jamais eu le courage. Et puis à l’époque, on n’osait pas élever la voix, aller à l’encontre des parents, contredire quelqu’un de plus vieux. Tu sais, Herbin, je le vouvoyais. Pour nous, c’était une montagne. On ne pouvait pas dire : « Hey pourquoi tu ne me fais pas jouer ? » On n’est pas dans le monde d’aujourd’hui. Tu devais presque prendre rendez-vous pour lui parler. Mais c’est ma vérité à moi, pas forcément la sienne, c’est ce que j’ai ressenti, ce que j’ai vécu. Peut-être que je me trompe. Je n’accuse personne, mais il manque un truc.
Qu’est-ce que tout ça a changé entre le Paga insouciant et celui d’aujourd’hui ?Ça m’a marqué énormément. J’en ai même souffert maladivement et après, dans le travail, dans la vie de tous les jours, j’ai toujours réussi à être moi-même lorsqu’il le fallait. C’était ma survie. Si je ne pouvais pas être au top 24h/24h, il fallait au moins que je le sois 4h, 5h par jour, quand je suis avec mes amis, ma famille ou dans mon travail. Je me suis toujours battu pour ça. Pour que mes amis, ma famille ou mes collègues de travail ne le ressentent pas. En revanche à certains moments où tu es seul, tu subis, c’est quelque chose d’intérieur que tu ne peux pas évacuer comme ça. Mais l’important, c’est d’avoir des gens pour s’entourer.
Tu es né le 20 octobre 1962 à Aubenas, c’était comment la vie chez les Paganelli ?(Rires) Écoute, j’avais trois frères qui étaient joueurs de rugby. Mon père était fan, j’avais vu quatre cents matchs, mais jamais un seul de foot. On m’appelait le pingouin dans la famille. J’étais voué à jouer au rugby, mais je m’étais cassé le bras. Pendant cette période, j’allais jouer au foot, c’est ce qui m’a dirigé vers ce sport. Mon père travaillait à la SNCF, ma mère était femme au foyer. C’était une vraie vie de quartier comme on aime les vivre. Toujours heureux quelle que soit la situation, toujours avec un ballon à la main. Mes parents m’ont toujours laissé grandir dans ce que j’aimais. La vie n’était pas facile tous les jours, mais c’était la joie permanente.
Quel type d’éducation as-tu reçue ?J’ai reçu deux éducations : celle de mes parents et celle du foot qui se reliaient plus ou moins. Mes parents avaient quatre enfants, donc il fallait qu’il y ait quand même de la discipline. Travaillant à la SNCF, mon père n’était pas toujours là. Il fallait de l’autodiscipline.
Le plus grand s’occupait du moyen jusqu’au plus petit. Les valeurs de la vie, je les ai apprises au foot. Quand je vois les problèmes de racisme et tout ce qui se passe… Nous, en Avignon, on était tous mélangés. On dormait chez les uns, chez les autres, chez l’Africain, chez l’Algérien, chez le Marocain, chez le Français. Le foot nous apprenait le combat, la discipline le respect de l’adversaire, le respect des règles, du coéquipier. On n’était pas les enfants les plus responsables du monde, on était capables de piquer des mobylettes, de se battre dans la rue de temps en temps, mais à côté de ça, on avait beaucoup de respect pour l’environnement. Si une vieille dame avait besoin qu’on l’aide à traverser, on le faisait. Si on devait faire la vaisselle, on le faisait. Mais bon, on signait le carnet de correspondance à la place de nos parents (rires). Pendant les cours, je sortais par la fenêtre et puis j’allais jouer au ballon. C’était la vie rêvée, mais ce n’était pas une vie d’argent. On était tous habillés avec les mêmes chaussures à la con. On était contents, on s’en foutait. La maison des jeunes et de la culture, le club de foot étaient nos deuxièmes maisons. J’aimais vraiment ça et j’en suis parti trop tôt.
Tu t’es révélé au football français lors du Tournoi de Montaigu en 1978.Tout s’est fait en trois semaines. À l’époque, tu passais par la sélection Rhône Durance, puis tu étais recruté pour aller disputer les inter-ligues avec la Méditerranée à Vichy. Il retenait à la fin de la compétition une équipe de seize mecs pour aller faire le tournoi de Montaigu. On l’a gagné. Il était télévisé. Dès le lendemain dans le train pour rentrer, les recruteurs étaient déjà là, c’était le début des centres de formation. C’est là que ça a commencé à basculer. À Montaigu, je crois que j’ai fini meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi. Je n’ai même pas choisi le club où j’allais. Je ne savais même pas placer Saint-Étienne sur une carte. C’est mon éducateur qui a choisi pour moi. Mais si je pouvais faire du foot tous les jours, je n’allais pas m’en priver.
Tu es donc convoqué le 25 août 1978 avec l’équipe première de Saint-Étienne. Qu’est-ce que tu as ressenti ?C’est un concours de circonstances. Ils ont pas mal de blessés. Il leur manque des joueurs, alors j’ai participé lors d’un entraînement à un jeu de têtes. J’ai été très bon ce jour-là. Herbin m’a dit : « Je te prends. »
Je l’ai vécu dans l’insouciance. C’était pour aller voir. Je n’étais même pas censé jouer. D’ailleurs, ça a été un calvaire pour moi. Se retrouver là à quinze ans. Il y a quand même le déplacement, la préparation. Je n’attendais qu’une chose : m’habiller dans les vestiaires, entrer sur le terrain, vivre ça, rentrer chez moi, me glisser dans mon lit. C’était Koh Lanta, cette journée. J’étais entouré d’adultes. Ça faisait un mois que j’étais arrivé. C’était une épreuve de force. Et puis Dominique Rocheteau se blesse à la mi-temps. Je pense qu’il a fait exprès pour que je joue. Ça a toujours été un seigneur (rires). On me dit : « Tu entres, tu vas jouer. » Je fais trois, quatre accélérations, j’y vais. Mais ça me fait tout drôle. Quarante-cinq minutes après, j’ai compris que j’avais encore du chemin à faire. (Rires) J’ai vraiment été confronté à la réalité. Il fallait que je passe du stade d’enfant à adulte et de footballeur amateur à celui de professionnel. À la fin du match, Herbin m’a appelé, on s’est assis sur le banc et il m’a parlé pendant dix minutes.
Qu’est-ce qu’il t’a dit ?Qu’il fallait que je comprenne que je devais évoluer dans tout ce que je faisais, dans mon travail de tous les jours. Il m’avait fait jouer pour que je comprenne la distance qu’il y avait encore à franchir pour arriver à ce monde-là. C’est un peu du hasard si je me suis retrouvé là. D’ailleurs, après ce match, je n’ai rejoué avec les pros qu’un an et demi plus tard. J’avais dix-sept ans et des poussières.
Oui, l’année du titre. Tu joues une grosse partie de la saison avant, comme tu l’as expliqué tout à l’heure, d’être écarté.On avait une superbe équipe. Il comptait beaucoup sur Laurent Roussey et moi. Platini voulait jouer avec des jeunes. Pendant un an et demi, j’ai travaillé pour être prêt en 81. Je savais que le moment où je remettrais les pieds en première division, ce serait le bon et que me repiquer la place serait difficile.
Justement, Laurent Roussey et toi avez un parcours assez similaire.On nous décrivait au départ comme des enfants surdoués, mais on a travaillé dur ensemble, sur le plan physique, technique, moral, tactique. On s’investissait vraiment, on n’a jamais été dans la légèreté, malgré tout ce que j’ai pu dire jusqu’à présent. Je me suis toujours comporté en professionnel. Là où nos parcours différent, c’est que lui a eu une cassure physique quand la mienne était morale. Mais pour moi, Laurent était le plus doué de sa génération. C’était un très, très, très grand joueur, dans tous les domaines. Physique, puissant, adroit des pieds ou de la tête, un des meilleurs attaquant du monde. Malgré notre travail, nous n’avons pas su remonter après être descendus. On était prêts à tout sauf à ça.
Après Sainté, tu rejoins le Toulon de Rolland Courbis.Attention, pour en revenir à Saint-Étienne, j’aurais aimé faire toute ma carrière là-bas, j’y serais resté toute ma vie, mais il y avait eu des problèmes de caisse noire et tout le monde est parti.
Mais je te promets sur la tête de mes gosses, si j’avais pu y rester… c’est une ville extraordinaire. Ils vivent le foot comme pratiquement nulle part ailleurs. Il ne faut pas oublier que notre génération était championne de France de D3. On avait de quoi tenir sept ou huit ans le haut de tableau en D1. On avait une génération de folie. À Toulon, il y a eu des bonnes périodes, j’étais pratiquement rappelé en équipe de France, si je n’avais pas eu une blessure. J’ai le souvenir d’un Rolland Courbis au sommet de son art. J’ai joué avec de grands leaders : Dupraz, Onnis, Emon, Dalger, Olmeta, Casoni, Marsiglia… Il y avait une solidarité hors du commun. C’était du lourd.
Tu signes à Grenoble, mais tu y joues très peu. La perte de ton frère t’a beaucoup miné.J’ai fait venir mon frère à Toulon et il s’est tué sur la route à moto. Je l’ai très mal vécu personnellement. J’ai signé à Grenoble, j’avais un contrat de quatre ans, mais je suis parti. Ce n’était pas possible. J’ai pris du recul pendant un an et demi, j’ai culpabilisé. Après, j’ai rejoué une année en Avignon, un club que je remercie. J’en avais besoin, c’était génial. Le foot était ma survie et m’a permis de sortir la tête de l’eau. Et puis derrière, Canal m’a permis de vivre de ma passion. Lorsque j’ai arrêté le foot, je n’avais rien. À l’origine, je n’étais pas vraiment là par ma volonté, mais un copain avait insisté pour qu’on m’essaie. Je ne remercierai jamais assez Canal et c’est pour ça que je lui reste fidèle. Quand ils m’ont fait démarrer, j’avais deux enfants, ma femme. On était en difficulté financière, en difficulté dans tous les domaines. J’ai repris du plaisir dans un domaine que j’aimais et j’ai pu permettre à ma famille d’exister et d’avoir un équilibre. C’était génial.
Pour ta première, il y a eu une coupure de trente minutes.Oui, c’était mon premier match, Nice-Lille. Je pensais que ce serait le premier et le dernier. J’avais un trac pas possible. Il y a eu une coupure de courant. Il a fallu faire de l’animation, de la radio, aller voir les uns, les autres, ça m’a plu et à la chaîne aussi. C’était génial, même si Charles Bietry m’a dit qu’il fallait que je travaille un peu plus, que je sois un peu plus carré. J’ai mis deux, trois ans avant de faire les matchs de 21h. Il a fallu apprendre, travailler. Par rapport à ce qu’on peut penser, c’est un travail quotidien.
Lorsque tu interviewes un joueur, on a l’impression que tu veux le rassurer, lui montrer que tu viens du monde du foot comme lui.Oui. Moi, je n’interviewe pas, je poursuis une conversation. Quand les mecs arrivent, il y a toujours peut-être vingt secondes avant l’antenne. Mon entrée en matière n’est pas agressive.
Il faut rassurer les gars, leur montrer qu’ils ne sont pas en danger. Autant, après le match, à tête reposée… mais là, on est à chaud. Ce n’est pas facile de faire une analyse à chaud, de ne pas se planter. Tu peux dire les choses maladroitement. Je tiens toujours à les rassurer et non à les piéger. Ce n’est pas le moment. J’ai discuté avec Paul Baysse après Nice-Lyon. C’est dommage qu’on ne se soit pas retrouvé avec Nabil Fekir pour une vraie conversation entre footeux, pour parler concrètement de la situation. J’aime que ça parle foot.
Les interviews qui t’ont le plus marqué ?Une chose est sûre, avec les grands joueurs, tu n’as jamais de problèmes. Ils te disent toujours oui. Il y a eu Eto’o, Zidane, Ronaldinho… la plupart de ces mecs-là, c’est la classe. Tu as une appréhension énorme, et lorsque tu es avec eux, ils te rassurent. Une fois, j’ai fait un truc aberrant. Mourinho est en demi-finale contre la Corogne. Il fait 0-0 là-bas et Canal me dit : il faut l’interviewer. Lorsqu’il arrive, on me dit : « On rend l’antenne, on ne peut pas le faire. » Là, je dis au cameraman : « Tu ne bouges pas, tu laisses ta caméra allumée, et l’interview, on la fait en direct, enfin comme si on était en direct. » Là, vraiment, j’ai eu un trac pas possible. Le Mourinho de l’époque est le même qu’aujourd’hui, avec une classe pas possible. Il fallait quand même le respecter. Sinon, l’année dernière, à Troyes, je ne pensais pas qu’Ibrahimović dirait oui, mais il était de bonne humeur. Il a accepté à la bonne franquette. Et puis, Balotelli, l’autre fois, c’était sympa aussi. Hier (contre Lyon), il est passé encore. J’aime montrer que le joueur peut être autre que l’image qu’on a de lui.
En 1999, tu as interviewé Laurent Blanc lors d’un Bologne-OM, contexte surréaliste.Les Marseillais perdent 1-0, et s’ils font 1-1, ils sont qualifiés pour la finale. Penalty pour Marseille à cinq minutes de la fin. Laurent Blanc tire, marque. L’arbitre le fait retirer et Blanc marque encore.
Après le coup de sifflet, ça part dans une bagarre générale. À ce moment-là, je dis : « Viens Laurent, on va parler football. » Laurent Blanc parle, président plus que jamais, la classe, il était loin de tout ça, déjà dans sa finale. Des casques, plein de trucs passaient devant nous. C’était la même bagarre que dans Astérix : les Gaulois contre les Romains. C’était rigolo. Le foot, c’est ça aussi. On ne va pas toujours s’embrasser sur la bouche. Là, c’était surréaliste. Blondeau qui donne un coup de tête dans le casque d’un policier…
Avant de commencer l’interview, Laurent Paganelli précise que son anniversaire est bien le 20 octobre et non pas le 22, comme indiqué un peu partout, notamment sur sa page Wikipedia. « Tout le monde se trompe sur la date, mais je m’en fiche. »
Propos recueillis par Flavien Bories