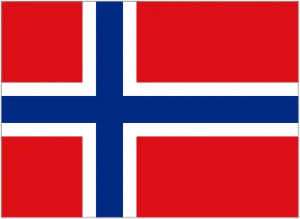- Interview
- Kaba Diawara
« Je pense avoir été un joueur correct »

Ils sont rares à avoir joué aux côtés de Bergkamp, Zidane, Abardonado, Piocelle et Kiki Musampa. C'est le cas de Kaba Diawara, qui fête aujourd'hui ses 40 ans.
À 40 ans, qu’est-ce qu’on peut te souhaiter ?Une bonne santé, déjà. Ce n’est pas pour jouer le vieux, mais, avec l’âge, ce n’est pas toujours facile de continuer à veiller sur la famille et à entretenir une certaine forme physique. Heureusement, je continue de jouer, que ce soit au five ou à l’entraînement lors des rassemblements avec la sélection guinéenne.
Justement, comment ça se passe depuis ton arrivée en tant que manager général de la sélection ?Manager général, c’est un bien grand mot. Disons que je suis plutôt coordinateur sportif. En ce moment, tout se passe bien, on arrive à enchaîner les victoires, mais ça n’a pas toujours été le cas. En débutant par un nul et une défaite, on s’était rapidement retrouvé dans une situation délicate avec beaucoup d’incompréhension. Mais ça va mieux : ces derniers temps, on a réussi à enchaîner les victoires, on a retrouvé la confiance, et un respect mutuel s’est installé. On espère que ça va continuer pour la CAN et la Coupe du monde.
Tu es arrivé en même temps que Luis Fernandez. C’est lui qui t’a contacté ?Non, c’est une idée de la Fédération, qui a ensuite demandé à Luis si ça ne le dérangeait pas de se faire assister par Amara Simba et moi-même. Il n’a pas forcément eu d’objection, même s’il ne me faisait pas du tout jouer lorsqu’il était mon entraîneur au PSG. Par la suite, on en a discuté à Paris et ça s’est fait naturellement. La Fédération s’est sans doute souvenue de mon sérieux et de mes prestations en sélection.
En 2013, dans une interview à So Foot, tu étais très dur envers le foot africain. Tu penses que ça a changé depuis ?
Je reste dur parce que je veux que ce football décolle. On s’est longtemps caché derrière le talent de joueurs tels que Eto’o ou Drogba, mais ces stars ne sont plus là. Du moins, plus en sélection. Il faut donc mettre les bouchées doubles pour enfin devenir un grand continent du foot. Il faut que l’on fasse le bilan de ce qui ne va pas.
Justement, toi, à 40 ans, quel bilan fais-tu de ta carrière ?Je pense avoir pu tirer le meilleur de mes capacités. Je n’ai jamais été technique, mais j’ai toujours essayé de compenser par mon physique et ma détente. Tout ce qui a pu m’arriver, je le dois presque uniquement à moi-même. J’ai eu la chance de voyager et de côtoyer les meilleurs joueurs de ma génération. Je ne suis bien sûr pas satisfait parce qu’on peut toujours mieux faire, mais je pense avoir été un joueur correct. Ça aurait pu être pire.
Tu te souviens de ton premier match en L1 ? Tu étais impressionné ?C’était à Lille en 1996. Bordeaux venait de finir sa campagne européenne et les meilleurs joueurs de l’équipe ne voulaient pas faire le déplacement : ils préféraient se préserver pour l’Euro. Gernot Rohr en a donc profité pour lancer des jeunes. Avec Anselin et Afanou, on s’est donc retrouvés titulaires pour la première fois. J’étais stressé, bien entendu. J’avais déjà joué contre une CFA en Coupe, mais là, c’était complètement différent. Lors de l’échauffement, je n’arrivais même pas à mettre une balle dans les pieds de Jean-Luc Dogon… Mais il m’a tout de suite rassuré en me disant un truc du genre : « C’est comme à l’entraînement, mais avec plus de monde et l’odeur de merguez. » Sachant que j’adore la bouffe, ça me permettait de penser à autre chose (rires).
Tout s’est bien passé, finalement. Tu marques ton premier but et, à la suite de la rencontre, tu signes ton premier contrat pro.C’est vrai que ma prestation avait impressionné les dirigeants. Et notamment Charles Camporo qui vient tout de suite me voir et me dit de bien profiter de mes vacances parce que j’intègre le groupe pro en juin. Lorsque j’ai débarqué à Toulon, ma ville d’origine, j’étais tellement fier de pouvoir en parler à tout le monde. Malheureusement, j’apprends dans la même semaine que Rolland Courbis arrive à la tête de l’équipe et que la majorité des joueurs sont en partance. Ça m’inquiète un peu. D’autant que l’on perd en un été des joueurs comme Zidane, Dugarry, Huard ou Lizarazu et que je ne connais pas du tout ceux qui arrivent.
Pourtant, ce n’est pas l’arrivée de Courbis qui complique ta progression, mais celle d’Élie Baup, non ?La saison 1996/1997 est plutôt bonne, en effet. Je participe à beaucoup de rencontres et j’arrive à marquer quelques buts. Le problème, l’année suivante, c’est que j’étais à l’armée. J’étais donc à Paris du lundi au jeudi. Lorsque je rentrais le jeudi après-midi, je voyais que j’étais toujours sur la feuille de match, mais je ne jouais jamais. Papin était en fin de carrière et voulait absolument jouer tous les matchs. Il était cuit, mais il pensait pouvoir être sélectionné pour la Coupe du monde. Ajoute à ça Laslandes et Wiltord et tu comprends vite que j’étais le quatrième choix de l’entraîneur. D’où mon départ à Rennes.
À cette époque, Rennes est bon dernier. Ça n’a pas été trop dur à vivre comme prêt ?Disons que je suis vite redescendu sur Terre. On était derniers au mercato et on savait que si l’équipe descendait, François Pinault ne rachetait pas le club. C’était donc une époque cruciale pour le club et on avait une pression de malade. D’un point de vue personnel, j’ai joué tous les matchs et tout s’est finalement bien passé. J’en profite pour rendre hommage à Guy David qui m’a beaucoup appris.
Une image marquante que l’on garde de toi, c’est lorsque tu sauves Rennes de la relégation en marquant contre Toulouse lors du dernier match de la saison 1997-1998. Tu te souviens de ce match ?On savait que c’était un match capital parce qu’on devait absolument battre Toulouse pour se maintenir. Toute la semaine, on avait travaillé à fond sur le mental, sur la gestion du stress, etc. Habituellement, je suis plutôt cool, toujours en train de plaisanter, mais il y avait une telle pression à ce moment-là que ce n’était pas possible. À 22 ans, j’avais en quelque sorte le destin d’un club entre les pieds. Pareil pour les autres. Dabo et Silvestre, par exemple, avaient déjà signé à l’Inter, mais voulaient absolument sauver leur club formateur. Lorsqu’on nous a informés que Guingamp gagnait face à Cannes et qu’il fallait absolument marquer. Ça a fini par arriver (rires).
Qu’est-ce que vous avez fait cette soirée-là pour fêter le maintien ?On a fait une petite fête dans Rennes. Il fallait profiter. Honnêtement, je n’avais jamais connu une telle pression. On avait eu la tête sous l’eau pendant 4 mois et on parvient à la sortir lors de la dernière journée. C’était fabuleux.
L’année d’après, Rennes se stabilise enfin en première division et termine 5e. Tu penses avoir joué un rôle dans ce renouveau grâce à ton but ?
Bien sûr ! Et les supporters me le rendent bien. À chaque fois que j’y suis retourné, j’ai toujours eu le droit à ma pancarte. Sans être le plus sensible du monde, ça touche. J’ai en quelque sorte participé à l’histoire du club.
Pourquoi ne pas être resté à Rennes, dans ce cas ?Parce que Bordeaux m’a très bien fait comprendre qu’il n’y avait aucune option d’achat et qu’il voulait me récupérer. Pour ma part, je voulais rester, mais c’est le football. Heureusement pour moi, mon retour à Bordeaux s’est très bien passé. En quelques semaines, je prolonge et je claque un doublé au Vélodrome en septembre. Bon, je suis dans l’ombre du duo Laslandes-Wiltord, mais je vis au sein d’un groupe super avec de vrais bons mecs. Laslandes, par exemple, lors de son arrivée, avait invité toute l’équipe à sa crémaillère après un match. Benarbia, lui, ça a été plus long. J’avais l’impression qu’il était prétentieux.
Pourquoi ça ?Parce que lors de son premier entraînement, il nous dit : « Les gars, Bordeaux va être champion cette année. » C’était dit avec une telle assurance et un tel aplomb que beaucoup le considéraient comme prétentieux. En plus, il nous disait que dans chaque club où il avait joué, son objectif était toujours que l’un de ses attaquants finisse meilleur buteur. Il a eu raison sur toute la ligne : on a été champions, Wiltord a fini meilleur buteur et il a été nommé meilleur joueur du championnat.
De ton côté, alors que l’équipe tourne bien, tu files à Arsenal au mercato d’hiver. Ça a été plutôt dur de se faire une place là-bas, non ?C’était vraiment compliqué en Angleterre. Il y avait une concurrence de malade avec Bergkamp, Henry, Overmars et Kanu. Ils avaient tous joué la Coupe du monde. C’était un autre univers, et ça, je l’ai compris dès le premier entraînement. J’avais l’impression d’être le petit Kaba de passage à Londres. Heureusement, Rémi Garde et Gilles Grimandi m’ont beaucoup aidé lorsque les autres Français partaient en sélection. Ils m’invitaient chez eux, ils s’occupaient de moi. C’était important parce qu’on n’était pas forcément aimés par les Anglais. Ils avaient sans doute l’impression qu’on leur piquait leurs places. Martin Keown, par exemple, m’en mettait plein la tête. Je prenais tellement de coups face à lui.
Dans l’ensemble, tu gardes quand même un bon souvenir de ton passage en Angleterre ?Avec le recul, j’ai compris que j’avais fait preuve d’impatience. Je commençais à jouer régulièrement, je marquais, je réalisais de bonnes prestations, et des clubs comme La Corogne commençaient à manifester leur intérêt. Du coup, quand Arsenal est entré en contact avec moi et qu’Arsène Wenger a appelé chez moi pour avoir mon avis, j’ai pété les plombs : c’était trop beau pour dire non. D’autant que ça me permettait de retrouver Henry, avec qui j’étais en espoir. Et puis je sentais que je pouvais jouer et m’imposer là-bas. J’ai donc fait le forcing et j’ai fini par signer.
En janvier 1999, tu reviens pourtant en France, à Marseille. Tu regrettes ces multiples changements ?En matière de stabilité, c’est clair que ce n’est pas terrible pour un jeune, mais c’est avant tout un concours de circonstances. Lorsque Courbis m’appelle pour me dire qu’il veut monter un projet avec des jeunes à l’OM pour remplacer les départs de certains cadres, c’était forcément tentant. J’avais un bon contrat, je retrouvais ma région et une place de titulaire aux côtés de Bakayoko. Malheureusement, Dugarry, Ravanelli et Maurice ne sont finalement pas partis et on se retrouve à cinq attaquants pour deux places. Et les mauvaises nouvelles s’enchaînent : je souffre d’une pubalgie et, lorsque je reviens, Rolland est viré, deux ou trois mois seulement après mon arrivée. C’est Bernard Casoni qui reprend le club et il me fait clairement comprendre qu’il ne me fera pas jouer.
Enchaîner Marseille et Paris, c’est un choix que tu regrettes avec le recul ?Non, parce que Paris me voulait vraiment, et des joueurs comme Ali Benarbia, Laurent Robert et Pierre Ducrocq militaient pour ma venue. J’avais connu ces deux derniers lors de mon passage au sein de l’équipe de France militaire et on avait de bons contacts.
Tu gardes un bon souvenir de ce passage à l’armée ?Il y a des bons côtés parce que j’y ai rencontré des super mecs, comme Carrière, Pierre-Fanfan ou Gallas et qu’on a vécu de belles choses, mais la Coupe du monde en Iran en 1997, où on finit troisième avec Roger Lemerre en tant que sélectionneur, a été très compliquée. On vivait dans une caserne, et la bouffe était clairement dégueulasse. On n’avait que du riz ou des pâtes infâmes. Le soir, on entendait même des chiens hurler bizarrement à l’extérieur, et je me demande encore si ce n’est finalement pas ces chiens que l’on finissait par retrouver dans nos assiettes. Moi qui adore manger… Honnêtement, ça a été les trois semaines les plus longues de ma carrière. Pour te dire, certains joueurs se sont même fait braquer, alors qu’ils cherchaient juste à sortir un peu durant la soirée. On n’était pas du tout dans les conditions idéales. En quarts, on s’est même sérieusement posé la question de savoir si on faisait exprès de perdre le match contre la Belgique pour éviter de rester une semaine supplémentaire là-bas. C’était le mois d’août, on avait tous entre 20 et 22 ans et on cherchait tous à faire notre trou dans nos clubs respectifs. Bon, la raison a fini par l’emporter et on a éliminé la Belgique, mais certains voulaient vraiment perdre.
Pour revenir au PSG. Lors de ton passage dans la capitale, il y a cette fameuse finale de la Coupe de la Ligue perdue face à Gueugnon. Comment tu l’expliques ? Apparemment, tu regrettes la préparation du match…Toute la semaine, les dirigeants avaient passé plus de temps à nous demander qui serait présent à la soirée après la rencontre qu’à préparer le match. On était deuxièmes du championnat, on jouait en quelque sorte à domicile et on avait pas mal de stars dans l’effectif : on pensait tous gagner. On a donc oublié de préparer un match face à une équipe qui voulait absolument remporter cette coupe. Dès le début, ils nous ont mis la pression. Ils avaient la rage, le public derrière eux, et on a fini par douter. C’est dommage, j’aurais aimé gagner un titre avec Paris.
Le début des années 2000, c’est aussi une époque où tu multiplies les mauvaises expériences…En fait, durant l’été 2000, je contracte une tendinite au genou qui m’empêche de bien me préparer. Forcément, le club apprend à se passer de moi et me prête à Blackburn lors du mercato d’hiver, puis à West Ham quelques mois plus tard. Mais là encore, je n’arrive pas à enchaîner les matchs. À mon retour de West Ham, je prends donc la décision de me faire opérer. Ça a été une période difficile, parce que je voulais jouer, mais je n’en avais pas la possibilité. J’avais l’impression d’être dans la même situation qu’à mes débuts, mais j’avais 25 ans désormais. Étant donné que Luis Fernandez ne comptait toujours pas sur moi, je suis parti en prêt au Racing Ferrol où ça ne s’est pas trop mal passé.
Tu penses que ce passage en Espagne t’a permis de rebondir ensuite ?Ce qui est sûr, c’est que, durant l’été 2002, je me sens au mieux de ma forme : je fais un gros stage de préparation et je fais une grosse prestation en amical au Portugal face au Sporting de Cristiano Ronaldo. Après ça, même László Bölöni me voulait. Mais Luis refuse l’offre. Ce qui m’avait étonné à l’époque, sachant qu’il ne me faisait pas jouer, qu’il venait de recruter des joueurs comme Cardetti, dont je n’ai jamais compris la qualité, et que Jean-Louis Gasset voulait me garder. Lui, il avait capté que j’étais motivé, en forme et que j’étais relâché comme jamais. J’étais arrivé à un âge où j’avais compris que si je ne me bougeais pas le cul, c’était fini. Du coup, lorsque Nice est venu aux renseignements, j’ai fait un peu le forcing et je suis parti en prêt là-bas. Et mes efforts ont fini par payer.
Pourquoi ne pas être resté plus longtemps là-bas ? Il paraît que ton départ est dû à des divergences sur ton salaire…C’est vrai que j’ai fait une super saison à Nice, sans doute ma meilleure. Je réalise un triplé, je marque douze buts et je suis même nommé joueur du mois d’août. J’aurais bien entendu voulu y rester, mais le club ne pouvait pas racheter mon contrat au PSG. Avoir des longs contrats m’a parfois joué des tours, mais ça m’a au moins permis d’être toujours en sécurité. Le problème, justement, c’est que malgré ma bonne saison Vahid Halilhodžić refusait de me faire jouer. Il n’arrêtait pas de me dire que j’étais un bon attaquant, mais que Paris avait besoin d’un grand attaquant. Lorsque Pauleta est arrivé, j’ai donc fait une nouvelle fois le forcing pour partir. Ce qui est marrant, c’est que j’ai été le premier joueur à établir une connexion entre le Qatar et le PSG. À la base, je devais partir gratuitement à Al Gharrafa alors que j’étais encore sous contrat. Mais comme Toulouse avait pointé le bout de son nez le dernier jour du mercato, Vahid voulait que j’y aille parce qu’il avait peur que les dirigeants ne comprennent pas comment il avait pu me laisser partir gratuitement sachant qu’un club était prêt à investir. Du coup, j’ai fait le forcing et j’ai convaincu en quelques heures les Qataris de dédommager un peu le PSG.
Tu as l’impression d’avoir été un précurseur en rejoignant Al Gharrafa ?En 2003, ce n’était que la première saison professionnelle du championnat qatari, mais il y avait déjà des joueurs comme Hierro, Guardiola, Batistuta ou Effenberg. J’étais avec d’immenses stars, alors que je n’avais que 27 ans. Quant au niveau, c’était un peu comme en MLS : des équipes qui ont les moyens de recruter et d’autres qui n’avaient même pas trois ou quatre joueurs professionnels dans leur effectif. Il pouvait y avoir des matchs extrêmement serrés, mais aussi des victoires hyper faciles face à certaines équipes. Cela dit, il faisait tellement chaud que c’était très physique pour nous aussi.
Tu es resté deux ans là-bas. Tu t’y es vraiment éclaté ou c’était juste pour l’argent ?Étant musulman, je n’avais pas de contrainte, d’autant que ma famille s’y sentait bien et que je jouais aux côtés de Belmadi. Et puis sportivement, cela ne m’empêchait pas d’être en sélection.
Comment tu expliques ton retour en France, dans ce cas ?En 2005, j’avais 29 ans et je voulais goûter à nouveau aux premières divisions. Ce que j’ai réussi à faire avec Ajaccio, mais aussi en Turquie, que ce soit à Gaziantepspor ou à Ankaragücü. Ça a été deux années assez bonnes, même si les clubs turcs ont la mauvaise tendance de ne pas payer leurs joueurs… Heureusement que les conditions de vie sont très bonnes là-bas. Et puis le championnat ressemble beaucoup à la Premier League avec beaucoup de jeu, d’énergie et d’engagement.
Tu te rends compte que tu n’as jamais réussi à te stabiliser dans un club fixe…C’est vrai et je pense que c’est ce qui explique mon départ de Chypre pour Arles-Avignon en 2009. Je sentais que j’étais en fin de carrière et je voulais m’amuser. À Arles, on me propose en plus d’encadrer l’équipe, qui vient à peine d’être promue en L2. La saison a été galère d’un point de vue organisationnel : on se débrouillait pour trouver des hôtels, pour s’acheter une machine à laver et pour trouver des sponsors… Malgré tout, on se retrouve à jouer la montée lors de la dernière journée et on se voit propulser en L1. Il fallait que je poursuive l’aventure. D’autant que l’on me proposait depuis décembre de prolonger mon contrat.
Sachant l’année compliquée d’Arles-Avignon en 2010-2011, tu ne regrettes pas ne pas avoir terminé ta carrière sur une bonne note ?C’est vrai que ça a été une année compliquée : en pleine préparation, on apprend que le coach nous quitte et qu’André Ayew et d’autres joueurs le suivent. L’ambiance change également. On avait l’impression que les valeurs du club partaient en fumée. Ça se voit dans nos résultats, de toute façon. D’un point de vue personnel, en revanche, je termine malgré tout sur une année de plaisir en L1 et avec quelques buts.
Avec tous les joueurs que tu as eu l’occasion de rencontrer, quel est celui qui t’a le plus marqué ?Kizito Musampa était dingue. Lorsqu’il est arrivé, tout le monde faisait l’effort de lui parler en anglais. Mais voilà que le mec, au bout de presque trois mois, finit par nous répondre en français. En fait, il nous comprenait depuis le début. On a halluciné ! Tu imagines la durée de sa blague ? (Rires) C’était tout lui, ça : toujours en train de faire le con, de sourire et de dire des conneries.
Propos recueillis par Maxime Delcourt