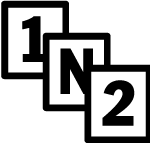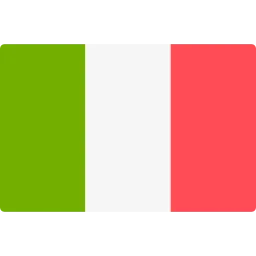- C1
- Demies
- Manchester City-Real Madrid
Guardiola et Madrid, triste topique

Personne ne parle aussi bien du Real Madrid que Pep Guardiola. Sans doute parce que la relation entre l’entraîneur catalan et le grand club de Madrid est une parabole éloquente pour se figurer les paradoxes de l’Espagne contemporaine.
Comment devient-on entraîneur de football ? Posée comme ça, évidemment, la question paraît aussi stupide que la réponse est simple : « en passant ses diplômes ». Si le lecteur est convaincu par cette sentence, il est invité à aller scroller ailleurs. Pour les autres, ceux qui considèrent que ce n’est pas le diplôme qui fait le médecin, le notaire ou l’indépendantiste, la réflexion demeure ouverte. Car, lundi après-midi — et sans vraiment le vouloir — Pep Guardiola a livré une réponse intéressante à cette question. L’heure était à la traditionnelle conférence de presse d’avant-match. Comme d’habitude, l’ambiance y était ronronnante. Question, réponse, question, réponse. Ne parler de rien pour, surtout, n’avoir rien à regretter. La recette est connue. C’est la même que celle des déjeuners de famille.
La journée aurait donc pu se terminer anonymement. On serait rentré à la maison heureux d’avoir su vaillamment préserver la concorde familiale. Oui, tout se serait magnifiquement passé si le visage de Pep ne s’était tout à coup obscurci. Après une salve de questions en anglais, la parole venait d’être donnée aux journalistes espagnols. L’affable Pep, l’aimable Guardiola (et son anglais un peu approximatif, il faut le dire), se transforma en un mot. « Bonjour Pep, Anton Meana en direct sur la Cadena Ser. Qu’est-ce que vous préférez dans le Real Madrid d’Ancelotti ? » La gorgée d’eau ne passe pas. Le regard est fixe. La réponse laconique. « Beaucoup de choses. » Point. Les confrères d’Anton s’y mettent alors à plusieurs. La glace se durcit. Pep remonte dans l’iceberg. Il ne donnera rien. Pas une seule ouverture. Même pas ce verre d’eau qu’il tient dans la main et qu’il pourrait très bien leur balancer au visage s’il était quelqu’un d’autre. Diego Miguel Fernandez, autre classique de la presse madrilène, relance. « Comment expliquez-vous les résultats du Real dernièrement ? » Réponse : « Ils sont très forts. » C’est tout. Ambiance.
Jaume Roures et la Central Lechera
Pour être précis, il faut dire que le passif entre Pep et la presse madrilène est plutôt lourd. Un jour de Clásico mythique (le 26 avril 2011, demi-finale de Ligue des champions contre le Real de Mourinho), il l’avait même officiellement baptisée la « Central Lechera » du nom d’une marque de producteur de lait (de liquide blanc, métaphore séminale, donc) bien connue dans la péninsule. « La Central Lechera et les amis de Florentino Pérez » désigne, selon lui, la manière dont les médias proches du Real n’hésitent pas à se nourrir des obsessions de leur président (dont Guardiola fait partie comme entraîneur honni) pour alimenter leurs gazettes centralistes, au point de relayer n’importe quelle rumeur à ses dépens, en particulier les plus malveillantes.
![]()
Dans le désordre depuis 30 ans : homosexualité, séropositivité, usage de produits dopants, liens avec Carles Puigdemont, ex-président de la Generalitat en exil, avec le séparatisme catalan, goût pour l’intrigue, mégalomanie, etc. Si l’on veut comprendre les silences de Pep, il faut deviner la totalité des choses dont il ne veut/peut pas parler. Les malheureux Meana ou Fernandez n’y sont pour rien. Pep est d’ailleurs entouré d’une cour assez large d’écrivains, journalistes, cinéastes. Il n’a rien contre le journalisme. Il en a même été à une époque (dans les colonnes d’El Pais ou auprès du célèbre trotskiste de Mediapro Jaume Roures). Mais entre Pep et le Real Madrid, c’est une affaire personnelle.
Le Clásico à visage humain
Lundi après-midi, au milieu des silences épais, la couche de mépris a fini par craqueler. L’admiration a même pointé. Quand Orfeo Suárez, monument de la presse sportive espagnole, catalan de formation, lui pose la même question que tous les autres, cette fois-ci Pep se détend et donne quelque chose à penser. Il l’admet volontiers. Il entretient avec le Real Madrid une relation étrange. En tant qu’entraîneur, il a gagné 11 de ses 19 matchs disputés contre les Merengues. En tant que joueur, le compteur monte à 21 rencontres avec un bilan plus mitigé (8 victoires, 7 nuls, 6 défaites). De cette quarantaine de matchs, le plus intéressant à retenir n’est pas contenu dans les chiffres, mais dans ce qu’il en conclut : « On ne peut pas rivaliser avec l’histoire. »
![]()
Vale Pep, mais en quoi consiste, concrètement, cette histoire ? « Le Real a des joueurs avec le package complet… Ce qui me plaît le plus, c’est que dans la difficulté, les joueurs ne se cachent pas, ils lèvent le doigt et répondent présent. Si les choses vont bien, ils se montrent. Mais si les choses vont mal, ils se montrent encore plus. Le ballon ne leur brûle pas les pieds. » L’entraîneur qui représentait la culmination du football collectiviste, l’homme qui avait passé sa vie à provoquer Madrid en duel sportif et politique, faisait désormais l’éloge de qualités que ses équipes n’auraient jamais.
La névrose de Pep
Cet éloge paradoxal est aussi une tristesse. Personne, à part lui, ne figure aussi fidèlement les contradictions de l’Espagne contemporaine et de son football adoré. Pep raconte la difficile ascension de cette idée de jeu (le jeu de position) apparu dans les années 2000 vers les sommets des palmarès. Et, juste après, ce qu’il en coûte en réputation, en inimitiés, en adversité, pour y demeurer de manière continue depuis quatorze ans. Pep, parce qu’il est né, a grandi, s’est émancipé, depuis le trottoir d’en face, est celui qui parle sans doute le mieux de son voisin de façade. De ses grandeurs comme de ses misères. Ce n’est peut-être pas tout à fait un hasard si certains Madridistes réputés comme Jorge Valdano, Raúl Gonzalez ou Xabi Alonso ont un jour fait partie de son cercle proche et restreint. Ce n’est peut-être pas un hasard non plus si la Quinta del Buitre, Real mythique des années 1980 fait de jeu court et d’enthousiasme, fait partie de son musée imaginaire.
![]()
Enfin, il faut le reconnaître, c’est en volant la vedette au grand voisin mégalo que Pep Guardiola, le Catalan le plus célèbre du monde, est devenu le coach le plus influent de la planète. Les matchs que les archéologues du futur ressusciteront dans 1000 ans seront le 6-2 de Bernabéu (2009), le 5-0 du Camp Nou (2011), le 0-4 avec le Bayern à l’Allianz Arena (2014) et peut-être aussi, pour être complet, ce discours en faveur du référendum catalan en 2017. Car il aura beau avoir été l’entraîneur le plus glorieux de la Péninsule, il faudra bien expliquer aux enfants du futur pourquoi cet homme — en dépit de l’immensité de son héritage — n’aura jamais entraîné la sélection espagnole. C’est que, comme Ali et New York ou Elvis et Vegas, la névrose de Pep a le nom d’une ville : Madrid.
Par Thibaud Leplat