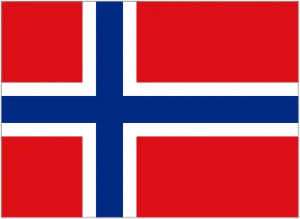- Angleterre
- Chelsea
Gianfranco Zola : « À Chelsea, c’était parfois du thé, souvent de la bière »

Réussir à devenir une légende en Angleterre en mesurant moins d'un mètre soixante-dix n'est pas chose aisée. C'est pourtant ce qu'a réussi à faire Gianfranco Zola à Chelsea. Élu meilleur joueur de l'histoire des Blues en 2003, celui qui arborait un numéro 25 désormais sanctuarisé a marqué de son empreinte son passage à Londres. S'il vit toujours dans la capitale anglaise deux ans et demi après la fin de son dernier contrat d'adjoint dans son club de cœur, l'ancien attaquant, 55 ans, n'oublie pas de se rendre régulièrement en Italie pour rendre visite à ses vieux potes en Sardaigne. Pendant une heure, Zola a parlé de Chelsea, mais aussi de Parme, du Mondial 1994, de coups francs, de Maradona, de station service et de canne à pêche. Entretien avec une légende.
Il y a quelques jours, Chelsea a été sacré champion du monde des clubs. Tu aurais pu croire à une telle trajectoire lors de ta signature là-bas en 1996 ?C’était très difficile d’envisager un parcours comme celui-là. On savait que Chelsea était un club ambitieux et qui voulait grandir, mais c’est tout. Même si c’était quand même l’un des premiers clubs en Angleterre qui ont misé sur les joueurs étrangers dans l’idée de faire grandir le club, d’améliorer l’équipe. C’étaient les prémices. À l’époque, c’était une marque d’ambition, mais tu ne sais jamais où cela te mène. Or, quand on parle de Chelsea aujourd’hui, on parle de l’un des plus grands clubs du monde.
Qu’est-ce qu’a représenté Chelsea pour toi ?Chelsea a été le plus beau moment de ma carrière. Naples et Parme ont été aussi de très belles expériences qui m’ont fait grandir en tant que joueur. Mais à Chelsea, j’ai donné la meilleure version de moi-même… J’ai reçu tellement d’affection de la part des fans. Cela m’a rendu amoureux de l’endroit et des gens.
Le jour de ta signature chez les Blues, tu as pleuré. C’était à cause de la météo ? Non. (Rires.) C’était un mix entre de l’impatience de démarrer une nouvelle aventure et de savoir ce que je quittais. La Premier League était excitante par bien des aspects, mais ce n’était pas ce que l’on connaît aujourd’hui. À l’inverse, la Serie A était le meilleur championnat du monde, et Parme m’avait énormément apporté.
Pourquoi quittes-tu Parme et l’Italie pour l’Angleterre dans ce cas ?Je sortais d’une expérience négative avec l’équipe d’Italie à l’Euro 1996 (les Azzurri ont été éliminés en phase de poules, NDLR), et cela m’a affecté. Je n’ai pas bien commencé la saison suivante avec Parme, l’équipe ne tournait pas bien non plus. J’avais besoin, je crois, de tourner la page et de vivre une expérience différente. Alors, quand l’opportunité d’aller à Chelsea s’est présentée, je l’ai accueillie avec plaisir. C’était un nouveau championnat, un nouveau pays, un nouveau défi qui me fascinait. C’était l’opportunité de me confronter à un football différent où tous disaient que je n’avais pas le physique pour pouvoir y aller. Dans le sport, j’ai toujours été un homme de défis, de compétition, avec l’adrénaline qui en découle. Ce sont ces situations qui m’ont toujours fait sortir le meilleur de moi-même.
Quelles étaient les différences majeures entre la Serie A et la Premier League à cette époque ?La Serie A était dans l’absolu le meilleur championnat du monde, il y avait les meilleurs joueurs. En Angleterre, c’était plus physique et dynamique, mais il n’y avait pas le même niveau tactique et technique. Avec le temps, les grands joueurs et entraîneurs étrangers sont arrivés, et cela a participé à l’inversion des courbes que l’on constate aujourd’hui : la Premier League est la Serie A d’il y a trente ans, et la Serie A est probablement la Premier League d’il y a trente ans.
Vous sentiez sur le terrain ce passage de témoin entre Premier League et Serie A ?Des joueurs comme Vialli, Di Matteo, Ruud Gullit ou moi, qui avions goûté au championnat italien, on a participé à ce passage de témoin. C’est cet afflux de joueurs étrangers de grand talent tels que Bergkamp, Vieira, Cantona, Lebœuf, combiné à l’émergence de joueurs locaux talentueux comme Beckham et d’autres qui ont permis à la Premier League de devenir ce qu’elle est devenue.
Comment c’était de vivre à Londres dans les années 1990 ?C’était très bien, très différent de ce qu’est devenue la ville aujourd’hui. Londres était une ville très ouverte, qui avait une mentalité à l’opposé du Brexit d’aujourd’hui. La ville, le pays même, était très ouvert à la venue des étrangers et de ce qu’ils pouvaient offrir. Au niveau footballistique, il y avait quand même un certain conservatisme, car quand un étranger arrive, il peut prendre la place de gens qui sont en place. Je vis encore aujourd’hui à Londres, mais ce n’est plus pareil. Peut-être aussi parce que l’on vit un moment plus difficile – et je ne parle pas forcément du Brexit, mais aussi de la pandémie. Il y a beaucoup moins de gens dans la ville, c’est étrange. Je ne saurais pas dire qui du Brexit ou de la pandémie a modifié le plus cela, je crois que les deux ont leur part de responsabilité.
![]()
Tu es très attaché à Hyde Park. Pourquoi ce lieu est-il différent des autres ? Hyde Park… Déjà, parce que c’est à deux pas de ce parc que j’ai vécu mes trois premières années à Londres. C’est une partie de Londres pour laquelle ma famille et moi avons un profond attachement, car cela coïncidait aussi avec mes belles années : avec Chelsea, cela se passait très bien, je pouvais avoir une vie privée. C’était calme. J’avais beau être un joueur très connu, le mode de vie faisait que je pouvais aller me balader à Hyde Park avec ma famille sans être dérangé. C’est quelque chose que mes coéquipiers et moi-même apprécions beaucoup.
Ce n’était pas trop dur pour un Sarde de s’adapter à la vie londonienne ?L’une des raisons pour lesquelles mon aventure en Angleterre a été une réussite est que j’ai épousé tout ce qui concerne cet endroit : la culture, les gens, le climat… Cela m’a permis de bien faire mon travail, de nous sentir bien à Londres et de continuer d’y vivre aujourd’hui.
Tu as un exemple de truc culturel que tu as adopté en allant en Angleterre ?Je buvais beaucoup de thé. (Rires.) Aujourd’hui, je me suis davantage tourné vers le café, mais pendant les années Chelsea, c’était un rendez-vous dans la journée. Quand on était en mise au vert par exemple, c’était l’occasion de se relaxer avec les autres et de discuter avec par exemple Dennis Wise, Roberto Di Matteo, Frank Lebœuf. Parfois c’était du thé, souvent c’était de la bière.
Comme tu l’as dit toi-même précédemment, tu n’étais pas bien grand pour jouer en Premier League…(Il coupe.) Je te remercie, mais tu aurais pu directement dire que j’étais petit ! (Rires.)
Est-ce que tu as dû changer ton jeu en partant là-bas ?Absolument pas. Dès le début de ma carrière, j’ai su que je n’avais pas le même physique que plein d’autres joueurs et que je devais alors utiliser des stratagèmes pour avoir un impact sur le match, pour faire la différence. Ce que j’avais appris à faire en Italie m’a servi en Angleterre : je réussissais à me mettre dans des positions où c’était difficile pour le défenseur de me marquer, où cela me donnait du temps pour quand je recevais le ballon, avoir ce temps d’avance et laisser exprimer mes qualités : la vision du jeu, la rapidité, le dribble. C’était un gros avantage que j’avais et que j’ai utilisé en Angleterre, face à des défenseurs qui n’étaient pas habitués à défendre sur ce type de joueurs.
Comment expliques-tu le fait que tu aies été l’un des rares Italiens à réussir en Angleterre? Selon moi, beaucoup ont échoué, car ils ne se sont pas faits à la réalité du pays. Je ne parle pas seulement de football : beaucoup d’Italiens n’ont pas bien réussi parce qu’ils n’ont pas complètement accepté la culture anglaise et le football local. Peut-être ont-ils souffert et n’ont-ils pas pu exprimer tout leur potentiel.
Aujourd’hui, Jorginho est pourtant le meilleur ambassadeur italien et il joue pour Chelsea. Tu l’as eu sous tes ordres comme joueur quand tu étais adjoint de Sarri à Chelsea. Qu’a-t-il de particulier ?Jorginho est un joueur extraordinaire dans une équipe qui cherche à produire du beau jeu. J’ai pu l’observer de près quand j’étais avec Sarri : c’est un joueur extrêmement intelligent, tactiquement très fort. Il est l’un des meilleurs au monde à son poste.
Comment expliquer alors qu’il ne fasse pas l’unanimité ?Jorginho, tout le monde le comprend d’une manière différente. Je donne un exemple : tu as des gens qui pensent que le rôle de « mediano » (numéro 6) est celui d’un récupérateur de ballons qui nécessite de grandes capacités physiques. Grosso modo toutes les qualités que Jorginho n’a pas. (Rires.) Il compense grâce à son intelligence, qui lui permet d’intercepter beaucoup de ballons. Mais il n’est pas de ceux qui récupèrent le ballon sur un duel aérien ou physique. C’est un joueur différent. En Angleterre, ce rôle a essentiellement été interprété de cette manière, par le duel. Je te donne deux exemples : Patrick Vieira et Roy Keane sont deux joueurs qui ont interprété ce rôle de manière différente. La manière de jouer de Jorginho peut ne pas plaire à certains. Mais si tu veux jouer comme Chelsea ou comme Manchester City, tu ne peux pas te passer d’un gars comme Jorginho.
Pourquoi ? Parce qu’il fait tourner l’équipe avec un sens du timing exceptionnel. Il ne garde jamais trop longtemps le ballon, le joue toujours au bon moment et soutient toujours les défenseurs centraux, il n’est pas du genre à se cacher. Pour une équipe comme Chelsea qui veut faire ressortir le ballon au pied de derrière, il est fondamental.
À Chelsea, tu étais surnommé le « Maestro ». Comment décrirais-tu l’importance du tempo et du mouvement dans le football ? C’est fondamental : le football est une affaire de dynamisme. Le football, c’est comme la musique : vous pouvez jouer les bons accords, les bonnes notes, mais si vous ne les jouez pas en rythme avec le bon mouvement, la mélodie ne sortira pas. C’est la même chose dans le foot : faire la passe au bon moment, l’appel au bon moment, c’est parfois une question d’une demi-seconde où tu peux te retrouver hors jeu comme faire gagner le match à ton équipe.
![]()
Être entraîneur adjoint de Maurizio Sarri à Chelsea (2018-2019) t’a-t-il donné envie de revenir un jour en tant qu’entraîneur principal ?C’était une très belle expérience de donner un coup de main à Chelsea. J’ai déjà pensé à ce retour, je l’ai espéré, mais je me suis toujours dit que je voulais revenir ici quand je serai suffisamment bon pour redonner la même satisfaction aux gens. En côtoyant Maurizio Sarri, j’ai pu voir ce qu’était un grand professionnel. Sarri est un coach qui travaille énormément l’approche de ses matchs, qui ne laisse rien au hasard, qui pense à tous les détails.
Pour en revenir au moment où tu jouais à Chelsea, quel est le joueur le plus fou avec lequel tu as joué ?Il y en a eu beaucoup, mais je dirais Dennis Wise, qui avait une folie positive. Sur le terrain, il était capable de devenir comme Dr Jekyll et Mr Hyde. Il était vraiment bon balle au pied, il était très dynamique, mais parfois il devenait Mr Hyde et pouvait se faire sortir n’importe quand.
Si tu devais choisir un match à Chelsea que tu as joué merveilleusement bien, le match parfait, ce serait quoi ?Oh Dio… Je vais t’en donner un qui n’est pas le match parfait, mais qui me restera toujours en mémoire. Troisième tour de FA Cup face à Liverpool. Stamford Bridge était en phase de modernisation, on perdait 2-0 après 45 minutes. Le stade était plein, l’atmosphère folle. En deuxième période, je me rappelle que quand Mark Hughes entre en jeu, le stade devient fou. L’équipe se transforme complètement, on gagne 3-2, et l’atmosphère qu’il y avait à ce moment-là est inoubliable. Rien qu’en parler, ça me fout les poils. J’avais fait un bon match ce soir-là et même égalisé, mais c’est le match dans son entièreté que je n’oublierai pas.
Tu n’as jamais gagné la Premier League. C’est une douleur particulière ?Tu emploies le mot douleur, j’irai même plus loin en disant que c’est une tache. On n’en était pas loin, on a terminé troisièmes à quatre points de Manchester United en 1998-1999. Il y a ce match contre West Ham que l’on perd à domicile alors que l’on domine pendant 90 minutes. On perd aussi deux points contre Leicester alors que l’on mène 2-0 à cinq minutes de la fin… Ce sont cinq points en moins qui nous auraient permis de remporter le championnat. Il faut dire aussi que l’on a été pas mal malchanceux cette année-là, car on avait par exemple Pierluigi Casiraghi qui s’est blessé gravement après quelques journées. Avec lui, on aurait eu encore plus de chances d’aller au bout.
Tu étais un excellent tireur de coup franc. Quel est le secret de la réussite ?Une ou deux fois par semaine, je restais entre 45 minutes et 1 heure pour ne faire que des coups francs. Les gardiens de Chelsea ne pouvaient pas me refuser ça ! À vrai dire, ils restaient avec plaisir, car c’était aussi un entraînement pour eux. Ils ne se seraient pas permis de refuser. J’y dédiais beaucoup de temps tout simplement parce qu’en Italie, durant ces années-là, les matchs étaient très serrés ou fermés. Un coup franc pouvait donc débloquer la partie. L’un des premiers exemples que j’ai pris pour tirer les coups francs était Michel Platini. Lui, c’était un vrai spécialiste. Je me rappelle que lorsqu’il arrive à la Juve, il traînait déjà cette réputation d’être un très bon tireur de coup franc. Et il en a mis plus d’un. Après, il y en avait d’autres forcément qui étaient des références en la matière : Zico, Maradona…
Maradona. À Naples, il riait du fait qu’avec toi, il avait enfin trouvé quelqu’un de plus petit que lui…Il aimait dire ça, mais je ne suis pas sûr qu’il y avait une si grande différence de taille entre nous (en réalité, Maradona mesurait 1,65m et Zola 1,68m, NDLR).
Qui était Diego pour toi ?C’était Dieu. Mais surtout, c’était une inspiration. Si un garçon voulait s’améliorer en regardant quelqu’un, Diego était le meilleur exemple parmi tous. Au-delà d’avoir apprécié jouer avec lui, le découvrir en tant que personne, qu’homme a été pour moi une chance. Il est devenu très important et un point de référence pour beaucoup de choses. Il m’a par exemple enseigné le fait d’être modeste et humble avec mes coéquipiers et avec moi-même. Ça a été un enseignement très important, car c’était le meilleur joueur du monde. Il était comme ça, Diego : simple, modeste, avec la volonté d’être bien avec tous ses coéquipiers. Généreux avec tout le monde. C’est ce qui m’a fait encore plus apprécier Diego Maradona dans son entièreté.
Ce titre gagné avec lui en 1990 fait partie de tes plus beaux souvenirs ?C’était une superbe année : c’étaient mes débuts en Serie A, j’ai pu apporter ma pierre à l’édifice. Je ne l’échangerai contre rien au monde, ce Scudetto.
Qu’est-ce que cela faisait d’être sur le terrain avec lui ?Maradona était un joueur différent. Il faisait des gestes que les autres n’imaginaient même pas. C’est comme Messi : c’est un joueur que tu regardes et tu dis : « Wow ! » Il y avait pourtant d’immenses champions pendant ces années-là en Serie A : Van Basten, Gullit, Matthaus, Platini, Zico… Mais Diego était unique. Personne ne réussissait à faire ce qu’il faisait, et surtout à y penser. Comme son coup franc contre la Juve dans la surface de réparation ou le but qu’il met à Giuliani, le gardien du Hellas, avec ce lob du milieu de terrain… Il était extraordinaire.
C’est en regardant Maradona que tu es devenu un bon tireur de coup franc ?Sans vouloir paraître prétentieux, j’étais déjà un bon tireur de coup franc au moment où j’arrivais de ma précédente équipe de Serie C, le SEF Torres Calcio. C’était un truc sur lequel je m’entraînais déjà. Mais c’est vrai qu’aux côtés de Diego, tu ne peux que t’améliorer.
Au moment où Diego quitte Naples pour Séville, il te laisse son numéro 10. Ce n’était pas un maillot trop lourd à porter ?Beh, c’est clair que la personne qui allait passer derrière lui avec ce maillot sur les épaules endosserait une énorme responsabilité. Pour moi, ça s’est bien passé, peut-être car d’emblée, je n’ai jamais pensé ou dit que je pourrais faire les mêmes choses que Diego. Je savais que ce qu’il faisait était inatteignable pour les autres. Ce maillot flanqué du 10, j’ai juste essayé de m’en servir comme quelque chose de stimulant.
Tu as une histoire avec Diego dont tu te rappelleras toujours ?Oui, j’en ai une, et elle a un lien avec ce maillot justement. On jouait à Pise, et Careca était absent ce jour-là. J’étais titulaire, Diego aussi, et avant d’aller sur le terrain, Diego est venu me voir et m’a dit : « Aujourd’hui, je joue avec le numéro 9 et toi avec le numéro 10. » Moi, je ne comprenais pas, j’étais timide et surexcité par ce que je venais d’entendre, alors je lui disais : « Diego, je ne comprends pas, merci, c’est trop gentil… » Mais il m’a arrêté tout de suite et m’a dit : « Je ne fais pas ça pour toi, pour que tu joues avec le 10. C’est juste qu’aujourd’hui, j’ai envie de jouer avec le 9 ! » Il avait senti ma timidité, je ne savais plus trop où me mettre. Je n’avais plus les mots après ça.
Après Naples, il y a eu Parme où tu pêchais souvent avec certains de tes coéquipiers. Il paraît que la canne à pêche de ton père était magique.On avait un super groupe à Parme, et j’étais effectivement très proche d’Asprilla, Appoloni ou d’autres, comme Georges Grün. On avait la passion commune de la pêche et on y allait de temps en temps. Comme ce jour où nous sommes allés en Sardaigne, à Orosei, où j’avais un petit bateau. On pêchait tranquillement, jusqu’au moment où cet homme brillant qu’est Asprilla a réussi à attraper toutes nos lignes avec sa canne à pêche. Il a tiré dessus fort en pensant qu’il avait pêché un gros poisson. En réalité, il a juste attrapé toutes nos cannes et on a dû les jeter, car elles étaient hors d’usage. Asprilla, c’était un gars adorable, mais qui pouvait s’avérer très dangereux lors d’une partie de pêche. (Rires.)
Qu’est-ce que t’apportait le fait de pêcher ?C’était une pause. Un moyen de m’évader du foot, de me relaxer. Nous, les footballeurs, comme les autres sportifs, on a tendance à trop penser à notre sport. Aller à la pêche, c’était l’opportunité de se rafraîchir les idées. Passer du temps avec les amis, et les considérer comme tels et plus comme des coéquipiers.
En 2017, un certain Fabrizio Maiello avait admis avoir tenté de t’enlever à une station service en 1994. Tu te souviens de ce jour-là ?Oui, je me le rappelle. C’était après l’entraînement, je rentrais chez moi et j’avais cette voiture qui me suivait depuis plusieurs kilomètres. À un moment donné, je me rends dans une station service pour faire le plein et je vois que cette voiture continue de me suivre. À ce moment-là, je suis sorti de ma voiture et suis allé vers la voiture et j’ai demandé à son conducteur : « Mais pourquoi tu me suis ? Ce n’est pas pour un autographe, hein ? » Et lui m’a répondu : « Si, si, signe-moi en un ! Je suis napolitain. » À ce moment-là, je n’avais pas du tout conscience que j’avais face à moi un gars qui avait pour projet de m’enlever ! Ce n’est que plus tard, quand c’est sorti dans la presse, que j’ai su que ce n’était pas vraiment son intention de départ que de vouloir un autographe.
Ce Mondial 1994 aux USA, comment l’as-tu vécu ?Écoute, ça n’a pas forcément été une grande expérience pour moi, puisque je n’ai joué que douze minutes avant d’être expulsé pour quelque chose que je n’ai absolument jamais fait. Mais je m’en souviens quand même comme l’une des plus belles expériences de footballeur à laquelle j’ai pris part.
Dans quel état étais-tu après ce tir au but raté par Roberto Baggio en finale face au Brésil ?On était forcément très déçus, car on pensait vraiment pouvoir gagner. On avait une équipe très, très forte, même si nous n’avions pas eu un Mondial simple. On pensait pouvoir aller au bout. Perdre un Mondial aux tirs au but, c’est forcément un moment difficile. On était déçus, mais aussi conscients d’avoir fait quelque chose d’important en arrivant jusque-là.
Comment se fait-il que le football italien ne produise plus de joueurs comme toi, comme Baggio, comme Totti ? Comme s’il y avait moins de magie.Oui, c’est vrai. C’est une question que tout le monde se pose un peu en Italie, un pays qui a produit par le passé ce type de joueurs. Je ne sais pas. Le football a changé. Le rôle fantaisiste de numéro 10 n’existe plus. Après Sacchi, je dirais même plus dans les années 2000, toutes les équipes se sont mises à jouer avec deux ailiers ou avec deux attaquants. Du coup, le 10 a été écarté des schémas tactiques des équipes italiennes. Je pense que c’est une première explication : les équipes de Serie A n’en avaient plus besoin pour la plupart, donc on n’en produisait plus. Aussi, il y a une autre grande raison : tous ces numéros 10 venaient du football de rue. On apprenait à jouer dans la rue. On nourrissait notre créativité de ce football-là, cette magie prenait sa source ici. Aujourd’hui, la grande majorité des joueurs arrivent des académies. Tu es plus formé, c’est indéniable, mais ce sont des endroits où tu as moins la possibilité d’inventer toi-même les gestes qui feront vibrer le monde demain. Moi, je n’ai pas commencé le football à l’oratorio (place publique proche de l’église où les petits Italiens usaient leurs genoux, NDLR) où beaucoup de footballeurs italiens de ma génération ont débuté. Mais l’oratorio, comme la rue, t’obligeait à inventer par toi moi-même. Dans la rue avec mes amis, on faisait marcher notre imagination après avoir regardé les matchs à la télé.
Lille se déplace à Chelsea ce mardi en huitièmes de finale de Ligue des champions. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais aux Lillois ?Je ne peux pas te donner ce genre de choses… (Rires.) Mais ce qui est clair, c’est que si Lille veut passer ce tour, il va falloir que le club sorte deux matchs exceptionnels en convertissant les opportunités qu’elle aura. Car ce Chelsea-là est une équipe extraordinaire.
![]()
Propos recueillis par Andrea Chazy