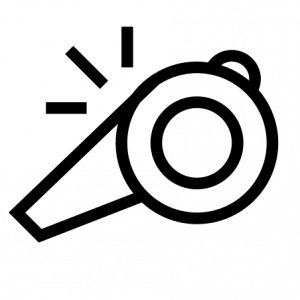Avant d’être l’entraîneur du FC Nantes, Michel Der Zakarian en a été l’un des joueurs clés dans les années 80. D’origine arménienne, le technicien a grandi à Marseille où il est arrivé à deux ans et a vécu pendant 15 ans. « J’étais supporter de l’OM et allais au stade dès que possible, car les moins de 13 ans rentraient gratuitement s’ils étaient accompagnés. » Un club où il n’a jamais joué, faisant carrière sur les bords de la Loire avant de rallier Montpellier pour la seconde partie de sa vie de joueurs, et ses débuts d’entraîneur. Le technicien partage les souvenirs de sa première vie dans le football.
Vous avez percé en 1981-1982 à Nantes, avec pas mal de matchs aux côtés de Maxime Bossis notamment…
Maxime Bossis, et même Henri Michel sur le premier match. L’année suivante, celle du titre de champion de France, j’ai peu joué, car je suis parti à l’armée et j’étais encore très jeune, c’était une équipe d’internationaux. Nantes et Saint-Étienne fournissaient la majorité de l’équipe de France. C’était l’ossature…
De cette époque nantaise, quels moments vous ont le plus marqué ? Votre but en quarts de finale de Coupe de l’UEFA contre l’Inter Milan ?
Oui, cela m’a marqué, mais les plus beaux souvenirs, cela reste le centre de formation, où c’était convivial et où on avait fait les 400 coups. Après, il y a eu de grands matchs, le titre, même si j’avais peu joué, car j’étais avec le groupe.
D’avoir côtoyé des joueurs comme Maxime Bossis, cela doit donner des souvenirs…
Max, c’était un gars très discret, pas un grand leader de vestiaire, mais un leader sur le terrain à travers ses actes. Mais il parlait peu et n’animait pas le vestiaire. Dans ce registre-là, c’était plutôt Henri Michel, Michel Bibard, José Touré…
Vous avez mentionné José Touré, l’un des joueurs les plus talentueux en France dans les années 80…
Il était un peu fou-fou, très généreux, mais il n’avait pas que le football en tête. On s’est battus plusieurs fois ensemble, car il était chambreur et même puant sur le terrain parfois. On était très copains, mais il nous arrivait de nous battre, avec les poings. C’est arrivé une ou deux fois qu’il y ait un nez qui saigne, on ne se faisait pas de cadeaux.
Une autre époque, aujourd’hui tout est beaucoup plus aseptisé…
Le système est comme ça aujourd’hui. Tout est médiatisé, un joueur arrive et fait deux-trois matchs de suite, il est en pleine lumière. À notre époque, il fallait vraiment faire ses preuves et intégrer l’équipe sur la durée pour gagner une notoriété, alors qu’aujourd’hui, cela va très vite.
À votre arrivée dans le groupe pro à Nantes d’ailleurs, les anciens vous ont fait comprendre qu’une place ne se donne pas, elle se prend ?
Clairement, pour prendre sa place dans le vestiaire, il fallait montrer de grandes qualités footballistiques et mentales. Mais il y avait aussi moins de joueurs, les effectifs n’étaient pas pléthoriques comme aujourd’hui. 16-18 pros, le reste, c’était des jeunes, mais en même temps, il n’y avait que treize places sur la feuille de match. Quand on n’était pas dans ces treize, c’était dur d’y entrer, car il n’y avait pas beaucoup de rotation. C’était souvent les mêmes qui jouaient et on devait attendre un blessé pour avoir une opportunité.
Ce match de Coupe d’Europe contre l’Inter Milan (quart de finale de Coupe UEFA 1986) où vous marquez votre seul but européen, c’est un gros souvenir quand même ?
Oui, j’étais persuadé qu’on allait passer. Mais on avait perdu 3-0 là-bas avec un but dans les dernières minutes. Si on n’avait perdu que 2-0 à l’aller, je pense que l’on aurait pu passer même si en face il y avait de grands joueurs, une grosse équipe. À la mi-temps, on menait 3-1, on n’était pas loin de l’exploit.
À l’époque, la Coupe UEFA était-elle mieux considérée par les joueurs ?
C’était différent. Même en Ligue des champions, il n’y avait pas de poules, c’était à élimination directe, on avait des matchs plus âpres, plus difficiles même en Coupe des coupes que j’ai vécue à Montpellier. Je pense qu’aujourd’hui, les joueurs ont encore conscience du caractère exceptionnel d’une Coupe d’Europe, mais à l’époque, c’était de suite des matchs couperets et pas un mini-championnat. Émotionnellement, c’était plus intense.
C’est à Montpellier que vous devenez international…
Arménien oui, mais sinon j’ai fait toutes les sélections de jeunes en France. C’est dommage, car j’arrivais en fin de carrière (en 1996, ndlr). Il y a eu cette opportunité, car la FIFA a donné une dérogation à l’Arménie pour convoquer des joueurs qui avaient évolué pour d’autres pays. C’était plus qu’une simple sélection pour moi, c’était revenir à mes sources. Je n’avais pas remis les pieds là-bas depuis 30 ans. Mes parents étaient retournés sur place, surtout ma mère. J’étais fier de porter les couleurs de l’Arménie, heureux de revoir la famille restée dans ce pays – des tantes et des oncles –, même si une grande partie avait migré aux États-Unis.
Pas de bol, au bout de neuf minutes contre le Portugal pour votre premier match…
(Il coupe) Ouais, je me suis claqué au mollet. Mais on fait quand même un nul, 0-0. J’étais déçu de sortir, je pensais que c’était le tendon d’Achille qui avait pété. Cette blessure a été annonciatrice de la saison qui venait, ma dernière comme joueur professionnel, avec beaucoup de blessures. Cela a contribué à ce que je m’oriente vers une reconversion comme éducateur.
Vous n’étiez pas le seul membre de la sélection à avoir grandi hors d’Arménie ?
J’étais arrivé avec Eric Assadourian de Lille. Il ne parlait pas la langue, mais moi oui, car je l’utilisais avec ma mère. Je n’avais pas un vocabulaire extraordinaire, mais j’arrivais à m’exprimer. Dans les rassemblements, je ne connaissais personne à part Eric, que ce soit les joueurs ou le staff. Mais on a été bien accueillis, mis dans les meilleures conditions. L’équipe avait des joueurs très bons techniquement, mais cela manquait de dimension athlétique et tactique. Il y avait tout à construire.
En 1997, vous entamez votre reconversion comme entraîneur, qui vous a transmis le virus ?
Tous les éducateurs que j’ai pu rencontrer, mais surtout Jean-Claude Suaudeau à Nantes. Il avait une façon de nous parler, de nous secouer… Il donnait envie de se battre pour une équipe. Le flambeau d’entraîneur vient plus de Nantes. Suaudeau nous faisait toujours réfléchir, il voulait qu’on comprenne le football, c’était un passionné qui nous demandait d’analyser après les entraînements.
C’est quoi vos premiers souvenirs forts dans ce nouveau rôle ?
Voir la progression des gamins, sentir qu’on les fait évoluer. Parfois on fait des conneries aussi. Il y a un gamin à Montpellier dont je me trompais sur le nom tout le temps. C’était grave, car visiblement cela le bloquait, moi je me demandais pourquoi il n’arrivait pas à passer des caps. Et un jour, il est venu me voir pour me dire que je me trompais sur son prénom depuis plusieurs mois. Mais je n’ai jamais eu de regrets de faire cette carrière. Je suis chaque saison à fond dedans : trois semaines de vacances dans l’année, le reste du temps je travaille même si j’arrive à couper une journée ou une demi-journée pas semaine.
Vous avez attendu 9 ans avant de passer du rôle d’éducateur à celui d’entraîneur en équipe première…
J’ai pris la décision en 2006, on est revenus sur la région nantaise parce qu’on voulait se rapprocher d’ici, s’y installer, car ma femme est d’ici. À Montpellier, j’avais fait le tour, on ne m’avait pas donné ma chance en équipe première, des gens étaient passés avant moi, alors que je pensais mériter d’avoir l’équipe. C’est pour ça que je suis parti, c’était bloqué. Mon contrat a pris fin et je suis parti sans garantie d’avoir quoi que ce soit ailleurs. Quelques mois plus tard, je dirigeais l’équipe première de Nantes, même si on n’a pas pu sauver le club de la relégation.
L’entretien complet de Michel Der Zakarian est à retrouver dans le SO FOOT CLUB #17, actuellement en kiosques.
Kombouaré prêt à jouer les chauffeurs pour faire venir Kolo Muani à Nantes