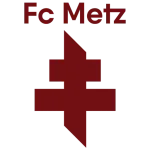- International
- Côte d'Ivoire
Baky Koné : « Le football, ce n’est pas pour les gosses de riches »

Récemment nommé directeur sportif de l’ASEC Mimosas, le club de ses débuts, l’immense Baky Koné retrace ici sa carrière mouvementée entre vente de tomates, Porsche Cayenne, Gwenn ha Du et baston générale.
Salut Baky, tu es désormais président de la section football de l’ASEC Mimosas. C’est une belle reconversion. J’ai toujours dit que si je commençais à l’ASEC, je finirais à l’ASEC. Le sang « Mimo » coule dans mes veines depuis tout petit, mon père était un fervent supporter du club. S’il était encore là aujourd’hui, je sais qu’il serait fier de moi.
Tu peux nous expliquer en quoi consiste ta nouvelle fonction ?Mon rôle se rapproche de celui d’un directeur sportif. L’ASEC est un club omnisports qui comporte aussi une section volley, basket et natation, mais le football en reste l’activité principale. J’apporte mon expérience aux jeunes dans ce domaine et j’apprends auprès du président Roger Ouégnin pour tout ce qui touche à l’administratif.
Qu’est-ce que représente l’ASEC à l’échelle de la Côte d’Ivoire ?C’est le club le plus populaire et le plus titré, celui qu’on cite avant tous les autres. Dans chaque pays, il y a toujours deux équipes au sommet : Paris et Marseille en France, le Real et le Barça en Espagne…. En Côte d’Ivoire, c’est l’ASEC et l’Africa Sports, qui est un autre club d’Abidjan. Le reste vient après. Dans la société ivoirienne, l’ASEC bénéficie d’une image prestigieuse, à laquelle beaucoup de supporters s’identifient. Le club a eu un rôle de locomotive en matière de formation, qui a poussé la concurrence à développer des académies sur notre modèle.
Dans les rues d’Abidjan, le Real et le Barça semblent très populaires. Est-ce que l’ASEC parvient tout de même à rester attractif auprès des Ivoiriens ?On essaie de l’être. Depuis la crise politique qu’a traversée le pays dans les années 2000, les choses ont beaucoup changé. Avant, quand il y avait un derby entre l’ASEC et l’Africa, les gens dormaient devant le stade pour être sûrs d’avoir une place ! Aujourd’hui, ce n’est plus pareil. Les gens vivent avec les mêmes moyens qu’avant, mais le coût de la vie, lui, a beaucoup augmenté. Ce n’est donc plus aussi simple d’aller au stade. C’est devenu trop cher pour beaucoup de supporters.
Sans oublier que les talents s’envolent pour l’Europe dès qu’ils en ont l’opportunité…On essaie de les garder chez nous le plus longtemps possible. Sur ce point, à l’ASEC, on est plutôt privilégiés : nos installations de Sol Béni sont parmi les plus développées du continent et on fait partie des rares clubs qui n’ont pas de problèmes de retards de paiement. C’est pour ça que beaucoup de jeunes talents veulent venir chez nous, ils savent que nous sommes la meilleure vitrine pour leur permettre de s’exposer. Reste que nous manquons cruellement de soutien de la part de la Fédération. Mais ça, c’est un autre problème.

À quoi ressemblait ta jeunesse avant de rejoindre l’ASEC ?Je suis originaire d’un quartier populaire qui s’appelle Adjamé. Comme Kader Keita, je travaillais au marché toute la journée pour aider ma mère. Ici, les gens le surnomment « Popito » , car il vendait des glaces. Moi, c’était des tomates. C’était difficile, mais cela m’a beaucoup aidé pour la suite de ma carrière, cela m’a forgé le caractère. Le football, ce n’est pas pour les gosses de riches. Quand tu n’as pas un passé douloureux, tu ne peux pas surmonter certaines situations.
Tu te souviens de ce que tu as fait avec ton premier salaire ?J’ai acheté un sac de riz à ma mère. Quand l’ASEC m’a pris en charge, cela a enlevé un poids des épaules de ma famille, car il y avait une bouche de moins à nourrir.
À la fin des années 1990, tu fais partie de cette génération formée par Jean-Marc Guillou, qu’on a plus tard appelée les Académiciens. Quel souvenir gardes-tu de cette période ?Celui d’un groupe de potes avec des rêves plein la tête, qui a vécu une aventure exceptionnelle. Quand on se retrouve, on peut en parler pendant des heures. On était extrêmement soudés parce qu’on savait qu’il fallait être ensemble pour s’en sortir et pouvoir aider nos familles. C’était notre objectif premier.
Le moment phare de ton passage, c’est la victoire lors de la Supercoupe d’Afrique en 1999. Une victoire qui est restée dans toutes les mémoires. C’était la première fois qu’on a eu l’occasion de se mettre vraiment en avant aux yeux du grand public. L’équipe première de l’ASEC avait remporté la Ligue des champions africaine, et le président a alors décidé de montrer le travail de l’Académie en alignant les espoirs pour la Supercoupe face à l’Espérance sportive de Tunis. C’était un pari osé, car l’Espérance à l’époque, c’était du solide, l’équipe intouchable en Afrique. Quand on est entrés sur le terrain, les joueurs nous ont regardés en mode « c’est qui ces gamins, là ? » Il faut savoir que pour me chambrer, mes coéquipiers me demandaient d’aller me cacher dans un placard à cause de ma petite taille, car ils pensaient qu’en me voyant, les adversaires n’allaient pas nous respecter. Comme on remplaçait l’équipe vainqueur de la Ligue des champions, le public était fâché et se disait qu’on allait forcément se faire battre. Au début du match, les gradins sont presque vides, et à la fin, le stade est plein. Les gens regardaient la télé à côté du stade et quand ils ont vu qu’on gagnait, ils ont commencé petit à petit à venir nous encourager.
Quel genre de joueur étais-tu dans le vestiaire ? Je ne parlais que quand c’était nécessaire, le reste du temps, je faisais des blagues avec les autres, on n’arrêtait pas de se taquiner et de se donner des surnoms. Moi, j’en avais quarante mille ! Et il ne fallait pas se fâcher quand on t’en donnait un, sinon tu pouvais être sûr qu’il allait te poursuivre sans cesse ! Si je devais en citer un, ce serait « Pétoulé » , je ne vous révélerai pas ce que ça signifie, mais c’est en lien avec ma taille. Nous étions des enfants, il n’y avait pas un boss sur le terrain, nous étions tous les boss, c’est cette solidarité qui nous a permis de réussir ce que nous avons fait.
En 2002, tu es un des derniers à quitter la Côte d’Ivoire pour une destination plutôt inhabituelle en début de carrière : le Qatar.Je ne sais plus qui m’a parlé d’une opportunité là-bas et je l’ai saisie, car après quatre saisons à l’ASEC, c’était le moment de partir. Je voyais mes frères s’en aller les uns après les autres et je commençais à saturer. J’ai longtemps attendu à cause de ma taille. On me disait trop petit pour jouer l’Europe. Avec le recul, je n’en veux pas à ceux qui disaient ça, car leurs critiques m’ont aidé à devenir ce que je suis aujourd’hui. Ils pensaient me faire du mal, mais cela m’a juste motivé. Chaque fois que je montais sur le terrain, je me disais qu’il fallait que je prouve à ces messieurs qu’ils avaient tort. Du coup, des buts de la tête, j’en ai mis beaucoup ! J’avais même un meilleur jeu de tête que pas mal d’attaquants de deux mètres. Je ne suis pas prétentieux, c’est la vérité.
À Doha, ton entraîneur s’appelle Christian Gourcuff. Il se souvient de toi comme « un petit joueur, un peu paumé » . C’est une rencontre qui a changé ma vie. En arrivant au Qatar, je ne savais rien faire. Ni parler anglais, ni me faire à manger, rien du tout. Alors je me suis réfugié dans ce que je savais faire de mieux : jouer. Et j’ai eu la chance de tomber sur quelqu’un de merveilleux : Christian, mais aussi toute sa famille. Sa mère m’a fait mon visa pour la France à la fin de mon année au Qatar, car je ne voulais pas rentrer en Côte d’Ivoire. Au départ, c’était juste pour prendre des vacances et rendre visite à mon frère qui jouait en CFA à Pontivy. Et puis Gourcuff m’a appelé : « Est-ce que tu aimes la couleur orange ? » J’ai répondu : « Oui coach, c’est la couleur de mon pays, forcément que je l’aime. » Et lui m’a dit : « Ça te dirait de signer avec moi à Lorient ? »
Comment c’était, la découverte de l’Europe ? Il y a un truc auquel je n’ai jamais vraiment réussi à m’adapter, c’est l’hiver. Aujourd’hui encore, je déteste l’hiver et quand je raconte ça aux jeunes frères ici, je me demande encore comment j’ai fait pour jouer quand j’avais les doigts et les orteils qui gelaient. À part ça, je n’ai pas grand-chose à dire parce que je suis quelqu’un de très casanier. Tous les soirs, je rentrais complètement crevé parce qu’à l’entraînement, je me donnais à fond pour donner tort à ceux qui n’avaient pas cru en moi et rendre à Christian ce qu’il m’avait donné.
Ton passage à Lorient dure deux ans, pendant lesquels tu vas devenir un des chouchous du public.Je ne vais pas vous mentir, ce sont les plus belles saisons de ma carrière. En y repensant encore aujourd’hui, j’en ai la chair de poule. J’aurais pu partir à l’hiver 2005, Lille et Nantes me voulaient, alors que Lorient était relégable. Mais j’ai demandé au coach, chez qui j’ai habité pendant presque un an, s’il avait besoin de moi. Il m’a répondu : « Oui, j’ai besoin de toi, mais si tu as une possibilité pour partir, tu ne devrais pas la rater. » Je l’ai coupé et je lui ai dit : « C’est bon, coach, si vous avez besoin de moi, je reste. » On a terminé 10es et moi meilleur buteur de Ligue 2. Le soir du dernier match, les supporters m’ont remis le drapeau breton et pleuraient parce que j’allais partir. C’était incroyable, j’en suis encore ému.
On se souvient cette année-là du duel épique entre toi et Robert Malm, l’attaquant de Grenoble. On luttait à distance pour être le meilleur buteur. Quand je marquais, on venait me voir pour me dire qu’il avait marqué un doublé ou un triplé dans le même temps. Mais ce n’était pas forcément vrai, c’était juste pour me motiver, car je suis un homme de défi ! J’ai parlé avec lui récemment, et il m’a révélé qu’on lui disait la même chose avec moi ! J’ai eu l’occasion de le remercier, car c’est quelqu’un qui m’a poussé à devenir meilleur.
Pourquoi tu es parti à Nice si tu étais si bien à Lorient ?Par la force des choses. C’était le moment pour moi de franchir un palier. Frédéric Antonetti a eu son importance, car c’est un coach qui a du caractère, du franc-parler et qui fait énormément progresser les joueurs. Moi, j’adore qu’on me dise le fond de sa pensée. Quand tu ne le prends pas mal, tu ne peux qu’être meilleur. À quoi ça mène de se prendre la tête avec quelqu’un ? Antonetti est plus expressif que Gourcuff, il m’a apporté cette niaque qui me manquait jusqu’alors.
![]()
On ne garde pas forcément de toi l’image d’un joueur très agressif… Pourtant, j’ai eu quelques cartons dans ma carrière. À Lorient, j’ai même été suspendu trois matchs pour une bagarre générale contre Saint-Étienne. Un adversaire (Vincent Hognon, N.D.L.R.) avait dit des choses sur ma mère. C’était la seule chose à ne pas faire ! Je lui ai répondu : « Toi et moi, on va mourir ensemble » , et je ne l’ai pas lâché de tout le match. À la fin, il a essayé de me choper, bien sûr j’ai répondu et ça s’est terminé en bagarre. J’en ai parlé avec Gourcuff et il a compris le pourquoi du comment. Je ne suis pas fier de cet épisode, mais je ne le regrette pas. Il y a des choses auxquelles on ne touche pas.
Tes années niçoises correspondent aussi à tes premières sélections en équipe nationale, dans un contexte assez chaotique. Oui, je garde de ces années troubles une aversion profonde pour la politique. Mais au niveau purement footballistique, c’est la période où on qualifie la Côte d’Ivoire pour sa première Coupe du monde. Cela n’a été possible que parce que nous étions un groupe qui se connaissait très bien et qui a pris à cœur son rôle d’ambassadeur. La Côte d’Ivoire sortait de plusieurs années difficiles et la population s’est réfugiée dans le football parce que rien d’autre ne pouvait apporter de la joie et du réconfort. C’est notre parcours cette année-là qui a aidé à entamer une réconciliation nationale.
![]()
Que retiens-tu ensuite de ton passage à l’OM ? La musique de la Ligue des champions, c’était sympa. Après, l’OM, c’est particulier, parce que c’est là que j’ai remporté mon premier trophée depuis la Supercoupe avec l’ASEC. En 2009, on manque le titre de peu et l’année suivante, on fait le doublé championnat-Coupe de la Ligue avec un super groupe. Et surtout, pour le petit Africain que j’étais à l’époque, Marseille c’était le club de référence. J’arrivais après Abedi Pelé, Basile Boli, Didier Drogba, donc il y avait aussi une certaine fierté à porter ce maillot.
Tu étais aussi casanier qu’à Lorient ou tu sortais un peu ?Non, je restais à la maison, je regardais des films à la télé, surtout des histoires vraies, et je passais des coups de fil. J’ai aussi lu pas mal de bouquins, avec une préférence pour les ouvrages de philosophie. C’est une discipline qui m’a beaucoup aidé à faire la part des choses. Je le répète encore aux jeunes aujourd’hui : il faut bien travailler à l’école et ne jamais oublier qu’il y a un jour où ta carrière s’arrête. Et qu’est-ce que tu vas faire après ? Ce qui va te rester, c’est ce que tu as appris à l’école. Si tu ne sais pas t’organiser, la fin risque d’être très dure.
Tu as la réputation d’être quelqu’un de très méticuleux…Oui, quand j’étais joueur, je lisais mes contrats de la première à la dernière ligne. C’était moi et personne d’autre qui décidais de là où j’allais jouer. Quand j’avais des questions, je les posais et j’allais me renseigner, sans hésiter à interrompre les négociations. C’est dans ma nature.
Tu n’as donc jamais fait de folie dans tes jeunes années ?Ma seule faiblesse, c’est que j’ai toujours bien aimé les voitures. Au Qatar, j’ai acheté un Porsche Cayenne qui venait à peine de sortir, et franchement c’était un peu trop cher. J’ai culpabilisé sur le moment, parce que c’est comme si j’avais oublié d’où je venais. Tu te dis que tu peux utiliser l’argent pour faire quelque chose de meilleur. Encore aujourd’hui, j’en ai un peu honte… Malgré le succès, il ne faut jamais oublier qu’il y a des personnes qui souffrent et qui n’ont pas la même chance que toi. Avoir des facilités, ça ne veut pas dire narguer les gens ou leur montrer tout ce que je possède. C’est triste à dire, mais la jalousie est un fléau en Afrique. Quand je vendais les tomates au marché avec ma mère, personne ne me calculait. Maintenant que le petit Bakari est devenu grand, les gens regardent ce que je suis et ce que j’ai. Ce qui les intéresse, c’est la carcasse, pas ce qu’il y a au fond.
![]()
Propos recueillis par Julien Duez et Christophe Gleizes, à Abidjan
Photos : JD et Icon Sport