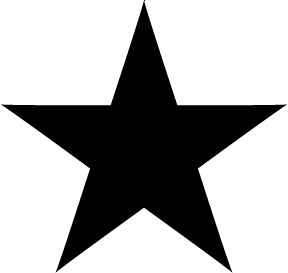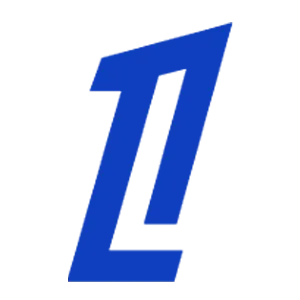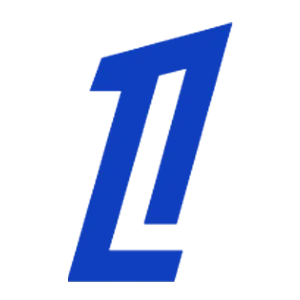- Tous championnats
- Réflexion
Un entraîneur doit-il parler la langue de ses joueurs ?

Les coachs s'exportent de plus en plus, et certains d'entre eux sont loin d'être bilingues. Mais un entraîneur qui ne parle pas la langue de ses joueurs, est-ce préjudiciable ? Existe-t-il des vrais problèmes de communication dans un vestiaire riche en nationalités ?
Très rares sont les fois où on a vu Marcelo Bielsa utiliser le langage français la saison dernière. S’il était largement capable de le comprendre – certaines conférences de presse le montrent –, El Loco ne parlait pas français, car il avait « peur du ridicule » . Et quand on entend un coach comme Vahid Halilhodžić tenter de se dépatouiller de la langue de Molière, les rires ne sont effectivement jamais très loin. Au-delà des erreurs syntaxiques et des oublis de pronoms, les difficultés de langue d’un entraîneur posent question : cela pose-t-il un réel problème au sein même d’un vestiaire ? La compréhension des joueurs en est-elle vraiment affectée ? Et les résultats s’en ressentent-ils ?
Évidemment, parler la langue de ses joueurs sera toujours un avantage. Personne ne dira le contraire. Expliquer un schéma tactique, une idée précise de jeu ou un comportement bien défini sans la barrière de la langue ne peut être que plus optimal. Sauf que cette barrière, quand elle existe, semble facilement et largement franchissable avec un peu d’effort. « Quand je suis arrivé en Arabie saoudite, je ne parlais pas un mot d’arabe, se souvient Patrick Suffo, ancien joueur camerounais qui a évolué dans pas moins de huit pays différents. J’étais le seul dans ce cas-là. Alors, ça m’a joué des tours au début. Une fois, je me suis fait remplacer à la mi-temps, parce que, soi-disant, je ne captais pas les consignes du coach. Mais après quelques semaines, ça roule : d’abord, tu utilises des gestes, puis tu t’intéresses un peu à la langue, tu apprends les bases. » Un avis partagé par Bernard Casoni, qui a évolué en France et qui a notamment entraîné en Tunisie, en Arménie et en Hongrie : « Par des gestes de main ou des regards, on arrive sans difficulté à se faire comprendre. Il suffit de quelques mots rudimentaires pour dépasser les éventuels soucis dus à la langue. »
What’s the problem ?
Pour Joseph-Antoine Bell, qui a fait partie de l’épopée du Cameroun en 1990 – après avoir battu l’Argentine championne du monde en titre, les Lions indomptables avaient atteint les quarts de finale, une première pour un pays africain – alors que Valeri Nepomniachi, le sélectionneur de nationalité russe, ne parlait pas un mot de français ou d’anglais, c’est carrément un faux problème : « Une langue commune facilite les choses, c’est vrai, mais est-ce toujours d’actualité quand on voit les effectifs des clubs qui réussissent ? Prenez le PSG et ses joueurs aux nationalités toutes différentes : quelle langue parle-t-on dans le vestiaire ? Et combien de joueurs maîtrisent parfaitement le français que Blanc emploie ? »
Les footballeurs seraient donc aisément capables de faire avec un entraîneur qui ne cause pas leur langage. « Un bon coach est pédagogue et a les idées claires. Il parvient toujours à les transmettre d’une manière ou d’une autre » , reprend Bell. Surtout, la bonne connaissance du ballon rond aurait un rôle prépondérant, comme l’explique Casoni en prenant l’exemple de deux coéquipiers : « Quand deux personnes sentent le football, ce n’est pas compliqué de se comprendre. À l’OM, Chris Waddle ne parlait pas le français, Carlos Mozer non plus, et ça ne nous empêchait pas de communiquer. On apprend à se connaître, puis on anticipe la réaction de l’autre sur le terrain. Le football, c’est un langage universel. »
Google traduction
Reste que les entraîneurs, pour pallier leur défaut de langage, utilisent parfois un traducteur. Ce qui n’est pas toujours une bonne idée, estime Suffo : « En Arabie saoudite, j’ai eu un entraîneur roumain qui parlait hyper mal l’anglais. Du coup, il se sentait obligé d’avoir un traducteur avec lui non stop. Bah c’était pas terrible. La perception du discours n’est pas du tout la même quand c’est quelqu’un d’autre que toi qui délivre ton message. » Bell renchérit : « Lors de la Coupe du monde 1990, notre sélectionneur parlait russe et avait son traducteur. Mais il comprenait un peu le français, et il lui arrivait régulièrement de reprendre son interprète parce qu’il avait mal relaté son discours. »
La solution idéale ? Choper un mec qui s’y connaît lui aussi. « La majorité des coachs qui ne parlaient pas la langue locale avaient besoin d’un interprète pour communiquer, rapporte Benoît Croissant, défenseur français aujourd’hui retraité et qui a tapé la balle en Angleterre, aux Pays-Bas, en Égypte, en Chine ou encore à Singapour. La clef du succès, c’est de trouver un interprète qui comprend le football et qui est capable de retranscrire les bons messages aux joueurs, aux managers et aux médias. »
Guardiola, Mourinho, Bielsa, Blanc et Santini
Mais même si le traducteur est mauvais, un petit laps de temps permet aux joueurs de s’adapter à l’entraîneur et ses discours. Car le vocabulaire utilisé n’est pas non plus des plus riches ou des plus complexes. « Dans le foot, il faut quand même noter que ce sont toujours les mêmes mots qui ressortent. C’est une répétition de consignes, appuie Suffo. Quand j’ai eu Winfried Schäfer en sélection camerounaise entre 2001 et 2003, son traducteur ne servait quasiment à rien à la fin, car le coach répétait toujours les mêmes discours. Résultat : on a remporté la CAN. »
N’empêche que pour faire partie des meilleurs du monde, être bilingue semble être indispensable pour un technicien. Pep Guardiola parle six langues et a tenu à apprendre l’allemand avant même d’arriver à Munich. José Mourinho en manie couramment cinq. Même Laurent Blanc maîtrise l’italien et l’anglais, en plus du français. De quoi renforcer les relations avec certains joueurs. Benoît Croissant conclut : « Un coach doit maintenant savoir parler plusieurs langues, surtout lorsqu’il veut s’expatrier et entraîner des équipes qui jouent des compétitions internationales. » On dira que Marcelo Bielsa est l’exception qui confirme la règle. Mais que Jacques Santini n’y déroge pas.
Quels sont les clubs de Ligue 1 les plus affaiblis par la CAN ?Florian Cadu