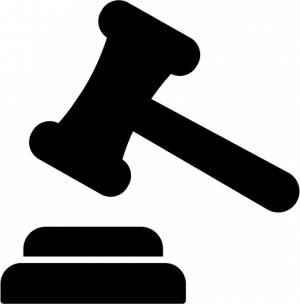- France
- Marseille
Tactique : Jorge Sampaoli, à la poursuite de l’euphorie

Attendu à Marseille en fin de semaine, l'entraîneur argentin, qui bosse sur les matchs de l'OM avec son staff depuis plusieurs jours, engendre une énorme attente et un fantasme : refaire du club marseillais un volcan capable d'érupter de nouveau sur la France du foot. Voilà ce que ça peut donner, quand tout s'aligne.
Jorge Sampaoli entend un cri, ou plutôt des cris. Debout sur le gazon du stade municipal de Concepción, l’Argentin tend alors l’oreille, de manière à pouvoir distinguer les mots éructés par une foule massée dans un coin de l’enceinte. « Sampaoli, Sampaoli, yo te quiero agradecer por hacer jugar al Bulla, como lo hacía el Ballet » (« Sampaoli, Sampaoli, je souhaite te remercier pour avoir fait jouer la Bulla, comme elle le faisait à l’époque du Ballet » en V.F., le Ballet faisant ici référence au Ballet Azul, surnom donné à la génération d’Universidad de Chile qui a enchaîné les titres dans les années 1960). C’est un soir de décembre, en 2012, une nuit où Sampaoli vient de mettre un point final à l’un des chapitres les plus riches de sa vie : un chapitre éclatant et audacieux, qui l’a vu changer de dimension et lui permet d’être attendu, le lendemain, à Santiago, pour être fait sélectionneur national du Chili. Mais pourquoi lui, au juste ? Au moins pour trois raisons. D’abord, car la Roja, sixième du championnat de qualifications à la Coupe du monde 2014, vient de prendre trois baffes consécutives et voit son ticket pour le Mondial brésilien brûler dangereusement. Ensuite, car Sampaoli est le coach du moment, celui qui a réussi à refaire d’Universidad de Chile une équipe pétillante et bagarreuse, si pétillante que la U a remporté la Copa Sudamericana en 2011 en bouclant au passage le tournoi invaincue après avoir filé plusieurs leçons, et qu’il semble être le seul capable de refiler une âme à une sélection nostalgique de Marcelo Bielsa. Enfin, car le coach râblé ne vient pas seul, mais accompagné d’une vieille promesse : celle de rendre les gens « euphoriques ». Alerte : si les résultats n’ont pas toujours suivi, Sampaoli a quasiment toujours tenu parole.
À revoir : l’un des chefs-d’œuvre de Sampaoli avec la U face à Flamengo (0-4), lors de la Copa Sudamericana 2011.
« Je pense plus au but d’en face qu’à préserver le mien »
Peut-être avant tout car euphorique, Jorge Sampaoli, qui a un temps été banquier après la fin prématurée de sa carrière de joueur, l’est aussi le long de la ligne de touche. « Je suis incapable de rester en place, justifiait-il en 2016 lors d’un entretien donné à So Foot. Sur la touche, j’ai besoin de marcher, de faire des allers-retours pour réfléchir. Ça fait venir les idées plus facilement. En étant assis, je ne peux pas penser, j’ai des fourmis dans les jambes. » Voilà pourquoi le tatoué de Casilda se voit plus en « entraîneur de basket » qu’en coach de foot, qu’il aime faire corps avec son gang et qu’il ne peut se contenter d’être une tête pensante et distante enfouie au fond d’un banc. Le personnage n’est aujourd’hui plus à présenter. Il y a eu Sampaoli l’ado qui se rebelle face à la dictature des généraux et qui aide à organiser des groupes pour lutter contre la répression malgré un père flic, Sampaoli le jeune coach qui donne des consignes grimpé dans un arbre en septembre 1995 après avoir été expulsé, alors qu’il était simple entraîneur de l’équipe de son bled, Sampaoli le fan de rock barrial, ou encore, plus récemment, Sampaoli qui entre sur le terrain pour pourrir un arbitre après un penalty sifflé contre son équipe. Il est comme ça, Jorge, il « souffre le football » et ne savoure rien. Mais a-t-il été heureux, au moins, de remporter la Copa América avec le Chili en 2015 ? « Non, j’ai plutôt ressenti de la tranquillité, le sentiment du devoir accompli, d’avoir fait du très bon boulot… Plus qu’une célébration, ça a été un soulagement, comme si mon corps et mon esprit étaient enfin détendus. »

Revenons à la promesse d’un jeu qui rend le public « euphorique », une volonté qui a toujours été scotchée à la mâchoire de Sampaoli, lui qui voit le foot de la même manière que Bielsa, soit comme un objet de révolte permettant de renverser l’ordre établi. À So Foot : « J’ai toujours essayé de développer un jeu qui a de la personnalité, basé sur la possession, la volonté d’attaquer. Quand je suis arrivé chez les pros, j’ai tout de suite pensé que j’avais trois matchs pour faire mes preuves. Comme je n’étais pas un coach connu, je serais viré facilement, je ne durerais pas beaucoup plus que cela si ça ne fonctionnait pas. L’idée était de marquer les esprits. Je ne pouvais pas faire quelque chose de banal, je devais être différent. J’ai préparé mes équipes ainsi et j’ai réussi à faire de mes équipes des équipes dominatrices. » Mais comment ? « En faisant l’inverse de ce que font tous les entraîneurs aujourd’hui : je pense beaucoup plus au but d’en face qu’à préserver le mien. Même si on a une petite équipe, il faut avoir l’idée de regarder l’adversaire dans les yeux et la volonté d’imposer son rythme… » Preuve en a été donnée lors du Mondial 2014, pour lequel Jorge Sampaoli a finalement réussi à qualifier le Chili et où l’Argentin a vu ses hommes mettre en mondovision ses rêves. Sur quatre matchs (Australie, Espagne, Pays-Bas, Brésil), on a tout vu : un pressing étouffant, une intensité harassante, des latéraux ultramobiles, des centraux (Jara et Medel) utilisés pour mener le jeu, des une-deux, du « passe et suit » , des permutations offensives, des projections des relayeurs (Vidal et Aránguiz)… Mais surtout des résultats.
Au Brésil, le Chili ne s’est pas contenté de planter son regard dans celui de ses proies. Non, au Brésil, la Roja a transformé chaque rencontre en combat et s’est notamment payé le luxe de régler l’Espagne (2-0), juste après s’être baladée avec quelques secousses en seconde période contre l’Australie (3-1), offrant au passage un but, le premier signé Alexis Sánchez, qu’il est possible d’élever en modèle pour exposer le football selon Sampaoli. À savoir : une séquence de plus d’une minute de conservation, où quasiment tous les joueurs touchent le ballon (excepté Marcelo Diaz, dont un déplacement a quand même permis le début de la séquence), où le bloc australien est baladé sur la largeur, où Vidal va attendre l’exact bon moment pour dégainer une diagonale merveilleuse pour Aránguiz alors venu compenser un déplacement d’Isla sur le côté droit, et où Alexis Sánchez va venir finir en force après un duel aérien remporté par Vargas.
 Après une touche jouée côté gauche par Mena, le Chili ressort le ballon avec ses centraux (Medel et Jara), alors que Diaz décroche pour emmener Cahill et ouvrir un espace pour sortir tranquillement.
Après une touche jouée côté gauche par Mena, le Chili ressort le ballon avec ses centraux (Medel et Jara), alors que Diaz décroche pour emmener Cahill et ouvrir un espace pour sortir tranquillement.
 Rapidement, un ballet se met en route, alors que Jara remonte le ballon : Mena prend son côté, Vargas dézone, et Vidal prend la profondeur. Le bloc australien doit être ultraconcentré pour ne pas perdre pied.
Rapidement, un ballet se met en route, alors que Jara remonte le ballon : Mena prend son côté, Vargas dézone, et Vidal prend la profondeur. Le bloc australien doit être ultraconcentré pour ne pas perdre pied.
 Après une phase de conservation horizontale, Vidal déclenche une diagonale pour briser l’organisation adverse…
Après une phase de conservation horizontale, Vidal déclenche une diagonale pour briser l’organisation adverse…
 … il va trouver Aránguiz, qui remet en une touche vers Sánchez. Derrière, le Chili va ouvrir le score.
… il va trouver Aránguiz, qui remet en une touche vers Sánchez. Derrière, le Chili va ouvrir le score.
Cette Coupe du monde brésilienne est parfaite pour aborder une première facette de Jorge Sampaoli : l’Argentin n’est pas un dogmatique comme peut l’être Bielsa, son modèle absolu dont il écoute souvent les causeries, mais un pragmatique, qui jongle entre les schémas pour s’adapter à un adversaire donné. Au Mondial, on a alors vu le Chili dominer l’Australie avec un 4-3-3 sans neuf (Valdivia n’étant pas une pointe, mais plutôt un enchanteur voyageant entre les vagues comme un poisson dans l’eau) qui devenait un 3-4-3 avec ballon où Diaz reculait au niveau de Jara et Medel, puis le Chili sortir gagnant du bras de fer contre l’Espagne avec un 3-4-1-2 où Vidal a martyrisé Busquets et où Aránguiz a fait perdre la tête à Xabi Alonso – ce qui revient à hacker un ordinateur – et enfin le Chili s’incliner face à des Pays-Bas cyniques dans un 3-5-2, avant de tomber cruellement aux tirs au but face au Brésil en 3-4-2-1. Entre les schémas, l’important était situé dans deux constantes : une équipe de Sampaoli pressera toujours haut et cherchera toujours à avoir la possession (au Brésil, elle n’a concédé la possession qu’à l’Espagne, ce qui n’a quand même pas empêché la Roja de repartir avec le butin). « L’idée, c’est d’être toujours dominateur, décrypte le coach. Pour moi, l’idéal, pour développer un jeu de possession et soumettre l’adversaire, c’est le 3-4-3 de Cruyff. Mais le dispositif peut changer, car il doit juste être un moyen de soumettre l’adversaire.(…)Ensuite, pour dominer l’adversaire, tu dois avoir le ballon. Il n’y a qu’un seul ballon sur le terrain, donc il est obligatoire de l’avoir plus de temps que l’adversaire pour le dominer. Surtout, la récupération est la clé. Quand tu perds le ballon, il faut le récupérer en moins de cinq secondes pour pouvoir le garder à nouveau. Si tu perds le ballon dans la surface adverse et que tu ne parviens à le récupérer que dans ta surface, les transitions sont alors favorables à l’adversaire. » Simple, non ? Surtout terriblement efficace lorsque les planètes s’alignent.
Années 1990 et wagon
C’est ce qu’on a notamment vu lors de la Copa América 2015, remportée par le Chili à la maison avec un système alternant entre 3-4-1-2 et 4-3-3, mais toujours tenu par un Jorge Valdivia solaire en meneur de jeu, à qui Sampaoli a un jour tenu ces propos : « Jorge, tes jambes ne m’intéressent pas. Je veux tes yeux, rien d’autre. » Il est important de ne pas oublier le joueur formidable qu’a été Valdivia, dont la lecture de jeu a un jour réussi à briser à elle seule le cadre posé par l’Uruguay de Tabárez lors d’un quart de finale de cette même Copa. Numéro 10 à l’ancienne ou faux 9 moderne, l’ancien danseur de Palmeiras a été le cerveau du succès de la Roja, capable d’échapper à n’importe quel coup de faux et de déstabiliser n’importe quel bloc malgré de nombreux ballons perdus inhérents à son amour du risque. Ce qui nous amène à une autre facette de Sampaoli. Si l’Argentin est un monstre d’analyse, c’est aussi quelqu’un qui accorde une place minuscule à la technologie, et ce, pour une simple raison : Jorge Sampaoli refuse de grignoter « la liberté de penser » de ses joueurs afin de ne pas dévorer « leur capacité de créer ». « La technologie a commencé à tuer le talent, précisait-il dans un long échange avec Jorge Valdano il y a quelques années. Aujourd’hui, tu vas à un entraînement, le terrain ressemble à une piste d’atterrissage.(…)Ce sont pourtant les joueurs qui décident. En tant qu’entraîneur, nous devons avoir différents moyens de répondre à un problème parce que nous ne fonctionnons pas comme un organisme qui suit un mode prédéfini. Nous avons mille nuances que les footballeurs peuvent utiliser. Mais finalement, ce n’est pas moi qui décide sur le terrain, mais eux. Je ne déplace pas des pantins, ce sont des êtres humains, qui vont rencontrer différentes situations durant le match. »

Des êtres humains que Sampaoli transforme en « pitbulls »une fois qu’ils ont enfilé leur short, comme l’a expliqué ces derniers jours Adil Rami. C’est aussi ce que son année passée à Séville, entre juillet 2016 et juin 2017, la seule de la vie du technicien argentin en Europe, a raconté. En Andalousie, tout n’a pas été parfait, mais Jorge Sampaoli, soutenu par Juanma Lillo, a réussi à implanter ses préceptes dans la tête de ses joueurs d’une façon assez incroyable, notamment l’idée d’étouffer l’adversaire (le FC Séville a terminé cette saison-là deuxième de Liga en matière de PPDA, l’indicateur de passes accordées à l’adversaire dans son camp) tout en mêlant la possession (56,4% en moyenne sur la saison, troisième meilleur taux du championnat).
 Exemple de prise à trois sur une sortie de balle de la Real Sociedad.
Exemple de prise à trois sur une sortie de balle de la Real Sociedad.
En Espagne, Jorge Sampaoli, qui a vu son groupe rendre la meilleure phase aller de l’histoire du club, terminer quatrième du championnat et notamment battre le Real Madrid (2-1), a ainsi réussi à marier, c’est son idéal, un maximum de joueurs techniques pour aboutir à un jeu de position. Steven Nzonzi se retrouvait alors dans la majorité des cas avec la double responsabilité d’arrêter les attaques adverses et d’orienter le jeu, un rôle essentiel étant donné que la plupart des joueurs sévillans étaient écartés en phase de possession. Le Français était, en revanche, souvent déchargé de la première relance. Samir Nasri ou Franco Vázquez, positionné comme des meneurs à l’ancienne façon Valdivia, dézonaient alors pour mettre en route la machine, ou plutôt le « wagon », Sampaoli aimant raconter qu’une équipe voyage « dans un wagon » et non dans un « train » (référence à la distance souhaitée entre les lignes). Sur certaines séquences, le Séville de Sampaoli a alors affiché des circuits inspirés du football total, sans que ce soit toujours extraordinaire, certains matchs voyant les Andalous mêler le très bon et le très ronronnant, ce qui peut engendrer, avec du recul, une bonne dose de frustration. Pour le meilleur, on gardera la folie du premier match face à l’Espanyol (6-4), une démonstration livrée à San Sebastián (0-4) ou le succès face au Real (2-1), mais aussi le fait que Sampaoli a remis l’audace et le dribble au centre du jeu tout en brillant souvent sur les ailes (notamment avec Mariano). Pour le moins bon, on a aussi le souvenir d’un coach parfois lunatique et d’une formation souvent sur un fil défensivement, Sampaoli demandant à ses joueurs, en phase défensive, d’être dans un individuel strict, ce qui, de par le profil des éléments alignés, a pu conduire à de nombreux trous dans le filet de protection.
Le foot de Sampaoli est comme ça : vertigineux avec ballon, mais aussi très exigeant à la perte, d’où l’idée d’un mélange entre « bielsismo et guardiolismo » (Sampaoli). À Séville ou avec le Chili, il aimait voir son équipe dépenser énormément d’énergie, imposer un rythme élevé, « jouer sans oxygène ». Surtout, l’Argentin assume son refus d’évolution : « Le foot a changé dans les années 1990, mais moi, je suis resté dans le foot d’avant. Le talent avant l’architecture du football, avec beaucoup de créateurs sur le terrain. » Ce qu’il veut, avant tout, c’est faire tomber amoureux ses joueurs de ses idées et qu’ils « prennent en main leur destin ». Il n’a pas toujours réussi. Il a même souvent échoué, notamment avec l’Argentine, où le chantier était immense et où Jorge Sampaoli n’a jamais réussi à se faire comprendre. « On ne savait jamais ce qu’il voulait, lâcha un jour Leandro Paredes. Sampaoli était très changeant. Parfois, il te disait de faire quelque chose et quand tu le faisais, il te demandait pourquoi tu l’avais fait. » Au Brésil, où il vient de passer les trois dernières années, tout n’a pas été rose non plus malgré des résultats, mais Marseille est un défi taillé pour sa folie, à condition de voir ses nouveaux joueurs s’impliquer à 200% sur toutes les phases et de retravailler certains profils, ce qui n’est pas négociable lorsqu’on attaque parfois à sept ou huit éléments. À condition, aussi, de voir les dirigeants assouvir certains de ses besoins, son arrivée à Séville ayant été suivie d’un paquet de chèques signés (Ben Yedder, Correa, Vázquez, Ganso, Nasri, Vietto, Mercado…). C’est aussi le prix pour atteindre un football euphorisant et pour toucher l’objectif ultime de Jorge Sampaoli, avoué lors de son départ de l’Atlético Mineiro : « Nous avons essayé de rendre les gens heureux… » N’est-ce pas ça, finalement, ce que demandent les supporters de l’OM ?

Par Maxime Brigand