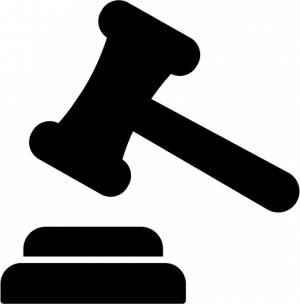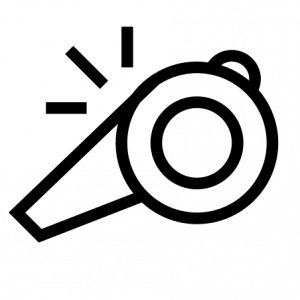Ce soir, c’est Metz-Bordeaux, forcément un souvenir particulier pour vous. Votre dernier match en pro, et vous sortez après six minutes de jeu, complètement KO…
C’est dommage pour moi d’ailleurs, car le club avait prévu une grosse fête pour ma retraite, mais j’ai dû me sauver (rires). C’est extraordinaire, mais je n’ai absolument aucun souvenir de ce match. J’ai pris le ballon en pleine tête et je me suis réveillé à l’hôpital une ou deux heures après. J’ai revu des images par la suite, mais je ne me rappelle rien personnellement, désolé. Cela a un peu gâché ma sortie, mais bon, en même temps, les accidents arrivent. J’aime son côté un peu inédit, très franchement cela ne me laisse aucun regret.
C’était finalement l’action la plus violente d’une carrière marquée par une superbe discipline, surtout pour un défenseur. 577 matchs joués en division 1, et aucun carton rouge…
Alors, déjà, c’est 578 ! J’y tiens (rires) ! Je ne sais pas pourquoi, mais ce dernier match contre Bordeaux il n’est compté nulle part ! J’espère que vous allez rétablir la vérité. Sinon, effectivement, j’étais un défenseur plutôt propre, c’est d’ailleurs ma plus grande fierté, au-delà des titres. Réussir à traverser 18 années de professionnalisme sans jamais être expulsé, c’est quand même pas mal. En tant que capitaine, je devais montrer l’exemple et être le garant d’un certain état d’esprit. J’ai ça en moi depuis tout petit.
À tel point que certains observateurs vous accusaient presque d’être trop gentil sur le terrain…
Je respecte les partisans de la manière forte et cette façon de jouer, mais je suis heureux de ce que j’ai fait et de la manière dont je l’ai accompli. J’avais envie de gagner, mais pas à n’importe quel prix. Certains disent que je n’étais pas assez méchant ou agressif pour le niveau international, mais très honnêtement, cela me laisse de marbre. Je suis resté moi-même tout au long de ma carrière.
C’est vrai néanmoins que votre expérience en équipe de France a été éphémère.
Neuf sélections, c’est beaucoup et pas beaucoup à la fois. Si cela n’a pas duré plus longtemps, c’est tout simplement que je ne devais pas avoir le niveau suffisant. À ma décharge, l’équipe de France ne traversait pas une très bonne période, on n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 1990. Je n’ai jamais vraiment su trouver ma place. Après Henri Michel, Platini m’avait fait confiance sur un match comme libéro, puis derrière il m’a replacé arrière droit. Cela n’a pas très bien marché, j’ai finalement été écarté, et c’était terminé.
Vous avez compensé par une longévité exceptionnelle au haut niveau… Bien calé entre Alain Giresse et Patrick Battiston, vous êtes le sixième joueur le plus capé de l’histoire du championnat.
Oui, et je le dois avant tout au FC Metz. J’ai pu exercer mon métier de footballeur – enfin, métier, c’est un peu sec comme terme, disons ma passion -, car j’ai toujours été en harmonie avec le président Carlo Molinari et l’entraîneur Joël Müller. Après mes passages à Toulouse et Saint-Étienne, je suis revenu car j’avais des liens forts et particuliers avec le club. On s’est retrouvés tout naturellement. Cela m’a fait du bien de finir ma carrière chez moi. Même si j’étais remplaçant en 1984, tous les succès du club, je les ai vécus, la Coupe de France en 1988 et la Coupe de la Ligue en 1996 en tête.
Quel est votre meilleur souvenir avec le FC Metz ?
Mon meilleur souvenir – le titre de vice-champion de France en 1998 – reste aussi ma plus grosse déception. C’était un parcours magnifique, une année extraordinaire. Au niveau de l’harmonie des joueurs et du groupe, je n’avais jamais vécu ça, c’était vraiment superbe à tout point de vue. Seules les quinze dernières minutes de la saison, quand Lens finit champion sur le fil, ont été cruelles. Mais bon, ce qui l’a emporté, tout de suite après le match, c’est le côté magnifique de notre épopée. Le soir même, j’avais déjà compris que notre exploit resterait dans les annales du club pour longtemps. On a tous eu conscience d’avoir réalisé une saison unique pour le FC Metz, et l’histoire l’a d’ailleurs prouvé.
Après votre carrière de joueur, vous vous êtes dirigé vers l’UNFP, dont vous êtes aujourd’hui le co-président.
Oui, depuis 2008. Quand j’étais joueur, j’avais déjà pas mal de responsabilités, j’étais déjà vice-président en 1998. Quand j’ai arrêté ma carrière le 30 juin 2001, je suis devenu salarié. Aujourd’hui, notre action se concentre sur deux grands volets. D’abord, la représentation et la défense des joueurs par rapport aux institutions, que ce soit le ministère des Sports, l’Assemblée nationale ou le Sénat. Nous avons aussi deux places au conseil d’administration de la ligue. L’autre grand volet, c’est les services que nous offrons aux joueurs, dans des domaines aussi différents que l’assurance, le conseil financier ou le management. On a été joueurs et on connaît la particularité du milieu, nous sommes les mieux placés pour adresser des messages préventifs et les protéger juridiquement.
Pourquoi l’UNFP ?
Cela m’a toujours intéressé quand j’étais footballeur. J’étais vraiment concerné par l’aspect collectif, la représentation, le fait de défendre des choses ensemble. Je retrouve ces mêmes valeurs de solidarité et d’entraide à l’UNFP. On est sur du partage et de l’échange. Ce sont des valeurs qui m’ont guidé tout au long de ma carrière… Ma reconversion s’est faite assez naturellement.
Entre-temps, vous avez quand même fait un passage remarqué en politique.
Oui, j’ai été adjoint aux sports à la mairie de Metz, début 2001. Pour tout vous dire, ça m’a bien plu. J’ai honoré mon mandat pendant sept années, c’était une très belle expérience qui m’a beaucoup aidé et appris, cela m’a ouvert l’esprit sur d’autres sujets. J’étais au contact des associations et des clubs, de la jeunesse, j’ai pu me forger une connaissance poussée de la ville et de tous ses rouages. C’était une formidable opportunité.
Pourquoi avoir arrêté ?
J’ai arrêté pour deux raisons. D’abord, on a perdu les élections en 2008 pour le renouvellement. J’ai participé à la campagne, mais j’avais déjà décidé quelques mois auparavant de privilégier l’UNFP. Il me fallait faire un choix, j’ai bien digéré la défaite. Ensuite, c’est vrai qu’en tant qu’adjoint, j’étais au cœur de ce qui se décide et se discute, j’ai pu participer aux débats, c’était très intéressant, mais ce n’est jamais allé aussi profondément que je l’aurais souhaité. Ce qui m’a déplu, c’est le côté politicien de la fonction. On a l’impression de voir le roi et sa cour, je trouve que la politique a un côté pathétique et très individualiste. Certains prétendent se battre au nom de l’intérêt général, mais en réalité, il n’y a que leur petite carrière qui compte. Ils ne pensent qu’à sauvegarder leur place, à plaire au maire et au patron. Moi, je n’essayais pas d’être sur la photo. La notoriété locale, grâce à ma carrière de joueur, je l’avais déjà.
Du coup, Metz ne vous manque pas trop ?
J’y suis toujours installé, même si je bosse à Paris ! Le TGV a été une formidable avancée, avant on mettait plus de 3 heures pour rejoindre la Lorraine, maintenant en à peine 1h20 on est dans le centre ville de Metz. Je fais l’aller-retour très souvent. Au final, c’est presque comme certains banlieusards parisiens, porte à porte je mets deux petites heures. C’est bien, car cela me permet de rester ici, je ne me verrais pas vivre à Paris tout le temps. La province aussi a du charme. À Metz, on a quelques belles vitrines, surtout au niveau sportif ! On a une équipe de hand, on a un tournoi de tennis ATP 250. Niveau culture, il y a le musée Pompidou qui est vraiment pas mal. Et sur le plan architectural, la ville en elle-même est très mignonne. On sent l’influence allemande et le mélange historique. J’en profite d’ailleurs pour saluer le travail de Jean-Marie Rausch, qui a veillé tout au long de ses mandats à ce que la ville reste très verte, avec beaucoup de plans d’eau. C’est vraiment beau.
Le PSG à Poissy : un poison pour les ouvriers de l’automobile