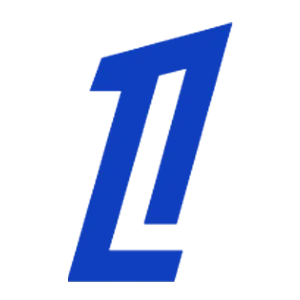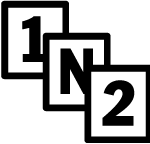- Amérique du Sud
- Copa Libertadores
- San Lorenzo
San Lorenzo et Cristiano, au nom de l’institution

Mercredi soir, le club de San Lorenzo de Almagro a remporté la première Copa Libertadores de son histoire en battant les Paraguayens de Nacional (1-1 ; 1-0). Sur ce chemin interminable qui l'a mené au plus beau jour de sa vie, le club aura perdu son entraîneur vedette et son meilleur joueur, et vendu sa promesse de 19 ans. Il aurait dû avoir « tout » perdu, et a fini par gagner au nom de la supériorité du club, ses couleurs, son écusson et son stade. Mercredi soir, San Lorenzo a réalisé le fantasme des plus grands clubs européens : démontrer que le club est au-dessus de tout.
Ils s’appellent Juan « Pichi » Mercier, Néstor Ortigoza, Mauro Matos, Leandro Romagnoli. Aux yeux de l’Europe, de cette « élite » du football, ces noms ne veulent pas dire grand-chose. De 13 à 15 ans, Ortigoza passait ses weekends à vendre des cahiers dans des stations de train. Sebastian Torrico était kiosquier avant d’arriver en première division. Jusqu’à 2012, à déjà 32 ans, Pichi s’était perdu aux Émirats, pensant en avoir terminé avec le football sérieux. Trentenaires et pas vraiment millionnaires, ces joueurs ne vendent pas de maillots en Thaïlande. Ils ne font pas de tournée annuelle en Indonésie. De cet effectif, rien ne semble briller ou sortir du lot. Même son entraîneur vedette, Juan Antonio Pizzi, le faiseur de miracles du titre de champion 2013, n’est plus là. Car sur le chemin interminable de la Copa, San Lorenzo a dû se séparer de ce qui constitue aujourd’hui en Europe une grande partie de l’actif de nos clubs : ses grands noms.
Aléas économiques et institution
Après le match aller de la finale, le club de Boedo avait dû se résoudre à laisser partir définitivement son étoile, Ignacio Piatti, à l’Impact de Montréal, où il avait signé un gros contrat un mois plus tôt. Ángel Correa, la pépite de 19 ans, avait aussi signé ailleurs, à l’Atlético Madrid, bien avant les dernières phases de la Libertadores. Des aléas économiques auxquels le club s’est habitué. Même Leandro Romagnoli, l’idole, le vieux numéro 10, avait signé au club brésilien Bahia début juillet, sans pouvoir s’empêcher toutefois de continuer l’aventure jusqu’au bout de la finale. San Lorenzo est un champion vendeur. À première vue, le Ciclón semble donc se nourrir d’une eau qui serait jugée non potable pour les grandes marques européennes que sont Manchester United, le Real Madrid ou le Bayern Munich. Des clubs qui vont chercher leurs joueurs tout là-haut, dans les étoiles, quand San Lorenzo va les cueillir par terre. Chez le Cuervo, très loin des Galactiques, c’est l’institution qui fait grandir ses graines, et pas l’inverse. Et c’est ainsi que le club a remporté la plus grande victoire de son histoire. Une manière de crier à la Terre entière que le club est au-dessus de tout. Au niveau du pape, à peu près. Parce que la grandeur réside ailleurs.
De Cristiano Ronaldo à Matias Lammens
Nous sommes le samedi 24 mai 2014, et le Real Madrid est sur le point de gagner à Lisbonne la fameuse Décima. Douze ans d’attente, des dizaines de présentations hollywoodiennes de nouveaux cracks dans un Bernabéu rempli de touristes, et des dizaines de défaites amères, aussi. En football, l’une des conséquences immédiates de la souffrance est la cohésion. Plus l’on souffre autour d’un projet, plus l’on se serre les coudes et plus on idéalise ledit projet. Après que River Plate est descendu en deuxième division, l’engouement autour du club était plus vivace que jamais. Ainsi, la théorie nous faisait attendre une Décima intense et savoureuse, sorte d’hommage universel au club blanco, un nouvel épisode de la volée de Zidane. Mais à la 120e minute, après deux heures étonnantes et sans génie, CR7 obtenait sans gêne un pénalty, le transformait avec brio, et partait fêter son but inutile de manière futile. L’ultime maladresse d’un joueur parfait et irréprochable, mais victime malgré lui d’un système ayant porté son individualité au-dessus de toutes les institutions, y compris de son club, à qui cette 120e minute aurait dû appartenir. Dans un autre registre, Ángel Di María (l’homme du match) se plaignait – certainement avec raison – de son manque de reconnaissance au sein de la Maison Blanche. Comme si la victoire du club ne suffisait pas.
Trois mois séparent ces images de celles de la victoire de San Lorenzo mercredi soir au Gasometro. Au coup de sifflet final, Mauro Matos – attaquant bagarreur de 32 ans qui semble en avoir quinze de plus – vient gentiment dédier la victoire à ses hinchas. Le président Matias Lammens, grand artisan de la légende, descend alors sur la pelouse pour s’excuser auprès des supporters n’ayant pas pu entrer dans le stade. Avant le match, il avait tenu à rappeler que « nous avons tous de la famille, des amis, des voisins qui ne sont plus là et qui avaient rêvé de vivre ce moment » . Les joueurs partent ensuite grimper sur les grillages du virage pour célébrer une victoire qu’ils semblent offrir plutôt qu’obtenir. La cérémonie officielle et les médailles attendront. Et la passion se faufile à tous les échelons du club. Le lendemain, le vice-président Marcelo Tinelli déclare qu’il veut se faire tatouer la coupe, l’écusson et la date de la victoire sur la jambe. Et le président Lammens déclare en rigolant : « J’ai eu beaucoup de mal à dormir parce que j’ai eu la chance de ramener la coupe à la maison. Tu sais combien elle pèse ? J’ai dormi avec elle, et j’ai envoyé ma femme dormir dans l’autre chambre. De toute façon, la fête a fini à sept heures du mat… » S’il est tout bonnement insensé de généraliser l’attitude malheureuse de Cristiano à l’ensemble du football européen, et si ce n’est qu’une image, l’image reste forte : les uns cherchent à se faire voir, les autres font tout pour rappeler l’importance de ceux que l’on ne voit pas.
Crise financière et croissance identitaire, pour l’amour du but
Le paradoxe de cette supériorité de l’institution réside dans le fait que les clubs argentins dépendent aujourd’hui plus que jamais de la vente de leurs talents. Toujours plus jeunes, toujours plus vite. Le pauvre mercato du River Plate de Gallardo est cruellement riche d’enseignements. Pour 10 millions de dollars, le talent Manuel Lanzini a été envoyé à l’Al Jazira Club. Après la Coupe du monde, les Millonarios ont dû attendre le dernier moment pour savoir si l’attaquant vedette Teo Gutiérrez allait revenir au bercail. Et la vente du défenseur colombien Eder Balanta semble vital pour que le club respecte son budget l’an prochain. Une dizaine de départs, deux maigres arrivées. Le tout en priant pour voir revenir un Pablo Aimar de 34 ans. Un numéro d’équilibriste permanent. Après ces années de crise, d’inflation et d’éloignement du dollar, le prestige des grandes institutions du football argentin en a pris un coup. River et Independiente ont connu des drames. Boca s’est accroché à la figure de Riquelme. Et le Racing a souffert avec continuité, sans vraiment chercher le besoin de changer ses habitudes. Mais si le prestige des clubs souffre, surtout à l’international, leur identité, le sentiment d’appartenance qu’ils dégagent, et leur cohésion continuent à grandir. Une sorte de maturité : comment appeler autrement cet état où la notoriété d’un club ne dépend plus du spectacle proposé ou de la renommée de ses joueurs ?
C’est cette haute « idée du club » qui avait poussé David Trezeguet, El Chori Domínguez et Fernando Cavenaghi à revenir. Comme Diego Milito au Racing, Gabriel Milito à Independiente, Juan Sebastián Verón à Estudiantes. Et d’ailleurs, l’idée de San Lorenzo avait fait son chemin bien avant le triomphe. Le pape François, Viggo Mortensen et Hernán Crespo s’étaient chargés de répandre leur foi du Ciclón avant cette ultime série de succès. Durant la soirée, les ex-Pablo Zabaleta, Ezequiel Lavezzi ou encore Gonzalo Bergessio se sont aussi empressés de féliciter le club, fiers d’avoir fait partie de l’aventure. Un football où les stars sont admiratives des institutions, et non l’inverse. Cette semaine, l’acteur Lito Cruz, célèbre supporter du Racing, rappelait l’essence du football en évoquant le retour de Diego Milito dans un entretien au quotidien Olé : « C’est impossible à rationnaliser, un but au stade est l’émotion et l’impression la plus belle et grande qu’un être humain puisse vivre. Ce moment précis où un pied apparaît et touche le ballon, et que la possibilité que le gardien capte le ballon s’évanouit, voilà ce que je cherche à vivre quand je vais au stade. (…) Tout ce que je sais, c’est que le dimanche, le samedi ou le vendredi, je veux que le Racing marque et gagne. Qu’est-ce qu’on en a à faire si Milito joue ou ne joue pas ? L’essentiel, c’est de gagner : ce sont les buts qu’on aime ! »
Top 100 : Footballeurs fictifs (de 70 à 61)par Markus Kaufman
Le site Faute Tactique
Le blog Faute Tactique sur SoFoot.com