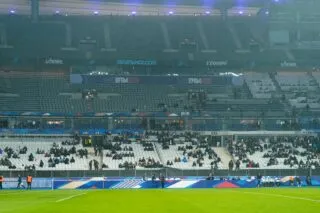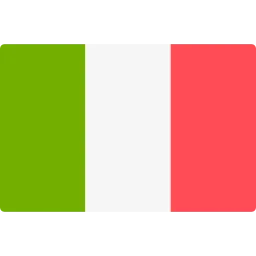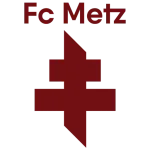- Angleterre
- Premier League
- 6e journée
- Liverpool/Everton
Rodgers sait fédérer

Malgré un début de saison tendu, Liverpool a plus que jamais foi en son manager pour ramener les Reds au sommet.
Il faut parfois savoir aller du côté de « l’ennemi » pour comprendre un peu mieux les choses. Car à l’évidence, les gens qui comptent ont toujours au moins un ennemi. Mourinho les collectionne comme autant de cadavres dans son placard, par exemple. Même Pep « Mister Nice Guy » Guardiola entend ses oreilles salement siffler quand Zlatan Ibrahimović vide son sac sur son passage à Barcelone. Alors quand on a vu passer un entretien dans The Independent de Daniel Agger, intitulé « J’ai quitté Liverpool à cause de Rodgers » , on s’est dit : « Yes, enfin un truc vachard sur celui dont tout le monde ne dit que du bien. » Pourtant, même si le nouveau défenseur de Brøndby ne cache pas avoir balancé des saloperies au manager de Liverpool, il le concède : le Brendan est un tout bon. « C’est un technicien incroyablement compétent. Il est extrêmement talentueux dans sa façon d’entraîner et dans sa manière de gérer le projet global de l’équipe. Ça, personne ne peut le nier. » Même son de cloche à Swansea, son ancien club, où tout le monde s’accorde à dire que si le club gallois est aujourd’hui une valeur attrayante de Premier League, il le doit principalement au coach irlandais. Putain, si même les ex rivalisent d’amabilités… Mais peut-être est-ce nous, pervers de journalistes, qui cherchons forcément le caillou dans la godasse d’un type qui, manifestement, a les pompes plutôt propres. Faut dire qu’on s’était méfié à la vue de l’étonnante série documentaire Au cœur de Liverpool où l’on voyait la préparation de la saison 2012-2013 pour les premiers pas de Rodgers à la tête des Reds avec une façon de faire assez fascinante dans sa relation à l’individu et au groupe, le genre de gars que l’on suivrait jusqu’en enfer. Le storytelling un peu trop parfait pour ne pas être suspect. Et pourtant, Rodgers est peut-être tout simplement un mec bien.
Un doigt d’honneur aux coachs anglais
Oh, bien sûr, en grattant du côté de sa vie privée, on pourrait bien chiner une séparation pas très jojo avec son épouse depuis treize ans, pour s’acoquiner avec une employée du club de la Mersey qui, elle-même, était mariée à son arrivée, mais là on chipote carrément. Non, si Brendan Rodgers fascine autant, c’est bien en raison de la façon dont il a relancé Liverpool dès son arrivée. Et on dit bien : dès son arrivée. Certaines voix pourraient nous rétorquer que sa première saison était finalement très moyenne avec une modeste septième place au classement. Ok, ok, l’argument est recevable. Mais le bilan facture quand même neuf points de mieux par rapport à la saison précédente ; le constat doit être affiné par la seconde partie de saison où Liverpool a affiché seulement une victoire de moins que le futur champion Manchester United ; et enfin, dans le contenu, même les contre-performances des premiers mois laissaient apparaître un style, un élan, et c’est sans doute là le point clé de toute l’histoire. Car Rodgers confirme cette idée tenace que les meilleurs techniciens britanniques sont tout sauf anglais. C’est simple, les coachs venus d’Albion rivalisent presque tous de simplisme avec une philosophie qui tiendrait souvent sur un emballage de chewing-gum : le jeu vertical de Sam Allardyce (mais alors vertical : en l’air quoi, et advienne que pourra), les vannes de l’impayable Harry Redknapp ou encore les semaines raccourcies d’Alan Pardew (l’an passé, pas d’entraînement le lundi et le mardi à Newcastle pour lui, pourquoi se faire chier, hein). Non, Rodgers, c’est vraiment autre chose. Mais rien de révolutionnaire non plus, car qu’a-t-il fait sinon remettre au goût du jour une vieille tradition de la maison rouge : pass and move. Et ce, en misant sur des profils vifs, techniques, en expédiant le jeu d’un autre âge d’Andy Carroll définitivement à West Ham, et surtout en ne reniant pas une virgule de sa vision. Comme lors du naufrage inaugural face à West Brom (0-3) en 2012 où, après le match, il dit aux joueurs qu’avec ce genre de domination, ils ne perdront pas longtemps. Une manière d’idéalisme au charme un peu suranné. Et un poil dangereux même…
Le même défi que Fergie
Car c’est probablement ce côté joueur qui est apparu comme une limite l’an passé. Comme après la défaite cruelle face à Chelsea (0-2) où, d’une grande naïveté, il avait reproché à José Mourinho d’avoir établi un bus londonien (donc mastoc) devant les cages de Čech, un reproche un peu bidon quand on sait que Rodgers avait été adjoint du « Mou » chez les Blues au temps du « Boring Chelsea » . Et surtout comme lors du nul suivant chez Crystal Palace (3-3) où son équipe s’était fait remonter trois pions dans les dix dernières minutes sans qu’il ne puisse stopper le dévissage de ses boys. En quelques jours, un pas de deux définitivement létal… Mais au vrai, ce qui a sans doute coûté le titre tant attendu à Liverpool paiera peut-être à plus long terme. Parce que Rodgers est dans le vrai, parce qu’il y a un sens profond à sa construction fondée sur de vrais principes de jeu. Au hasard, une récupération plus haute qu’avant, un jeu de transition ultra rapide, une vraie circulation de balle intelligente, des côtés percutants (latéraux compris, notamment le jeune Moreno dont on va entendre parler), une prise de risque fréquente en attaque, le tout avec une ossature très anglaise (pour une top team de Premier League, s’entend). Reste LE problème de la saison : faire aussi bien, sinon mieux, sans Luis Suárez. Parce qu’on ne va pas se mentir, l’Uruguayen pesait d’un poids fondamental dans la force de perforation des Reds, mais aussi dans le volume d’animation par ses courses incessantes (et on ne parle même pas du pressing de dingue du lascar). Rodgers doit prouver que les victoires acquises sans Suárez au début de la saison passée quand El Pistolero était suspendu n’étaient pas de la poudre aux yeux. Mais bon, soyons clairs, l’affaire ne s’annonce pas simple et les premières semaines compliquées sans le Cannibale ne disent pas le contraire. Alors, l’ami Brendan veut croire que Mario Balotelli, dans un style différent, peut remplacer l’irremplaçable. Oui, oui, l’inénarrable Super Mario comme sauveur des Reds. Absurde ? Peut-être, mais pas tellement plus, si on a un peu de mémoire, que ce qu’avait réussi Alex Ferguson avec Éric Cantona, autre joueur d’éclat ultra inconstant et davantage connu pour ses écarts avant de débarquer en Angleterre à 25 ans. L’âge qu’aura Balotelli l’an prochain… Oui, il est l’heure de renouer avec un autre savoir-faire maison quand aucun crack, aussi exceptionnel fut-il, n’était irremplaçable. Keegan, double Ballon d’or à venir, parti à Hambourg en 1977 ? Aussitôt remplacé par Kenny Dalglish. Ian Rush, Soulier d’or européen, envolé vers la Juve en 1987 ? Pas de souci, Liverpool déniche John Aldridge dans la foulée. Un autre temps, peut-être. Un temps qui n’avait pas fini de faire de nous des vieux cons de quarante ans et plus. Un temps où Liverpool était roi. Un temps que Rodgers a promis de ressusciter. Un quart de siècle que Liverpool attend ça, presqu’une éternité. Et l’éternité, pas vrai Woody, c’est long… surtout vers la fin.
Par Dave Appadoo