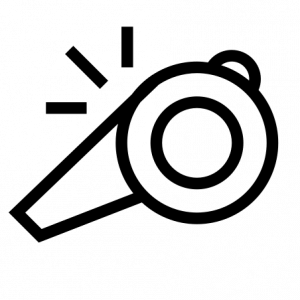- Supporters
- En partenariat avec Audible
Rivalité Juventus-Torino: le stade, l’usine et la lutte des classes

Rivaux sur le terrain, parfois alliés dans la lutte syndicale qui les opposait au patronat incarné par la famille Agnelli, les tifosi de la Juve et du Toro ont longtemps entretenu une dynamique à part. Une spécificité en partie façonnée et influencée par les mouvements sociaux et ouvriers qui ont animé l'Italie du milieu des années 1940 au début des années 1980.
Il se dit souvent qu’au début, cette rivalité-là était d’une édifiante simplicité. C’est du moins ce que semble indiquer cet extrait de Le Due Città, un roman publié en 1964 par l’écrivain transalpin Mario Soldati. Dans cet ouvrage, l’homme de lettres décrivait ainsi un échange courtois entre un tifoso de la Juventus et un fan du Torino : « Les deux hommes traversèrent Piazza Vittorio et parlaient déjà de football. Emilio, naturellement, était pour la Juve, l’équipe des gentlemen, des pionniers de l’industrie, de ceux qui avaient fait des études : bref, des bourgeois riches. Giraudo, tout aussi naturellement, était pour le Toro, l’équipe des ouvriers, de ceux qui avaient fait le lycée technique : bref, des petits bourgeois et des pauvres. » Presque soixante ans plus tard, la dualité de classes qui opposait jadis les grands bourgeois juventini aux prolos torinesi relève pourtant plus du folklore qu’autre chose. Entre-temps, le miracle industriel italien est passé par là. Dans son sillage, on distingue le boom de la FIAT, ses usines qui font venir des milliers d’immigrés du Mezzogiorno (les régions du Sud de l’Italie) pour y travailler, et bientôt, aussi, des grèves, où les ouvriers à la chaîne s’opposent à la puissance dérégulée du patronat. Des mouvements sociaux où tifosi du Toro et de la Juve se retrouvent parfois dans le même camp face à un adversaire commun, mi-bienfaiteur, mi-ange de malheur : la famille Agnelli.
Contre les Agnelli, avec la Juve
Une illustration du phénomène ? Prenez le 24 novembre 1955, triste jour de licenciement de cinq cent cinquante ouvriers des usines FIAT de Turin. Les motifs donnés par la direction pour se délester de ses employés font alors allusion à « un excédent de main-d’œuvre » et à une « notable diminution du travail ». En réalité, la firme en profite pour se séparer de plusieurs agitateurs et leaders syndicaux. Le constructeur automobile, inquiet de la structuration de la lutte ouvrière dans ses usines, mène depuis plusieurs années la vie dure à ses employés les plus activistes et politisés. « À partir de 1953, le groupe dirigeant de la FIAT établit un plan d’attaque contre le mouvement ouvrier, décrypte l’ouvrage universitaire La Horde d’or, qui relate l’histoire des mouvements d’extrême gauche en Italie. Cette attaque tente d’entamer l’unité de la classe ouvrière en établissant une distinction entre ouvriers « constructeurs » et « destructeurs » , par une forte remise en cause du droit de grève, le chantage exercé sur la garantie du poste de travail et par diverses autres mesures – entre paternalisme et intimidation… Les communistes sont aussi chassés des commissions internes (des organes de médiation patronat/syndicat sur les conditions de travail) et l’on promeut le syndicalisme d’entreprise dit « jaune » (qui refuse certains modes d’action comme la grève et l’affrontement avec le patronat, N.D.L.R.).
Parmi les salariés licenciés, on retrouve un certain Emilio Pugno, un célèbre syndicaliste, qui sera élu à la Chambre des députés dans les rangs du parti communiste italien en 1976. Bizarrement, celui qui aura défié de longues années la FIAT, les Agnelli et plus globalement l’élite patronale, n’aura également jamais cessé de supporter un club : la Juventus. Il se dit même que lorsque certains de ses collègues ouvriers lui reprochaient amicalement de ne pas soutenir le Toro, le bonhomme répondait malicieusement : « Toute la semaine, je me dispute déjà avec le patron, vous ne voulez pas que j’encourage les entreprises adverses le dimanche non plus. »
Une entreprise, deux équipes
Signe, déjà, que la Juventus n’est plus tout à fait exclusivement le club des notables piémontais. Le miracle économique italien va d’ailleurs achever de brouiller les frontières de classes entre tifosi de la Juve et du Toro. À partir du début des années 1950, des milliers de travailleurs quittent le sud de la Botte pour aller trimer dans les usines du nord, notamment dans les grandes fabriques automobiles des Agnelli à Turin. Entre 1951 et 1967, la population de Turin passe ainsi de 719 300 à 1 124 714 habitants. Autant de néo-Piémontais qui choisissent en majorité de supporter la Juve, plutôt que le Toro. Déjà forte de nombreux Scudetti, la Vieille Dame, dont les joueurs ont constitué la base du succès transalpin lors du Mondial 1934, s’est fabriquée une aura qui transcende largement sa région d’origine. Le Toro, lui, reste majoritairement le club des Turinois de souche, issus de la classe moyenne et ouvrière.
Colonne vertébrale de l’économie de la ville, les usines turinoises de la FIAT ne rassemblent ainsi pas qu’un alliage uniforme de tifosi de la Juve et comptent évidemment un nombre non négligeable de fans grenat. « Un des aiguillons de la passione granata est la réaction contre l’hégémonie de la Fiat, pointe l’ethnologue Christian Bromberger, auteur du Rouge et le Noir, une étude sociologique portant sur les supporters de la Juve et du Toro. Certains cadres de la firme, soucieux d’afficher leur indépendance d’esprit, soutiennent volontiers le Toro, tout comme le personnel des innombrables entreprises sous-traitantes de l’empire industriel. » Illustration avec Sergio Rossi. Celui qui deviendra président du Torino de 1982 à 1987 était un Granata pur jus. Originaire des faubourgs ouvriers de Turin, le bonhomme était aussi un businessman accompli dont l’entreprise, Comau, avait largement participé à robotiser la production de la FIAT, avant d’être finalement rachetée par cette dernière.
La grève des 35 jours et la marche de 40 000
L’année 1980 symbolise parfaitement ce curieux mélange turinois, où s’entrechoquent football, industrie automobile et luttes syndicales. La FIAT, plombée par une stratégie industrielle inefficace à laquelle vient s’ajouter la concurrence des modèles japonais qui envahissent le marché italien, annonce alors des milliers de licenciements au sein du groupe. Le 11 septembre, une grève massive des ouvriers vient paralyser les usines turinoises du groupe automobile. Le blocage, d’une ampleur inédite, dure 35 jours et le stade lui-même se transforme en tribune de revendication. Le 5 octobre, lors d’un Juventus-Bologne en Serie A, les supporters de la Vieille Dame brandissent plusieurs banderoles dans les travées du stade olympique de Turin, où l’on peut notamment lire « Non aux licenciements de la Fiat » et « Solidarité de toute la ville, Agnelli ne passera pas ».
Entre-temps, le 26 septembre, Enrico Berlinguer, le secrétaire général du parti communiste italien, avait débarqué à Mirafiori, l’usine historique de la FIAT à Turin, pour signifier la solidarité du PCI aux grévistes et soutenir leur action. Lui aussi s’érigeait alors contre la direction de son club de cœur : ce Sarde de naissance était en secret un acharné de la Juventus. La lutte syndicale sera pourtant brisée le 14 octobre par la « Marche des 40 000 » . Cette manifestation voit des milliers d’employés et cadres de FIAT défiler dans les rues de la capitale piémontaise pour protester contre le piquetage qui les avait empêchés d’entrer dans les usines pendant plus d’un mois. Ces derniers brandissent des pancartes où l’on peut notamment lire « Le travail se défend en travaillant » ou encore « Nous voulons des négociations, pas la mort de Fiat ». Divisé, le mouvement ouvrier s’essouffle, et le travail ne tarde pas à reprendre. Rétrospectivement, cette marche est vue par certains historiens comme le début de la fracture de l’unité entre les salariés de la classe moyenne, plus enclins à trouver un consensus avec le patronat, et ceux de la chaîne de montage.

Le Torino FIAT
À l’occasion, il faut souligner que la FIAT aura aussi pu prendre des initiatives autrement plus rassembleuses, y compris à l’égard des tifosi du Torino. Le 25 novembre 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, le Toro, champion d’Italie en titre, adopte même le nom de Torino FIAT. Un blase qu’il gardera environ deux ans, avant de reprendre sa dénomination classique après la guerre. Les Grenats avaient alors conclu un accord avec la FIAT, qui s’engageait à embaucher dans ses usines les joueurs granata, pour leur éviter la conscription obligatoire. Les salariés considérés comme indispensables au processus de production pouvaient en effet se soustraire à l’appel des armes. Ironiquement, sans la FIAT, la plus grande équipe de l’histoire du Toro, qui remportera six Scudetti entre 1942 et 1949, n’aurait peut-être pas vu le jour, puisque certains de ses cadres auraient pu hypothétiquement être blessés ou tués à la guerre. L’histoire est savoureuse. Et illustre qu’entre luttes communes et antagonismes sportifs, la rivalité Juve-Toro a longtemps épousé des contours ambivalents, à l’usine comme au stade.
Grâce à Rabiot et Pulisic, Milan renverse le TorinoPar Adrien Candau