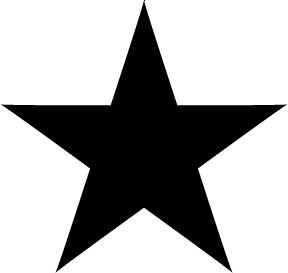- Angleterre
- Manchester United
Ralf Rangnick : « J’ai réussi à créer des équipes qui ont leur propre modèle »

Pionnier du gegenpressing, maître à penser de toute une génération de coachs allemands et architecte du projet Red Bull, Ralf Rangnick devrait être nommé à 63 ans entraîneur par intérim de Manchester United dans les prochaines heures. En mars 2020, dans le cadre d'un grand dossier sur l'histoire du contre-pressing, il était revenu en longueur sur sa méthode pour le magazine So Foot. En avant !
Vous êtes un membre important de ce qu’on appelle aujourd’hui « le clan des Souabes » , ces entraîneurs issus du Bade-Wurtemberg, qui ont révolutionné l’approche du jeu en Allemagne. Comment expliquer une telle concentration de grands entraîneurs dans la région de Stuttgart ? Est-ce une question de caractère ? (Rires.) Je ne sais pas… Stuttgart est l’endroit qui a vu naître des constructeurs automobiles comme Mercedes et Porsche, donc on a forcément un certain rapport à la vitesse. Je pense aussi que les citoyens du Bade-Wurtemberg sont des inventifs, des personnes qui ne reculent devant aucun obstacle. Jürgen Klinsmann a notamment ce caractère, et je pense que sur ce point, je suis un peu pareil que lui… Puis on a surtout eu la chance d’avoir Helmut Gross. La première fois que je l’ai rencontré, je devais avoir 25 ou 26 ans. Je vivais ma première expérience de coach, chez moi, à Backnang. À cette époque, Helmut entraînait aussi. On se rencontrait parfois à Stuttgart, puisque l’on faisait partis d’un groupe d’entraîneurs qui se réunissaient deux fois par an pour préparer des leçons pour les coachs de la région. On a rapidement accrochés, on parlait pendant des heures de football, notamment de l’utilité du marquage en zone.
C’est quelque chose qui semblait évident pour vous, avant de le rencontrer ? En Allemagne, 90-95% des équipes jouaient en 3-5-2, avec un libero, des latéraux dont le rôle était de courir d’un drapeau de corner à l’autre, deux milieux axiaux plus ou moins chargés d’un marquage individuel, un 10 et deux attaquants. Le football des années 1980 et du début des années 1990, c’était ça. (La RFA a soulevé la Coupe du monde 1990 dans ce système, NDLR.) J’ai évidemment moi aussi testé le 3-5-2 avec mes équipes, mais après plusieurs discussions avec Helmut, j’ai compris que ça devenait de plus en plus inefficace et qu’il fallait que je passe à quatre derrière. On a parlé pendant des nuits entières de ce concept. On regardait des vidéos du Milan de Sacchi, du Kiev de Lobanovski… Et au fil du temps, après quelques années passées avec Helmut à Stuttgart, j’ai testé ce football avec mon Ulm, qui est passé de la troisième division à la Bundesliga entre 1997 et 1999 : on était probablement la seule équipe du pays qui pratiquait un football en zone avec un pressing orienté vers le ballon. Ce n’était pas quelque chose de commun, mais ça fonctionnait. Et je me suis dit que si ça fonctionnait avec une équipe de deuxième division, ça pourrait forcément marcher avec une équipe de première division.
Pourquoi ? Parce que tactiquement, cette approche te permet de gagner la majorité de tes matchs. Tu réussis à créer une unité entre tes joueurs, et puis en plus, ça plaît aux supporters. Pour moi, le marquage en zone est plus jouissif et stimulant pour les joueurs qu’un marquage individuel strict.
Le mettre en place n’a pas été simple. Vous vous êtes d’ailleurs confronté au scepticisme de certains grands noms du coaching allemand de l’époque qui ont notamment critiqué l’un de vos passages télé. L’avez-vous regretté ? Je n’ai aucun regret, non, car on était simplement en avance sur notre temps. Quand je suis arrivé à l’émission, je ne savais pas ce que le présentateur allait me demander. Puis, d’un coup, il a sorti un tableau avec des aimants, et m’a demandé d’expliquer comment mon équipe jouait. En Allemagne, c’était inhabituel, à l’époque, de se mettre ainsi à nu, de parler aussi ouvertement de tactique et de questions stratégiques. En plus, j’étais un jeune entraîneur, relativement inconnu, on me donnait la parole sur le plateau de l’émission de foot la plus regardée du pays… Encore une fois, on parle de l’Allemagne, un pays qui n’a jamais été vanté pour ses grands tacticiens et où on discutait davantage de rigueur, d’organisation rigide, de discipline… On n’a jamais entendu quelqu’un dire que l’Allemagne avait créé une certaine façon de jouer au football. Finalement, c’est arrivé ces dernières années, et c’est comme si, en 1998, j’avais été un missionnaire. J’étais convaincu que notre approche était la bonne, alors pourquoi ne pas l’expliquer en deux ou trois minutes à la télévision ? Helmut m’a dit après l’émission que désormais, toutes les équipes allaient savoir comment j’allais jouer, mais ça ne me dérangeait pas. Avec du recul, et même si certaines personnes ne l’ont pas compris à l’époque, c’était une bonne chose, puisque désormais, tout le monde parle des entraîneurs allemands, de Jürgen Klopp, de Thomas Tuchel, de Roger Schmidt, de Julian Nagelsmann…
Vous avez été un pionnier de la défense à quatre en Allemagne. Pourquoi ce choix ? C’est un choix essentiellement basé sur la recherche d’une couverture de l’espace orientée vers le ballon, un principe qui offre aux joueurs la possibilité de se déplacer sur le terrain en fonction de la balle et de leurs coéquipiers, et donc d’être tout le temps en surnombre près du ballon. Ensuite, les latéraux offensifs, ainsi qu’un joueur supplémentaire inséré au milieu de terrain te donnent plus de puissance et de contrôle. La répartition naturelle au sein d’une équipe se traduit alors par de courtes distances entre les différentes lignes et les différents joueurs qui peuvent se soutenir mutuellement en permanence. Tout à l’heure, on parlait de Lobanosvki et du Dynamo Kiev, qu’on a affronté en amical avec Backnang en 1984. Après dix minutes de match, je me suis mis à compter les joueurs de mon équipe et ceux de l’équipe adverse. Je voulais être sûr qu’il ne me manquait personne. Quand j’ai constaté qu’on était bien à onze contre onze, j’ai compris qu’il y avait quelque chose de différent dans l’approche du Dynamo. Après le match, Lobanosvki m’a expliqué que c’était simplement une question de stratégie. Il demandait à ses joueurs de presser l’intégralité du terrain en permanence. J’ai ensuite assisté à certains de leurs entraînements, je voulais comprendre, et j’ai compris : tout leur travail était tourné sur la façon de réagir lorsque l’adversaire avait la possession. Lobanosvki a inversé les choses, il ne voulait pas subir, et c’est ainsi que le contre-pressing est arrivé dans ma vie. En 1988, il est revenu en Allemagne pour disputer l’Euro avec l’équipe d’URSS et a notamment démontré toutes ses idées lors de la demi-finale contre l’Italie, un modèle pour tous les entraîneurs qui veulent jouer comme on le fait. Puis, Arrigo Sachi a également repris cette idée dans un pays, l’Italie justement, qui ne jurait que par le marquage individuel strict. Lui, il est arrivé, a imposé un bloc médian haut, de la densité côté ballon, des lignes resserrées et a cherché à réduire le temps et l’espace pour son adversaire. J’ai utilisé certaines séquences de son Milan avec mes joueurs, à Ulm, en 1997. Mais oui, tout ça n’est possible que grâce à un sens exacerbé du collectif.
On sent une certaine revendication identitaire dans la manière de jouer de vos équipes. Est-ce que c’est voulu ?Partout où je suis passé, j’ai compris qu’il fallait faire naître une identité, oui. Quand tu es entraîneur, tu dois dire deux choses à tes joueurs : voilà comment on veut jouer et voilà ce que l’on veut être. Une fois que tu as ça, que tu maîtrises parfaitement ton style de jeu, rien n’est laissé au hasard. Tu sais exactement quel type de joueur doit évoluer à tel poste, dans tel rôle. J’ai un catalogue extrêmement clair sur ce que j’attends d’un latéral droit, d’un arrière central, d’un six, d’un huit, d’un buteur… Et quand je suis arrivé à Hoffenheim, en 2006, c’est aussi ce qui a fait la différence.
Vous êtes surtout arrivé dans un club qui vous a donné les moyens de mettre en place toutes les expériences que vous aviez imaginées depuis des années… Depuis ma rencontre avec Helmut en 1985, nous n’avions qu’une question en tête : comment entraîner notre équipe pour atteindre un style de jeu précis ? Pour y répondre, on devait trouver des exercices efficaces, et en arrivant là-bas, oui, de nouvelles possibilités se sont ouvertes à moi. J’ai notamment récupéré certains outils qui m’ont permis d’affiner notre méthode et de chiffrer deux règles, grâce à un important rapport de données sur l’ensemble des championnats internationaux : huit secondes pour récupérer le ballon après la perte, dix secondes pour marquer derrière. C’est l’idéal. Ensuite, il a fallu le faire entrer dans l’esprit des joueurs.
![]()
Comment ? En tant qu’entraîneur, tu dois convaincre tes joueurs par le jeu, les faits et ta force de conviction. Surtout, tu dois leur faire vivre les choses. Si tu n’expérimentes pas quelque chose, tu ne peux pas le comprendre complètement. Le tableau, finalement, ce n’est que de la théorie. Pour moi, une équipe de football, c’est comme un orchestre : si tu as un concert le samedi soir, tu dois avoir joué avec le même rythme et la même intensité que sur scène pendant la semaine… Pour ça, on a mis en place des exercices basés sur la provocation, afin de faire travailler la vision verticale des joueurs, mais aussi leur instinct. À Hoffenheim, par exemple, on s’entraînait énormément autour d’oppositions réalisées sur des espaces réduits avec une règle simple : une ou deux touches de balle, et si une équipe n’a pas marqué en huit secondes, le ballon est rendu à l’équipe adverse. Ainsi, les joueurs étaient en situation de pression, une pression plus importante que celle qu’ils allaient rencontrer le week-end. Résultat, au fil des séances d’entraînement, leur temps de réaction est devenu optimal. Grâce à cette approche, on a aussi fait mûrir les gars sur l’intelligence situationnelle et spatiale. Il y avait aussi le compte à rebours géant, évidemment, qui servait de minuteur. Toujours pareil : huit secondes pour récupérer le ballon, dix secondes pour marquer derrière, et une fois que ça tombait à zéro, buzzer et ballon rendu à l’adversaire. De cette manière, on entraîne le cerveau… Je suis persuadé que pendant les matchs, les joueurs entendaient ce tic-tac.
Cette préparation demande des joueurs pleinement convaincus émotionnellement par le projet. C’est encore possible dans une époque de plus en plus individualiste ? C’est aussi pour ça que depuis Hoffenheim, je ne travaille qu’avec des jeunes joueurs. Au départ, c’était surtout une question de circonstances, car Hoffenheim est un petit village et il n’était pas simple de convaincre des footballeurs de 26, 27 ou 28 ans de venir jouer là-bas. On a donc préféré parier sur des joueurs comme Luiz Gustavo, Carlos Eduardo, Ibišević, Demba Ba, Obasi… Quand ils sont arrivés chez nous, ils avaient tous entre 19 et 23 ans. On a rapidement compris que ça avait plus de sens d’investir sur de jeunes talents : ils ont cette envie de progresser chaque jour, chaque semaine, ils sont davantage capables de récupérer après les efforts et peuvent donc davantage enchaîner, et puis ils discutent moins les choix stylistiques… Ils nous font confiance, si on leur dit qu’il faut presser de telle manière, ils comprennent que c’est dans l’intérêt de l’équipe.
Oui, mais inévitablement, chacun d’entre eux conserve cette ambition de réussite individuelle, non ? Je pense qu’un joueur est susceptible de comprendre sa valeur marchande par le succès, et c’est vrai que si tu ne réussis pas, il ne va pas te suivre sur le long terme. Même si le football est une affaire de réussite collective, chacun a l’ambition d’être un bon joueur. Or, à travers les victoires, ils comprennent très vite à quel point chacun profite du succès. Quand il y a des négociations, je fais bien attention de tout bien expliquer au joueur que j’ai en face de moi. Aujourd’hui, nous avons affaire à une génération de joueurs différente de celle d’il y a dix ou vingt ans. Ils veulent désormais comprendre pourquoi ils doivent faire ceci ou cela. Ils réfléchissent et posent des questions. C’est pourquoi le plan doit être concret, sans aucune faille. Je suis convaincu que la qualité de l’exécution d’une action augmente si celui qui l’opère en comprend la raison. Exemple : imaginez que je vous demande de vous rendre en forêt pour y creuser un trou. Je vous donne juste une pelle. C’est tout. Pas d’autre information. Qu’allez-vous faire ? Vous allez y aller, creuser un trou, et comme je ne vous ai indiqué ni sa largeur ni sa profondeur, il sera probablement petit et peu profond. Et peut-être que ce trou sera creusé à l’orée de la forêt, parce que vous aurez été trop flemmard pour aller vous enfoncer dans les bois. En revanche, si je vous dis que vous devez creuser ce trou pour que vous et moi puissions nous cacher dedans et ainsi être à l’abri des animaux sauvages et des voleurs une fois la nuit tombée, l’exécution de votre tâche sera probablement différente.
Vous faites partie des rares entraîneurs à n’être jamais passé, pour l’instant, en dessous des 40% de victoires lors de vos différentes expériences. À quoi attribuez-vous cette statistique ? Là, il est question de toutes ces choses dont nous avons parlé, et bien plus encore. J’essaie toujours d’avoir à mes cotés des gens qui sont aussi fous de football que moi et qui aiment ce sport autant que moi. Tous ensemble, nous travaillons à perfectionner les plus petites pièces du puzzle. La somme de ces améliorations marginales augmente la probabilité de succès. Bien évidemment, j’ai acquis beaucoup d’expérience au fil des années, mais je pense que les meilleures décisions que j’ai pu prendre concernent le recrutement et la formation des joueurs et du personnel. Finalement, tu en as besoin pour réussir.
Justement, la majorité des entraîneurs actuels de Bundesliga ont travaillé un temps avec vous. Du coup, on a parfois le sentiment d’assister à des rencontres qui se décident uniquement sur la réussite du contre-pressing. Ce n’est pas un problème ? C’est vrai que la base est souvent la même aujourd’hui, mais même si deux ou trois entraîneurs ont une approche similaire, il y a un autre facteur qui entre en jeu : la personnalité de celui qui est assis sur le banc de touche. Certains sont plus prudents, d’autres plus courageux, certains sont plus ou moins analytiques. Deux entraîneurs ne sont jamais identiques, chacun prépare son équipe à sa façon, avec un discours différent… C’est ce qui me différencie de Jürgen Klopp, par exemple, qui est plus passionné que moi dans sa façon de parler aux joueurs. Il leur demande des choses différentes… Il y en a d’autres qui sont plus tranquilles, plus analytiques. Jürgen l’est aussi, mais c’est un émotionnel. Quoi qu’il en soit, la tactique est devenue primordiale aujourd’hui, on est loin du discours de Felix Magath qui expliquait il y a quelques années que la tactique était réservée aux mauvais joueurs, ce qui est un non-sens. Si la tactique n’est pas importante dans un sport collectif, quand le sera-t-elle ? Je suis même convaincu que plus vous avez de joueurs à disposer sur un terrain, plus elle devient essentielle. En tant qu’entraîneur, mon boulot est d’aider mes joueurs à interagir entre eux sur le terrain, avec et sans ballon, et ça, c’est quoi ? De la tactique. Quand Sacchi parle de synchronisation, c’est ça : tes footballeurs doivent avoir la même compréhension tactique et partager le même idéal.
Vous êtes malgré tout d’accord sur le fait que le contre-pressing est devenu une arme vitale au plus haut niveau ?Aujourd’hui, d’un point de vue statistique, plus de 60% des buts arrivent après une phase de transition. Seuls 10% d’entre eux surviennent après un temps de possession du ballon supérieur à 20 secondes. Ce sont des données qui se vérifient dans le monde entier, avec quelques valeurs aberrantes ici et là. Si vous prenez ces chiffres en compte avec ceux du nombre d’occasions dont on a besoin pour marquer un but, vous vous rendez compte à quel point la phase de récupération du ballon est importante. C’est pour cela qu’elle est devenue notre thématique principale, aussi bien en match qu’à l’entraînement. Si on la maîtrise et qu’on est fort en contre-attaque, cela augmente les probabilités d’avoir une occasion. Et plus on a d’occasions, plus on peut marquer de buts. Tout cela combiné permet d’augmenter les chances de victoire. Alors oui, il y a aussi plus de prises de risque, notamment dans les passes, mais ça nous permet de nous trouver dans une meilleure situation de départ que lors d’une longue phase de possession. Il en va de même pour ce qui est des deuxièmes ballons. Nous voulons rapidement nous trouver à un endroit qui peut représenter un danger de but pour l’adversaire. Si un ballon au sol ne parvient pas à casser les lignes adverses, nous utilisons les passes en hauteur ciblées. Nous voulons toujours nous montrer proactifs et imprimer notre rythme au match, que nous ayons le ballon ou non. En fait, nous attaquons presque tout le temps. Soit en direction des cages adverses, soit en attaquant la possession de l’équipe d’en face pour pouvoir ensuite nous projeter vers ses buts.
![]()
Tout à l’heure, vous parliez d’idéal, mais Guardiola réussit souvent à gagner grâce à un jeu de possession. Il utilise aussi un fort contre-pressing, mais en fait une autre utilisation. Trouvez-vous son football plus ennuyeux ?Je ne dirais pas que le style développé par Pep est si différent que ça du nôtre, même s’il cherche, comme vous le dites, avant tout à contrôler le ballon et à établir de longues phases de possession. On n’a tout simplement pas la même façon de voir le football. Il y a quelques années, lors d’une conférence donnée à Cologne, Jürgen Klopp expliquait que 80% de ses entraînements tactiques à Dortmund étaient destinés à aider son équipe à réagir lorsque l’adversaire avait le ballon. Pep, lui, travaille avant tout la manière de jouer lorsque son équipe l’a. C’est aussi une question de circonstances, car partout où il est passé, Pep Guardiola a toujours eu la possibilité de choisir parmi les meilleurs joueurs disponibles plus ou moins partout dans le monde. Il y a aussi une question de surprise, et on voit aujourd’hui que Jürgen a évolué un petit peu, car les autres équipes agissent forcément différemment lorsque vous commencez à gagner… Donc il faut vous adapter. Avec Leipzig, on a aussi connu ça : la première année en Bundesliga, on était les petits nouveaux, et on a terminé deuxièmes. Dès notre deuxième saison, les adversaires se sont adaptés à notre style. Il faut toujours trouver en permanence des nouvelles solutions, mais la base ne bouge pas. Prenons le cas de l’Espagne : en 2012, Vicente del Bosque a emmené Pedro à l’Euro, et il a fait trois fois plus d’appels en profondeur que tous les autres joueurs de la compétition. Parfois, il était utilisé en tant que destinataire de passe, mais bien souvent il effectuait des courses « sacrificielles » pour libérer de l’espace à ses coéquipiers. Ce rôle de créateur d’espace a été extrêmement important pour l’équipe espagnole. Je veux dire par là qu’après les deux tournois précédents, qui avaient été réussis, ils étaient parvenus à acquérir une autre arme et à se réinventer. Le football, ce n’est pas noir ou blanc.
Est-ce que le contre-pressing peut-être considéré comme une forme de réponse à ceux qui ont le privilège de choisir leurs footballeurs, comme Guardiola ? Avec Hoffenheim, quand nous avons été promus en Bundesliga en 2008, il y avait énormément de ça, oui, et je pense qu’on a montré que la tactique pouvait l’emporter sur des jolis noms couchés sur une feuille. Pep Guardiola est un grand entraîneur, mais c’est toujours plus simple si vous avez la possibilité de choisir les joueurs dans un catalogue et que vous avez toujours les meilleurs éléments à disposition. Avec Hoffenheim et Leipzig pour moi, ou à Liverpool pour Klopp, ça n’a jamais été le cas. On a développé autre chose. On fait grandir les joueurs à travers un collectif. Par exemple, prenons le cas de Marcel Sabitzer, qui est arrivé à Leipzig en 2014 et qui a passé un an à Salzbourg en prêt pour apprendre. Aujourd’hui, s’il a un tel niveau, cela s’explique uniquement par le fait que toute l’équipe l’a fait grandir. C’est un symbole parfait de notre approche et c’est l’illustration parfaite que dans un sport collectif, vous gagnez avant tout les matchs lorsque votre équipe avance collectivement. À Leipzig ou à Salzbourg, si on perd ça, on perdra. La qualification contre Tottenham en Ligue des champions, c’est aussi le résultat d’un développement collectif et d’une conception collective du football, puisque la plupart des joueurs sont ensemble depuis deux ou trois ans.
Qu’est-ce que votre histoire raconte de l’Allemagne finalement ? Je ne sais pas… Tout ce que je sais, c’est que mon staff et moi, on a toujours regardé ce qui se faisait ailleurs. Ça découle d’une forme de logique : si tu veux faire progresser ton équipe et l’emmener au meilleur niveau possible, tu dois être quelqu’un d’ouvert et tu ne peux pas te contenter de ce que tu sais. Tu dois t’enrichir, en permanence, et tout analyser. Quand j’étais joueur, en troisième division, que j’avais 18-19 ans, j’étais déjà dans cet esprit. Et je me posais beaucoup de questions, notamment quand les journaux notaient les performances des joueurs. Parfois, il était écrit que j’avais fait un bon match en tant que numéro six, que j’avais bien contenu le meneur de jeu adverse, alors qu’en réalité, je n’avais touché le ballon que six ou sept fois dans la moitié de terrain adverse… À mes yeux, cet investissement partiel était insuffisant. Quand j’ai voulu devenir entraîneur, j’ai toujours eu cette envie intime : il fallait avoir une approche différente des choses, je voulais que mon équipe soit attrayante, qu’elle ne soit jamais ennuyeuse, qu’elle soit proactive… Et ça, même avant de rencontrer Helmut. Il m’a montré la voie pour y parvenir. J’ai réussi à créer des équipes qui ont leur propre modèle, leur propre façon de voir les choses, et ça, c’est une fierté.
Vous avez déjà discuté avec Arrigo Sacchi de tout ça ? Je l’ai rencontré une fois, en 2011. C’était à San Siro, avant le quart de finale de Ligue des champions contre l’Inter. (Son équipe, Schalke 04, futur demi-finaliste de la compétition, s’était alors imposée 2-5 contre le tenant du titre, NDLR.) La veille de la rencontre, le CEO du Milan est venu à l’hôtel, et on a discuté un petit peu, parce que certains journaux italiens avaient publié des articles sur moi à l’occasion du match. Il m’a dit qu’il était encore en contact avec Arrigo, il l’a appelé, et on a discuté pendant 30 minutes tous les deux. On a parlé des années 1980, de l’influence qu’il avait eue sur moi, des heures que j’ai passées devant son Milan… C’était sympa. Pour lui, ça a dû être bizarre qu’un coach allemand ait été aussi affecté par son travail.
Pensez-vous encore pouvoir faire progresser votre style ? Aujourd’hui, tout va à 2000 à l’heure, y compris en matière de football. Les staffs sont plus importants que jamais, les analystes sont de plus en plus nombreux… Le football n’a jamais été aussi « décortiquable » , et c’est ce qui me fait dire que le jeu ne s’arrêtera jamais de progresser. Selon moi, on est encore très loin d’avoir fait le tour de la question. Je pense notamment que la réflexion intellectuelle des joueurs va devenir encore plus importante dans les années à venir, que le jeu va se décider dans des espace-temps encore plus réduits. Tout va s’accélérer encore plus, et les joueurs vont devoir être encore plus prêts physiquement. C’est aussi le sens de la vie…
![]()
Propos recueillis par Maxime Brigand