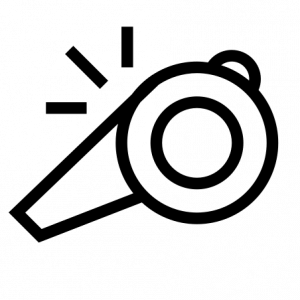- MLS
- Finale
- Seattle-Toronto
Quentin Westberg : « Dans le foot, si tu t’attaches à ton contrat… »

Parti d’Auxerre à Toronto en février dernier, Quentin Westberg aka « Q » s’apprête à disputer la finale de la MLS ce dimanche face à Seattle (coup d’envoi 21h HF). Heureux dans la vie et décisif sur le terrain, le gardien de 33 ans raconte sa double culture franco-américaine, Toronto et les années Clairefontaine, avec le boubou offert par Abou Diaby et du Nelly dans les oreilles.
Ta mère est française et ton père vient des États-Unis : comment se sont-ils rencontrés ?Ma mère étudiait l’anglais à la fac de Nanterre (Hauts-de-Seine) et elle a eu une bourse d’étude pour aller aux États-Unis pendant l’été, à Middlebury College, au nord de Boston. C’est là qu’elle a rencontré mon père, qui faisait lui des jobs d’été sur le campus pour financer ses études de théâtre. Ensuite, ils ont habité pendant quelques années à Atlanta, où ma mère donnait des cours de français. Vu que ma mère avait une possibilité d’emploi stable en France et que pour mon père, c’était à coups d’opportunités ici et là, quand est arrivé le moment de fonder une famille, ils ont déménagé. Et je suis né en France en 1986.
Ton père faisait quoi exactement ?Sa vocation, c’est d’être metteur en scène. Il faisait des voix, des traductions, de l’enseignement pour économiser et lancer son spectacle. Toute ma jeunesse, c’était ça : mon père bossait pendant six mois, ensuite, il allait au festival d’Avignon dans des salles d’une dizaine de personnes ou des salles parisiennes grandes comme un salon, où tu dois descendre un escalier à 60°c pour aller dans les loges… C’était l’environnement théâtral du bas de l’échelle.
Comment tu percevais ça étant gamin ?
Ça m’a forgé de le voir poursuivre ses rêves, sans énormément de succès, mais je le voyais ne jamais rien lâcher. Je me souviens que je le suivais dans ses répétitions. En fait, ce qu’il a fait, ça ressemble beaucoup à ce que nous, on fait dans le foot. On a tous des espoirs de Ligue des champions, mais il faut savoir se contenter des projets qui s’offrent à toi en National. Et cartonner en National, ça t’ouvre les portes de la Ligue 2.
Tu as grandi dans les Hauts-de-Seine et tu retournais chaque été en vacances aux États-Unis, dans l’état du Rhode Island.C’est là où mon père a grandi. Il est d’un milieu très modeste, d’une petite ville presque rurale du Nord-Est américain, aux alentours de Providence, la capitale du Rhode Island. Un truc qui me choquait : à chaque fois que mon oncle venait nous chercher à l’aéroport, il parlait pendant une minute avec le péager : « Comment ça va ? » « Bien, et toi ? Quoi de neuf ? » « Bah là, je suis venu chercher ma famille qui vient de France. » Je ressentais une chaleur humaine beaucoup plus palpable.
Qu’est-ce que tu retrouvais aux USA qui n’existait pas en France ?Il n’y avait pas de haie ou de cloison entre les jardins. Tout était ouvert. C’était des fêtes entre les voisins, des barbecues…. Tout le monde veillait sur tout le monde. Un vrai sens de la communauté.
Tu aimais faire quoi là-bas ?Le foot ! Avec mon petit frère – plus jeune de deux ans – on a aussi beaucoup joué au tennis. Ce n’est pas comme en France, où il y a cette image un peu élitiste. Il suffit d’avoir une raquette et des balles, tu vas sur le terrain. Et si du monde commence à arriver, tu laisses ta place. Sinon, mon oncle et mon grand-père m’ont entraîné au stade de baseball voir les Pawtucket Red Sox.
Ta première licence dans un club de foot, tu l’as prise où ?À Saint-Cloud. Très vite, j’étais surclassé. Un jour d’hiver, il pleuvait des cordes, les coachs m’appellent, et là, ils me donnent un maillot de Bernard Lama, que j’adorais. Ils me récompensaient parce que j’étais assidu. Dans ma tête, je me disais : « Si vous saviez la misère que je fais à mes parents pour aller à l’entraînement… » Pour moi, c’était normal. Je jouais au foot à la récré. Quand je ne jouais pas au foot à la récré, je jouais au foot avec mon frère. Et si mon frère n’était pas disponible, je jonglais dehors. Le premier record dont j’étais fier, c’était 32 jongles ! Je peux pas te dire à quel âge. C’était devant la maison de ma grand-mère aux États-Unis.
Tu étais gardien depuis ton plus jeune âge ?
Si je voulais rentrer dans le match avec les plus grands, il fallait que je sois goal. C’est quelque chose qui m’a plu à partir du moment où j’étais en club. Dans la cour de récréation, dans la rue, partout ailleurs, impossible de me mettre dans les buts ! Moi, si je suis goal, c’est pour organiser ma défense. Si c’est le carnaval devant, c’est pas la peine. Donc je préfère m’amuser et développer d’autres qualités. Aujourd’hui, si je vais faire un five avec mes potes, je joue n’importe où à part dans les buts.
À l’INF Clairefontaine, que tu intègres à l’âge de 13 ans, tu es surnommé « L’Américain » . C’est parce qu’il y a eu ces sessions de freestyle immortalisées dans la série À la Clairefontaine ? T’as l’impression que je faisais ça tous les week-ends. On va pas se mentir, il y en a eu cinq maximum. (Rires.) C’était marrant de le faire en anglais, et puis il y a des Antillais qui rappaient en créole. C’était un truc qu’on kiffait faire ensemble. Ce qui était génial à Clairef’, c’est qu’on a tous partagé énormément sur nos origines. Quand je rentrais de vacances, je ramenais à mes potes les plus proches des T-shirts en solde – qui étaient sans doute trois fois trop grands – des universités américaines. Abou (Diaby) m’avait ramené un boubou ivoirien. Sur la fermeture éclair, il y avait le signe Toyota. Je m’en rappellerai toujours.
À l’époque, Internet n’était pas accessible. J’enregistrais la musique sur cassette audio : Nelly, Alicia Keys, 50 Cent, Fabolous… C’était vraiment des sons que je ramenais à Clairef’ avant tout le monde parce que ça sortait en France plusieurs mois après.
Tu considères que la relégation administrative de Luzenac en 2014 a beaucoup pénalisé ta carrière ?Mi-septembre, pour trouver un club, c’est compliqué, mais alors quand tu es gardien de but… Je m’entraînais tous les jours. Avec mon entraîneur Olivier Lagarde, qui est aujourd’hui à Lorient, il fallait qu’on trouve des terrains grâce à son réseau, et on s’est fait virer de certaines villes ! On nous disait : « On veut bien que vous vous entraîniez quatre, cinq jours, mais pas toute l’année. » Il fallait aussi qu’on trouve des ballons, j’avais sollicité l’intendant d’Évian à l’époque.
Et comment t’as surmonté ces mois sans club ?Soit t’es déterminé, tu survis, soit t’en as marre et tu lâches tout. J’en reparle souvent avec ma femme, à l’époque, je n’ai même pas eu l’impression de souffrir. J’ai juste eu l’impression de continuer à travailler. Aujourd’hui, je n’apprécierais peut-être pas à sa juste valeur ce que je vis à Toronto si je n’avais pas vécu ça.
En février dernier, tu as signé à Toronto. Qu’est-ce qui caractérise la vie au Canada ?À Toronto, tu rencontres rarement quelqu’un dans la rue qui parle anglais sans un accent étranger. Il y a énormément de communautés différentes rassemblées. En comparaison aux USA, où il y a un côté : « tu as raison quand tu gagnes, quand tu es le plus riche, quand tu es le meilleur, quand tu es le plus fort » , ici, la mentalité est plus relax dans les grandes villes.
Tu t’apprêtes à disputer ce dimanche une finale de MLS devant 70 000 personnes après avoir passé plusieurs saisons comme remplaçant en Ligue 2. C’était inespéré pour toi ?
Enlève le cadre de la finale : le fait d’être à Toronto, en matière de kif, il n’y a pas d’égal avec ce que j’ai connu auparavant. Tu joues dans des stades remplis, tu as des structures exceptionnelles… À Auxerre, on gagnait, l’équipe tournait bien, sauf que je voyais un peu plus loin. Je me suis tiré une balle dans le pied financièrement en venant à Toronto, mais c’était une expérience culturelle, familiale et sportive que je voulais vivre, alors j’ai fait le forcing pour partir d’Auxerre. Même si je suis arrivé comme numéro 2, il n’y a rien qui pouvait me faire penser que j’étais dans l’échec vu ce que j’avais connu auparavant. Mon parcours, ça a toujours été le combat. Depuis Luzenac, partout où je suis allé, je suis passé devant le numéro 1. En arrivant à Toronto, je n’allais pas tous les jours dans le bureau de l’entraîneur (Greg Vanney). On se serre la main le matin en se regardant droit dans les yeux et après on fait le taf. Il m’a fait jouer un match et un deuxième. L’autre gardien (Alex Bono) a rejoué. Et puis, j’ai continué. À l’américaine, c’est le terrain qui parle.
En play-offs, vous avez sorti DC United, puis New York City (qui avait le meilleur bilan de la saison régulière à l’Est). En finale de conférence, vous êtes menés 1-0 sur la pelouse d’Atlanta, le champion sortant. Atlanta a un penalty pour mener 2-0, mais tu sors le péno et vous allez chercher la victoire 2-1. Raconte-nous ce face-à-face…Sur le moment, t’as pas le temps de réfléchir. Le tireur, son habitude est d’ouvrir son pied. En me mettant à sa place, j’ai plongé à droite, contre ses habitudes… Quand le ballon quitte ma main, je suis juste content qu’on ne se retrouve pas à 2-0 pour Atlanta. Je ne vais pas me donner plus de crédit que je n’en mérite. Peut-être que ça va déplaire à des gardiens… Mais, selon moi, quand tu arrêtes un penalty, c’est qu’il est mal tiré.
On sent que tu t’attaches au club pour lequel tu joues…J’ai joué à Tours. C’est un club disons dysfonctionnel en étant gentil, eh bien j’ai pris énormément de plaisir à jouer à Tours. Parce que j’ai apprécié la vie là-bas, parce que ma famille s’y sentait bien. C’était presque difficile de quitter Tours pour aller à Auxerre ! Alors qu’il le fallait pour ma carrière. Actuellement, je n’ai envie de jouer nulle part ailleurs qu’à Toronto. Dans le foot, si tu t’attaches à ton contrat, mais pas au club pour lequel tu joues, nan, ça marche pas !
Tu as dit dans une interview : « Je ne rêve de rien de matériel. » Ça découle de ton éducation ?
Je n’ai jamais grandi dans le luxe matériel. Mes parents, ils ont travaillé dur et quand ils avaient un peu d’argent de côté, ils nous amenaient trois jours à Amsterdam ou à Londres. Et puis, il fallait payer les billets d’avion pour partir l’été aux États-Unis. En tant que parent, ce n’est pas possible pour moi de laisser mes enfants devant la télé toute la journée. Ce serait bafouer l’éducation de mes parents, et même mes valeurs personnelles.
Qu’est-ce que tu aimes faire avec tes enfants à Toronto ?J’ai trois enfants et une femme qui m’ont suivi de l’autre côté de l’Atlantique : une fois que je sors du cadre du club, c’est tout pour ma famille. Je les amène à leur entraînement de foot, j’amène ma fille à la crèche, j’aime partager ces moments de vie simple. On découvre des restaurants, on va se balader, on va voir un match des Raptors (basket, N.D.L.R.), des Maple Leafs (hockey sur glace, N.D.L.R.)…
Gagner la MLS, c’est la plus grosse motivation de ta carrière ?Franchement, je n’ai même pas pris le temps de me poser pour réfléchir à ça. Je n’ai jamais joué la Ligue des champions, je n’ai même pas été établi en Ligue 1, mais j’ai connu quatre montées. C’est des moments que l’on ne m’enlèvera jamais. Et de ces quatre montées, je ne me rappelle pas des matchs décisifs, mais les moments partagés une fois que le coup de sifflet final a retenti et que tu peux regarder ton coéquipier dans les yeux en te disant : « Cette année, on a fait ce qu’il fallait. » Que ce soit à Évian, Troyes ou Luzenac, j’ai des amis, des frères avec qui j’ai partagé un moment exceptionnel. C’est ça que je veux vivre à Toronto.

Propos recueillis par Florian Lefèvre