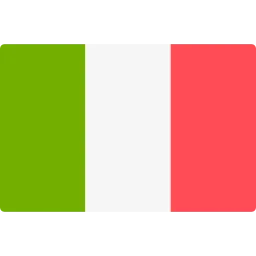- Coupe du monde 2014
- Le peuple de l'herbe
- J3
- Billet d'humeur
Quand nous étions rois

C'était à Kinshasa, il y a tout juste quarante ans, mais c'était hier à Manaus. À la fin d'une journée remplie de matchs qu'on aura bientôt oubliés, il y eut un combat mythique au milieu de la jungle. Et Don King, c'était Sepp Blatter.
On est un peu bancal quand on regarde un Mondial. Le samedi arrivé, on hésite toujours un peu entre le réel (une bière entre amis) et l’imaginaire (un Angleterre-Italie dans la jungle). Ce n’était que le premier tour, c’est vrai. Il y en aurait d’autres des matchs à regarder, des corners de Wayne Rooney. Mais plus on s’immergeait dans cet évènement global (cf le fameux Stade Global de l’application FIFA pour iPad), plus on aurait aimé y appartenir, être Tejeda, l’attaquant costaricain qui fut remplacé à quelques minutes de la fin et qui avait l’air tellement fier d’avoir ridiculisé l’Uruguay que ses expressions de joie auraient très bien pu être aussi celles de la colère. Hier soir, on était aussi Pablo Armero, le défenseur colombien qui nous offrit la plus belle célébration de la prochaine décennie. Il venait de marquer le premier but de son pays dans cette Coupe du monde. Il avait gagné le droit d’être le centre du monde pendant quelques secondes. Une fois débarrassé des bras encombrant de ses coéquipiers qui s’accrochèrent à lui, il courut vers le banc de touche, se signa en chemin, leva les bras au ciel (parce qu’il fallait bien remercier un ou deux saints pour ce ballon contré qui entra tant bien que mal dans le petit filet grec) et puis alors, l’air très concentré, il entama la chorégraphie de ses émotions et fit danser en rythme ses coéquipiers et toute la moitié d’un stade. Être Armero juste un instant, un instant seulement.
Rendez-vous dans le rond central
Il y eut une époque où les célébrations étaient encore privées. On ne voyait que très rarement le visage de celui qui venait de marquer un but et d’exploser de joie. Souvent il était de dos, courait au loin vers une tribune et cette joie réelle n’était destinée qu’à ceux qui étaient présents dans le stade. Ils étaient au plus près de ces cris, de ces bras levés et de ces courses folles sous le soleil qui était souvent mexicain. C’était le moment où l’on souffrait le plus de ne pas être à côté d’eux, où notre position de téléspectateur était la plus bancale et la plus insupportable. À la fois présents et absents, nous voyions l’évènement qui se déroulait à des milliers de kilomètres de nous, mais nous étions privés de sa sensation physique. Réduits à notre condition de consommateur d’évènement historique, notre point de vue n’était que celui du plan large c’est-à-dire celui de l’étranger. Mais depuis qu’on inventa les plans serrés et les super-ralentis, c’est exactement l’inverse. Maintenant, tout nous est destiné et les étrangers c’est les autres, les spectateurs. Le mouvement du drapeau de la FIFA qui recouvre le ballon en entrant sur le terrain, l’arbitre du match se saisissant du cuir en nous regardant dans les yeux, les travellings sur les visages émus des joueurs entamant leur hymne national, les gros plans sur les fans grimés aux couleurs de leurs favoris, les ralentis, et même cette année cette nouvelle idée de la FIFA : empêcher les joueurs de quitter la pelouse immédiatement après le coup de sifflet final. Au nom du fairplay où de quelque chose d’autre, les joueurs devront se serrer la main, s’embrasser et échanger leurs maillots dans le rond central, devant les yeux de la multitude admirative. Tout est spectacle. Il y avait les célébrations de but, il y aura maintenant l’échange de maillot.
Rumble in the Jungle
Mais cette cinquantaine de caméras autour de ces stades, toutes ces nouvelles liturgies télévisuelles, ne pourront jamais rien contre la délicieuse ivresse d’une fin de soirée au milieu de la forêt. Dans trois semaines quand on aura bien vibré, quand on aura retardé le plus longtemps possible le temps de la déception et du retour à la vie réelle, à la vie sans foot, on ne se souviendra plus de ce Colombie-Grèce, de cet Uruguay-Costa Rica, de ce Côte d’Ivoire-Japon, mais certainement nous souviendrons-nous encore de cet Italie-Angleterre fabuleux. Comme Ali retrouvant Foreman à Kinshasa au milieu de la poussière et de la mousson, les Italiens retrouvèrent les Anglais au milieu de l’Amazonie dans une atmosphère étouffante. 30 degrés, 70% d’humidité. Les plus idiots avaient peut-être raison. Ce n’étaient pas des conditions normales pour jouer au foot. Si les indiens d’Amazonie n’ont pas d’équipe à la Coupe du monde, c’est parce qu’ils savent bien qu’il est irresponsable de courir 12 kilomètres en moyenne dans pareilles conditions. Pourtant c’est bien de cette atmosphère irrespirable, de ces insectes étranges peuplant les projecteurs, de cet invraisemblable folklore télévisuel au milieu de la jungle, c’est bien de toute cette poésie primitive que sont faits les combats mythologiques. Pour bien dépasser les bornes, « il faut savoir jusqu’où aller trop loin » (Alexis Philonenko, Histoire de la boxe). Cet Angleterre-Italie dépassa largement les frontières entre le réel et l’imaginaire. Sous nos yeux, la forêt primaire et monstrueuse reprenait le dessus et deux hommes se mesuraient l’un à l’autre dans un paysage hostile. C’était le premier round. Il était 2 heures du matin. Mohammed Ali montait sur le ring. Dans les tribunes de Manaus magnifiquement sonorisées, on entendit tout à coup l’impensable « Ali Bomayé » résonner. Et l’Italie dégomma l’Angleterre de deux directs en pleine mâchoire. C’était le match du siècle. C’était Italie-Angleterre.
Par Thibaud Leplat