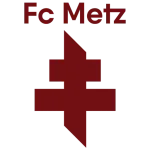- Portrait
- Article issu du magazine
Quand Donald Trump était milieu de terrain

Donald Trump est un président qui, au pays du baseball, du basket et du foot US, a longtemps entretenu des liens avec le soccer. Des exemples ? En 1991, il secoue les boules du tirage au sort de la Coupe de la Ligue anglaise. L’année avant son élection, il tente de racheter un club colombien. Mieux, le Donald a même joué au football. Une seule saison, en 1962-1963, au milieu de terrain des Scarlet Nights, l’équipe d’une école militaire new-yorkaise. Retour sur une année qui a façonné le bonhomme. Qui, à l’époque, n’avait aucun mal à jouer avec des Mexicains...
Donald Trump marche vers les vestiaires, un petit sourire en coin. Sa mine enjouée respire l’autosatisfaction. Il vient de terminer son décrassage au lendemain d’un match de soccer. Sur le chemin, il croise Sandy McIntosh, un camarade de classe qui sort d’un entraînement de baseball. Au printemps 1963, les deux adolescents, 16 ans, sont étudiants à la très sportive New York Military Academy, NYMA pour les intimes, un internat militaire de l’État du même nom. Pressé, Sandy n’a qu’une idée en tête : filer sous la douche pour éviter la queue. Donald, lui, a envie de parler. Il entame la conversation. Sans passer par les salutations : « Je présume qu’on t’a parlé de mon but que j’ai planté hier avec l’équipe ? » Sandy McIntosh s’arrête net, surpris. Et pour cause : il était présent au bord du terrain.« Euh, Donald, il ne me semble pas que tu aies marqué de but… » Trump contre-attaque. Sèchement.« Si, j’ai marqué un but! Et j’ai frappé tellement fort que j’en ai même décroché les filets… Je veux que tu te souviennes de ça. Je veux que tout le monde s’en souvienne. » Plus de cinquante ans après, Sandy est toujours mort de rire. « En vérité, il n’y avait même pas de filet dans les buts… On se foutait de leur gueule d’ailleurs. Ça montrait qu’à l’école, ce sport était ringard comparé au football, le vrai, le basket ou le baseball. » Mais alors, pourquoi Trump s’arrange-t-il autant avec la vérité ? Sandy a sa petite idée : « Je pense qu’il créait déjà sa propre légende. »
Il frappe son prof de musique
Une légende qui s’achève en apothéose. Le 8 novembre 2016, Donald Trump devient le 45e président des États-Unis face à la démocrate Hillary Clinton, déjouant tous les pronostics et laissant derrière lui une carrière d’homme d’affaires dont la fortune personnelle est estimée, par lui-même, à 3,7 milliards de dollars. « On va être agréablement surpris, assure à l’époque Max Appedole, riche promoteur immobilier qui se surnomme lui-même le « mini-Trump mexicain ». Normalement, les politiciens déçoivent, mais lui ce n’est pas un politicien, donc il ne va pas nous décevoir. » Plus qu’un soutien, Max est un ami personnel du président américain. Il était là pour l’inauguration de la Trump Tower, en 1983. « Il m’a reconnu et m’a dit : « Tu n’as pas changé, Max. » Je lui ai répondu que c’était grâce aux fiestas que j’organisais. Il m’a répondu : « J’ai le même secret de beauté. » » Les deux hommes se connaissent depuis longtemps. Depuis l’école de football de la NYMA avec laquelle Donald ne joue qu’une saison, celle de sa senior year of high school, de l’automne 1962 à l’été 1963. Une année charnière dans la vie de Donald au sein d’une académie qui a « changé sa vie » selon Max : « Il est devenu l’homme qu’il est grâce à elle. »
Comme dans tout bon scénario hollywoodien, rien ne le prédestine en effet à un tel destin. Fils de Fred Trump, richissime agent immobilier new-yorkais, radin et intransigeant, Donald a longtemps du mal à régler ses pas dans ceux de son père. Pour attirer l’attention, l’enfant hyperactif mise tout sur ce qu’il sait déjà faire de mieux : provoquer. En primaire, il se fait exclure à la mi-temps d’un match de football organisé entre écoles du quartier. « Il mangeait des oranges entières, sans avoir pelé la peau, en fixant droit dans les yeux les adversaires pour leur montrer que c’était un petit dur », rappelle Paul Onish, ancien camarade de classe devenu assureur. Quelques semaines auparavant, Donald avait déjà mis un coup de poing dans l’œil de son professeur de musique parce qu’il « n’y connaissait rien à la musique », justifiera plus tard l’intéressé. « Qui pourrait l’oublier ? soupire Ann, l’une de ses anciennes instructrices. Il était déjà coiffé de cette sempiternelle mèche blonde, assis avec ses bras croisés et ce regard sur son visage hargneux comme s’il mettait au défi de lui dire quelque chose qui n’allait pas lui plaire. Il refusait de reconnaître ses erreurs même lorsqu’elles étaient évidentes. » Lassé de recevoir des coups de fil du proviseur, c’est Fred qui décide, en 1959, d’envoyer du jour au lendemain son fils à la NYMA. Donald a 12 ans lorsqu’il enfile l’uniforme pour la première fois.« Ce fut une sorte d’exclusion du foyer, analyse son biographe Michael D’Antonio. Il n’avait rien fait de méchant, mais d’un seul coup, il s’est retrouvé éloigné de sa famille et du mode de vie confortable qu’il connaissait jusqu’alors. »
Trois victoires en onze matchs
Dans le manoir familial du Queens, Trump dégustait des hamburgers maison concoctés par des domestiques et occupait ses soirées à regarder la télévision couleur, un luxe à cette époque. À la NYMA, il mange désormais des macaronis au fromage à tous les repas, se fait réveiller à l’aube au son du clairon et découvre les montagnes des Storm King, à 100 kilomètres au nord de New York, où trône l’école, en périphérie du petit village rural de Cornwall-on-Hudson. La NYMA a des airs de château fort. Un vieux morceau de char accueille les visiteurs, ainsi que de grands arbres centenaires que l’automne jaunit. Fondée en 1889, l’école militaire a déjà calmé les ardeurs du fils de Fulgencio Batista, figure de la révolution cubaine chassée par Fidel Castro, ou encore Joe Bonanno, un célèbre mafioso italo-américain surnommé « Joe Bananas » . Elle fait office de maison de correction pour les fils à papa du monde entier. Jack Serafin, un ancien élève, pose d’emblée : « Vous vous souvenez du filmFull Metal Jacket? Eh bien voilà, vous visualisez cela, mais à 12 ans. C’était un environnement dur, mais cela a formé des gens assez exceptionnels. » Pour Trump, le chemin vers l’exception est semé d’embûches : il ne sait pas comment faire un lit, sait à peine nouer ses lacets seul et ne sait pas du tout qu’il faut se laver les dents le soir avant de se coucher. Pour survivre, il met alors son énergie dans un domaine pour lequel il se découvre des qualités naturelles : le sport. Son principal atout ? Son physique. « Sur un terrain, il ne passait pas inaperçu, remarque Appedole. Il était puissant et rapide. Il était athlétiquement au-dessus. »
Trump est de toutes les crèmeries : baseball, basket, football, squash, dodgeball et bien entendu soccer au sein des Scarlet Nights, l’équipe de l’école.« Mais personne ne l’appelait comme ça, clarifie Alfred Harrison, l’un des attaquants. On s’appelait entre nous les « Nosotros ». » La raison ?« La majorité des joueurs venait de familles aisées d’Amérique du Sud ou du Mexique qui voulaient donner une éducation stricte à leurs enfants », prolonge Paul Curtin, le fils du coach. Donald n’est pas largué. Quand il était plus jeune, il emportait déjà un ballon rond en vacances sur les plages privées de Long Island, quand tous les autres lançaient des balles de baseball dans le gant de leurs pères. « Il a vite appris le soccer, même si ce n’était pas son sport fétiche, éclaire Paul Curtin. Il avait une bonne lecture du jeu sur le terrain. » Donald joue milieu défensif, dans un rôle de sentinelle, et porte le brassard de capitaine. Ses mots avant le coup d’envoi ? Toujours les mêmes. « La victoire n’est pas tout, c’est la seule chose qui compte. » Déjà à l’époque, Donald a « peu de tolérance pour les sottises », se souvient Ted Pait, arrière gauche. Mais c’est un « bon coéquipier, un mec qui joue en équipe, apprécié et respecté ». Jouer en équipe oui, mais en chef d’équipe : « Il voulait être le premier, et que tout le monde sache qu’il était le premier », enchérit McIntosh. Une quête qui demande parfois des sacrifices. Max en sait quelque chose : « Il avait compris que pour gagner au foot, il fallait jouer collectif. Faire des passes. Il faisait des passes à tout le monde. Même aux Mexicains… »
Le brassage culturel est en effet très important.« C’était très cosmopolite, abonde Appedole. Trump ne brillait pas parce que son père avait plus d’argent. Il y avait des fils de rois et de présidents du monde entier qui étaient plus riches que les Trump. Je me souviens que le père d’un élève venait le chercher à l’école en hélico. Aujourd’hui, c’est commun(sic), mais à l’époque, ça ne l’était pas. » Malgré le pouvoir d’achat de leurs parents, les coéquipiers sont tous logés à la même enseigne. « Je donnais 1,75 dollar à chaque joueur pour le dîner dans le bus lorsque nous rentrions d’un match à l’extérieur », compte Ted Pait, chargé de la logistique. Les déplacements sont une bouffée d’air frais. « On partait avec des guitares, un accordéon, des percussions et on mettait une ambiance folle à l’arrière du bus, poursuit Harrison.On aurait dit Tito Puente sur la route en tournée ! » En arrivant sur la pelouse, c’est le même folklore. « Certains chantaient l’hymne national de leur pays sud-américain avant le coup d’envoi, quand ce n’était pas notre cri de ralliement :« Nosotros, nosotros, rah, rah… » » Sur le pré, leur finesse technique et leur jeu au sol gênent les équipes adverses, en majorité des écoles publiques réparties dans tout l’État new-yorkais. Et pour qui le foot ressemble davantage à son cousin américain : « Ils jouaient très durs », soutient Alfred, dont le poignet fut fracturé contre Ellenville, une équipe de rednecks d’un village de quelques milliers d’habitants. Si deux années auparavant, l’équipe de soccer de la NYMA a remporté le championnat d’État sous l’impulsion d’un coach anglais, cette année est plus difficile. Malgré un bon début de saison, avec trois victoires en trois matchs, les Nosotros ne résistent pas longtemps à l’accueil physique de leurs opposants. Ils terminent derniers au classement, avec trois victoires en onze matchs. Et quelques regrets ?« Pas du tout, tranche Alfred Harisson.Mon plus grand frisson est d’avoir été dans l’une des écoles pionnières dans le développement du foot aux États-Unis, et de voir tous ces terrains de soccer sur lesquels mes petits-enfants jouent aujourd’hui. »
« Play -boy, ce n’était pas la vraie vie… »
Pour Donald aussi, l’essentiel est ailleurs. « Trump, le sportif de l’année », titre en 1963 l’almanach de fin d’année de l’école.« C’est bon de voir son nom imprimé, confesse l’heureux élu. C’était la première fois que j’étais dans le journal. » Dans la foulée, il est élu « Ladies man » par le reste de l’académie. Les filles sont mêmes invitées à voir ses exploits sur les terrains de sport. Discrètement, car elles sont évidemment interdites d’entrée sur le campus. « Comme tout le monde se fichait du soccer, il ne devait y avoir personne pour s’en apercevoir à ce moment-là. Et puis, on sait tous qu’aux États-Unis, le soccer est un sport de nanas, se moque Sandy. Nous parlions tous de la même façon : de manière profane. Aussi bien des minorités, des camarades qui n’avaient pas la même religion que nous et des femmes. En fait, notre principale source d’inspiration, c’étaitPlayboy. C’est parPlayboyque nous avons commencé à nous sensibiliser à la condition féminine. C’est pourquoi l’après-NYMA fut compliqué : on a dû réaliser quePlayboy, ce n’était pas la vraie vie… » Dans sa chambre, il change l’ampoule au plafond pour en mettre une autre à la lumière ultraviolette, et donc bronzante… Pas peu fier, il annonce à ses colocataires : « Nous allons à la plage. » Il devient délégué de classe et organise des sorties scolaires à Manhattan pour que les élèves « s’imprègnent de la culture business, renseigne Max Appedole. Entre nous, on disait qu’on était les chefs des forces armées. Et dans son cas, c’est devenu réalité. Il était destiné à gouverner. C’était son destin. »
À 18 ans, Donald quitte d’ailleurs l’académie pour entreprendre des études d’économie et commence à travailler avec son père. Fred découvre alors un homme. Un nouvel homme. Quand son biographe évoque avec lui ces années d’internat, le milliardaire ne parle pas de revanche, mais « d’une influence très positive ». Il confesse même : « Quand je regarde celui que j’étais durant mes premières années et celui que je suis aujourd’hui, je suis fondamentalement le même. » Malheureusement, à la suite d’une blessure au genou subie à l’université en jouant au foot US, il abandonne toute activité sportive. Officieusement, il se murmure que Fred l’aurait contraint à tout arrêter pour qu’il se consacre aux études et au travail. « Bullshit », hurle Sandy McIntosh, qui est certain qu’on se moque encore une fois du monde. « On parle tout le temps de son mental de gagneur et de son physique, mais jamais de sa technique », pointe-t-il. La « sentinelle » aurait mis un terme à sa carrière de footballeur à cause de ses pieds carrés ? Sandy s’interroge : « Je ne suis pas un spécialiste, mais quand vous me dites qu’il faisait peut-être des passes aux Mexicains… De ce que j’ai vu lors de ce match, il n’a surtout pas réussi à en faire une dans les pieds. » La légende, encore une fois.
Retrouvez nos offres d’abonnement à SO FOOT
Opa Sangante : « Là, ce ne sera pas le supporter du PSG, mais le capitaine de Dunkerque »Par Victor Le Grand, avec Hélène Coutard, à New York
Tous propos recueillis par HC, JPS et VLG, sauf ceux de Paul Onish, extraits du Washington Post, ceux de Donald Trump tirés des livres Trump Revealed: An American Journey of Ambition, Ego, Money, and Power et The Art of the Deal.