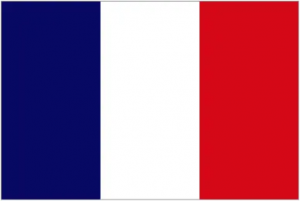- Top 50
- Real Madrid
- n°1
Quand Di Stéfano nous racontait son Madridismo

Alfredo Di Stéfano ? Un papy qu'on sortait de sa boîte à chaque nouvelle arrivée de Galactique au Real Madrid. Élu Ballon d'or des Ballons d'or en 1991, la « Flèche blonde » ne se réduisait pourtant pas seulement à ce VRP de luxe pour grandes opérations publicitaires. Interview légende.
Vous êtes arrivé au Real Madrid en 1953. Votre jeu a-t-il évolué en Europe ? Non. J’étais le même joueur au Real Madrid qu’à River Plate et aux Millionarios. Je n’ai jamais changé ma manière de jouer. Au Real Madrid, j’ai peut-être davantage travaillé sur l’aspect tactique, mais mes qualités techniques sont toujours restées les mêmes.
Quelles ont été vos premières impressions lorsque vous avez débarqué en Espagne ? J’ai été marqué par l’immense tristesse qui se dégageait de la ville et de ses habitants. Les visages des Espagnols étaient fermés. Il y avait énormément de pauvreté et de misère. Tout le monde était habillé en noir. Ça m’a mis mal à l’aise… (silence). Pour être sincère, ça a été un vrai choc. J’avais l’impression d’être en 1820. Les taxis étaient rectangulaires, les rues étaient en très mauvais état… L’Espagne avait cinquante ans de retard sur l’Argentine. Et pourtant je suis resté. Je me suis dit : « Maintenant que je suis là, je vais faire abstraction de tout ça et me concentrer sur mon travail. »
Vous est-il arrivé de vous autoriser des fantaisies uniquement pour procurer plus de plaisir aux spectateurs ? Non, j’ai toujours été à la recherche de l’efficacité maximale. Je n’ai jamais fait de choses futiles pour amuser la galerie. Ma technique, je la mettais en avant dans les moments importants ou difficiles. Procurer du plaisir, ce n’est pas faire le geste de trop à n’importe quel moment. Un beau geste, c’est un geste juste au moment juste. C’est ça, le luxe.
Avant le Real, il était question de Barcelone. Comment avez-vous vécu votre transfert avorté au Barça ? Deux dirigeants du Barça sont venus chez moi à Buenos Aires alors que j’étais en train de passer une couche de peinture sur l’enclos de ma nouvelle maison. Ils avaient entendu parler de moi par des Catalans qui m’avaient vu en Argentine et en Colombie. Là, ils me disent qu’ils m’ont déjà acheté, que l’affaire a été conclue avec les dirigeants de River Plate. Moi, je ne savais pas si c’était vrai ou pas, et j’étais encore sous contrat avec les Millionarios de Bogota. Mais je suis quand même allé à Barcelone avec eux, car ils disaient que tout serait arrangé là-bas. Et ça ne s’est jamais fait.
Pourquoi ? De son coté, le Real Madrid avait obtenu l’accord des Millionarios. Ils m’avaient repéré lors du tournoi des cinquante ans du Real Madrid (gagné par les Millionarios, ndlr) et ils ont négocié directement avec les dirigeants colombiens. Ça annulait du coup l’accord que River avait passé avec Barcelone. Pendant quatre mois, je suis resté au chômage technique sans rien faire en attendant qu’une décision finale soit prise.
Qu’avez-vous fait pendant ces quatre mois ? J’étais à Barcelone en train de moisir… La Fédération espagnole ne voulait pas que je joue avant que le Barça et le Real Madrid ne se soient mis d’accord. Kubala, qui était la grande star du Barça de l’époque, essayait d’organiser des matchs amicaux pour que je ne perde pas le rythme.
Vous ne vous êtes pas révolté contre cette situation ? Si, un jour, j’ai appelé les dirigeants de Madrid et ceux de Barcelone en leur donnant un ultimatum d’une semaine. Si au-delà de cette date, on ne trouvait pas de solution, je retournais définitivement à Buenos Aires.
Un coup de bluff ? Non, j’étais dégoûté, je voulais vraiment rentrer ! J’avais déjà réservé mon billet de bateau. Qu’est-ce que tu voulais que je fasse à Barcelone ? Quitte à se tourner les pouces, autant le faire à la maison.
Votre arrivée en Espagne est devenue une affaire politique… En Espagne, à chaque fois qu’il se passe quelque chose, les gens pensent que les politiciens sont derrière. Ils voient des complots partout ! Les politiciens n’en avaient rien à faire de moi ! J’étais simplement un joueur de foot, alors tu penses bien que je ne les intéressais pas…
On dit pourtant que Franco est intervenu pour que vous signiez au Real Madrid… (Affirmatif) Non ! Mon arrivée en Espagne n’avait rien à voir avec la politique. C’était une affaire de football et de gros sous, mais en aucun cas quelque chose de politique. Quand je suis arrivé, je ne savais même pas qui était Franco. Je pensais que l’Espagne était une République, comme l’Argentine.
Qu’est-ce que vous connaissiez de l’Espagne et du Real Madrid avant d’y atterrir ?Pas grand-chose. Je savais que le torero Manolete était mort en 47, et que le Real Madrid était en train de construire un nouveau stade plus grand… À part ça, je ne connaissais rien du Real. Pourquoi m’y serais-je intéressé ? Mon travail, c’était de jouer au football, pas de faire des rapports socio-économiques. Du moment qu’il y avait une pelouse, pour moi c’était parfait.
Quand avez-vous vu Santiago Bernabéu pour la première fois ?C’était en 1951, dans un studio de radio ou nous étions avec les Millionarios en train de faire la « propagande » du tournoi des cinquante ans du Real Madrid. À l’époque, on se méconnaissait. C’est limite si on ne s’était jamais parlé. J’ai commencé à recevoir des nouvelles de lui quand il m’a vu jouer. Après, on s’est très bien entendus. Ça faisait vingt et un ans que le Real Madrid ne gagnait plus la Liga, et avec moi le club a fini champion à la fin de la première année. Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il était sur un petit nuage.
Vous n’avez pas souffert pour vous adapter ? Non, je n’ai jamais connu de période d’intégration, nulle part. Je chaussais mes crampons, j’entrais dans le stade et je marquais. Je faisais mon travail, rien de plus.
À Madrid, vous devenez une énorme star… (Il coupe) C’est à cause de ça qu’on me kidnappe en 1963 à Caracas.
Que s’est-il passé là-bas ? Le Real faisait une tournée au Venezuela. J’étais dans ma chambre d’hôtel avec Santamaria, et à six heures du matin, on reçoit un coup de téléphone. Au départ, je pensais que c’était une blague, mais quelques secondes plus tard, deux personnes frappent à la porte en se présentant comme des policiers. Ils me disent que je suis en état d’arrestation et qu’ils vont m’expliquer pourquoi au poste de police. Je me lave les dents, je me coiffe et je les suis. En entrant dans leur voiture, ils me disent : « Alfredo, tu es notre otage, nous ne sommes pas policiers. » Et là, ils me mettent un bandeau sur les yeux.
Ils vous ont maltraité ? Non, ils se sont bien comportés. Ils m’ont donné des cigarettes et des cartes, histoire de passer le temps. Mais moi, j’étais paniqué ! Un véritable cauchemar, je ne savais pas si on allait me tuer ou pas. Vraiment, ce n’était pas joli. Mes ravisseurs m’ont dit qu’ils m’avaient enlevé pour protester contre la chute du baril de pétrole, qui était descendu à cinq pesos à l’époque. Mais quel rapport avec moi et le football ? « Tu es le meilleur joueur du monde, et tu nous permets d’attirer l’attention sur notre situation ! » Ça me faisait une belle jambe…
Comment ça s’est terminé ? Ils m’ont relâché au bout du deuxième jour comme ils me l’avaient promis. Je suis sorti de leur voiture et j’ai piqué un sprint parce que j’avais peur qu’ils me tirent dans le dos. Après, j’ai pris un taxi et je suis allé à l’ambassade d’Espagne pour me réfugier… Elle était fermée. Tu le crois ça ? Finalement, à force de frapper à la porte, quelqu’un m’a ouvert. J’étais sauvé, enfin presque…
Presque ? Lors de ma conférence de presse improvisée, je commence à répondre aux questions des journalistes avec l’envie de tout raconter, et là je tourne la tête d’un côté et je vois deux de mes ravisseurs ! Ils étaient là ! (rires)
Pourquoi ne pas les avoir dénoncés ? Pour quoi faire ? J’étais déjà libre et en bonne santé. Ça n’aurait fait qu’envenimer la situation.
Lorsque vous avez remporté les cinq premières Coupes d’Europe avec Madrid, étiez-vous conscient de l’exploit que vous étiez en train de réaliser ? Non, pas du tout. On ne savait pas que la Coupe d’Europe allait prendre la dimension que nous connaissons aujourd’hui. Au début, nous étions un peu perplexes. On ne connaissait pas nos rivaux, ni les joueurs que nous devions affronter. L’organisation était un peu bizarre aussi, les terrains nous étaient inconnus… C’était un peu le bordel, mais heureusement, le Real Madrid était très bien organisé, lui.
C’est-à-dire ? On avait une défense en béton, une excellente attaque et un milieu de terrain sérieux et travailleur. On cherchait l’efficacité. Donner du spectacle, pour nous, c’était secondaire.
Quand vous avez perdu votre première finale de Coupe d’Europe contre le Benfica Lisbonne en 1962, un monde a dû s’écrouler sous vos pieds, non ? Ça a été un supplice, c’est vrai. Quelle tristesse ! Contre le Benfica, on finit le match à dix alors que nous étions en train de les dominer. À ce moment-là, on a senti que la partie était en train de nous échapper. À la fin du match, on était en larmes, presque inconsolables. Contre l’Inter en 64, c’était pareil. On avait dominé 70 minutes, mais Facchetti nous a fait très mal sur son côté. Ce qui m’enrage encore aujourd’hui, c’est la naïveté dont nous avons fait preuve. Qui aurait pensé qu’un latéral gauche comme Facchetti aurait pu nous faire aussi mal ? Il y a des fois où la confiance te rend aveugle. Nous croyions tout savoir, mais on ne savait rien.
Pourquoi dites-vous ça ? Nous avions étudié les points faibles de l’Inter, et c’est là que nous avons perdu le match. Nous aurions dû nous concentrer sur nos points forts. Dans le football, il ne faut pas jouer en fonction de l’adversaire. Il faut l’obliger à jouer de manière contreproductive pour lui faire mal.
Saviez-vous à ce moment-là qu’il s’agissait de votre dernier match avec le Real Madrid ? Non pas encore. Après le match, je suis allé voir Santiago Bernabéu pour parler de mon avenir et il m’a proposé de rester au club, pour y faire ce que je voulais. En clair, il ne voulait plus prolonger mon contrat de joueur… Moi, je voulais continuer à jouer alors je lui ai dit : « Si c’est pour faire un truc qui n’a rien à voir avec le football alors appelle ta tante, elle s’en sortira mieux que moi ! » Quelques jours plus tard, je signais à l’Espanyol Barcelone, j’avais 37 ans.
Qu’est-ce que vous aimiez le plus dans le football ? Le but ! J’étais fait pour marquer des buts et pour créer. Je n’aurais jamais pu être défenseur : je n’aime pas les chocs. J’ai toujours évité le contact.
Pour ceux qui ne vous connaissent pas, quelle définition vous donneriez d’Alfredo Di Stéfano ? Un taureau dans son enclos, et un taureau de combat dans l’enclos des autres.
C’est un poème, ça ? Ça l’est : c’est un poème de Di Stéfano (rires).
Propos recueillis par Javier Prieto-Santos en décembre 2009
L'interview de Di Stéfano a été réalisée à l'occasion de la sortie du Hors Série Légendes dont vous pouvez retrouver le sommaire ici !