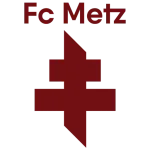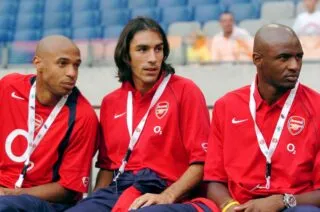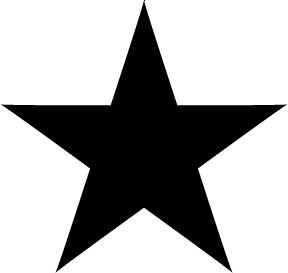- C1
- RB Leipzig-PSG & Bayern-OL
PSG Leipzig OL Bayern Platini Rummenigge

À eux deux, ils pèsent cinq Ballons d’or, deux Euros, trois Coupes d’Europe des clubs champions et une palanquée de titres nationaux. Aucune Coupe du monde en revanche, mais deux demi-finales chacun. À chaque fois l’un contre l’autre : Séville 1982 et Guadalajara 1986. Quoi de mieux donc, que de réunir Michel Platini et Karl-Heinz Rummenigge, capitaines respectifs et emblématiques des Bleus et de la Mannschaft, pour discuter du couple franco-allemand, de nuit andalouse, de l’après-guerre, de l’agression de Schumacher sur Battiston, de Mitterrand et Kohl main dans la main à Verdun, des poteaux carrés de Saint-Étienne-Bayern et de l’avenir du football européen ? Rencontre au sommet avant les demi-finales entre le PSG, Lyon, Leipzig et le Bayern Munich...
Entretien réalisé à l’automne 2018 dans le cadre du numéro 161 de SO FOOT.
L »interview va se faire en allemand…Rummenigge : Michel est l’un des rares Français qui parle l’allemand couramment. (Sourire.)
Platini : Le seul jour où j’ai été bilingue en allemand, c’est quand j’ai dit à Roth, l’arbitre allemand à Tokyo : « Du bist eine grosse Schwein. » ( « Tu es une grosse merde » , en VF. Tout ça pour lui avoir refusé le « plus beau but de sa carrière » , lors de la victoire de la Juve contre Argentinos Juniors en finale de la Coupe intercontinentale 1985, N.D.L.R.).
R : Tu as eu un carton rouge ?P : Non, un jaune.R : J’ai une anecdote avec Roth. C’était lors d’un match avec l’Inter contre les Glasgow Rangers, à la maison (seizièmes de finale de C3, saison 1984-1985). Nous devions gagner 2-0 pour passer au tour suivant. On mène 1-0, il reste dix minutes. Je marque un très beau but, un ciseau, et Roth siffle une faute pour jeu dangereux, pied haut. Bini s’avance vers lui, le prend à la gorge et lui dit : « Vous êtes idiot ou quoi? » Je le vois mettre sa main dans sa poche et essayer de sortir le carton rouge. Je lui souffle alors à l’oreille, en allemand :« Ne faites pas ça ! Vous n’allez pas sortir du stade vivant. »Il a relâché son carton. Après le match, Roth est venu dans le vestiaire pour me demander mon maillot. « Spillo » (Alessandro Altobelli) était pile derrière lui, il s’est levé et lui a mis un grand coup de pied au derrière. Roth s’est retourné et a demandé qui avait fait ça. Impossible de savoir, tout le monde s’était rassis.
Vous êtes tous les deux nés en 1955, soit dix ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans quel climat politique avez-vous grandi ?P : C’est un peu compliqué, car je m’appelle Platini. Nous ne sommes pas français, mais italiens. Ça signifie – malgré le fait que l’Italie soit au début dans un camp et à la fin dans l’autre – que je n’ai jamais vécu avec les concepts de guerre, d’Allemands. Je n’ai jamais parlé avec mes parents de ce qu’il s’est passé pendant la guerre. Je n’ai pas été élevé dans un environnement politique. Notre village de Meurthe-et-Moselle était situé à seulement deux kilomètres de la frontière, pourtant je n’ai jamais vu ou vécu de scènes liées au passé, à la guerre.R : Dans mon petit village de Lippstadt, ça n’a jamais été un sujet de discussion non plus. Les gens étaient surtout contents que les deux guerres mondiales soient terminées. Nous vivions en paix, et ce n’est donc qu’à l’âge de dix ans que j’ai réalisé ce qu’il s’était passé et que j’en ai parlé à mes parents. J’ai le sentiment que le peuple allemand se sentait un peu responsable, coupable de ce qu’il s’était passé, et était content qu’Adenauer soit de nouveau reçu en France par le général de Gaulle.
Quelle était l’atmosphère quand Français et Allemands se rencontraient sur un terrain de foot?R : Tout dépendait de là où on jouait. Je me rappelle un match à Hanovre, en 1980, sans aucune tension. Alors qu’en France, je me souviens d’un match à Paris, je sentais que c’était plus important qu’un match amical normal. Qu’il y avait une sorte de tension par rapport au passé. Vous pouviez le sentir en arrivant au stade et après le match.P : Pas sur le terrain. Pas du côté des joueurs. Quand nous jouions l’Allemagne, nous avions peur de l’équipe. Mais nous ne pensions pas à la guerre, au passé, qui était coupable, pas coupable… On s’en fichait. On jouait contre une grande équipe de foot, point barre.R : Peut-être avions-nous cette impression à cause du sentiment de culpabilité. Cette guerre n’a pas été déclenchée par votre pays, mais par le nôtre.P : Je crois pouvoir dire que nous sommes la première génération à ne pas être traumatisée par ce qu’il s’est passé lors de la guerre mondiale. Pour ceux d’avant, c’était différent.

Jeunes, y a-t-il des joueurs allemands ou français que vous adoriez ?R : En 1958, j’avais trois ans, donc je ne me rappelle pas grand-chose. Et puis, nous n’avions pas de télévision à la maison. Je me souviens juste que le meilleur buteur en Suède était Just Fontaine, mais je ne le connaissais pas. Michel a été le premier grand joueur français après la Seconde Guerre mondiale.P : J’ai aimé l’équipe d’Allemagne de 1972. Celle avec Netzer, Overath, Beckenbauer. Ils avaient un vrai style footballistique. Très différent de celui de Bonhof ou Breitner.R : C’était peut-être la première fois que l’Allemagne jouait un football habile et technique, et pas juste physique.
Vous ne vous êtes jamais rencontrés en équipes de jeunes ?P : Nous n’avons jamais joué en équipe de jeunes. Le système était différent à l’époque. Si aujourd’hui les clubs signent des contrats dès l’âge de 12-13 ans, à l’époque, on devenait professionnel à 17-18 ans.R : Jusqu’à l’âge de 18 ans, j’ai joué pour le club de ma ville. J’ai eu la chance d’être repéré par un recruteur du Bayern. Quelques années après, j’ai joué en équipe nationale. La première fois que j’ai vu Michel, ça doit être au Mondial 1978, je pense.P : Non, c’était au Parc des Princes, pour un amical, en 1977. Olivier Rouyer, mon pote de Nancy, a mis un super but contre Maier, mais personne n’a pu le voir puisque le personnel de télévision faisait grève. (Rires.)
R : Je m’en souviens, maintenant. On a perdu 1-0 ce jour-là. C’était le dernier match de Beckenbauer.P : On aurait pu se croiser bien avant, car à 17 ans, il y a un club en Allemagne qui me voulait. C’était Mönchengladbach. Ils ont fait une offre. Je n’y suis pas allé. Vous rigolez ou quoi ? C’était trop physique pour moi, l’Allemagne. Cette année-là, j’ai aussi refusé une offre du Valence CF entraîné par Di Stéfano.
Vous vous connaissiez de réputation?P : Oui, car à cette époque, tous les dimanches après-midi, sur Stade 2, on avait les images du championnat allemand. Du championnat anglais aussi. Mais pas du championnat italien. Vous savez pourquoi ? Parce qu’ils se jouaient le samedi alors que le Calcio se jouait le dimanche après-midi. Donc on avait les images du Bayern, de Rummenigge…
Et vous vous disiez quoi en le voyant ?P : Si je le rencontre en demi-finale de Coupe du monde, ça va être difficile.
Le fait de battre l’Allemagne en amical après 18 ans sans victoire, c’était symbolique ?P : On a aussi battu l’Italie chez elle, dans un match officiel, pour la première fois depuis 82 ans. Ce qui signifie que c’était le début de notre histoire. Nous sommes restés 20 ans sans Coupe du monde et sans Euro. Quand j’étais le président du comité d’organisation de la Coupe du monde 1998 avec Fernand Sastre, nous discutions chaque matin de choses et d’autres. Un jour que je l’interrogeais sur le championnat de France à son époque, il m’a expliqué que c’était très facile à organiser, qu’il pouvait jouer avec 20-22 clubs. Pourquoi ? Car au premier tour des coupes d’Europe, les clubs français se faisaient toujours éliminer. Il pouvait donc mettre des matchs de championnat quand il le voulait, le mardi, le mercredi. Le foot en France, entre 1966 et 1978, c’était un désastre. Le début du football français, c’est Saint-Étienne en 1974-1975.
Saint-Étienne et les poteaux carrés, c’est aussi le premier grand traumatisme du foot français lié à l’Allemagne. On dit chez nous que s’ils avaient été ronds, les Verts auraient gagné. Vous qui étiez sur le terrain, M. Rummenigge, vous êtes d’accord ?R : Saint-Étienne mérite de gagner ce match, oui. Si le score avait été de 2-0 à la mi-temps, cela aurait été mérité. Ils ont touché les montants plusieurs fois, et Sepp Maier a sauvé nos fesses à de nombreuses reprises. À l’époque, Saint-Étienne était dans le top 3 des meilleures équipes d’Europe. C’était très dur de les jouer. C’est une ville spéciale, un peu comme Gelsenkirchen, où les joueurs sont à l’image de leurs supporters et se battent comme des beaux diables sur le terrain. Je me souviens des frères Revelli. En 1976, tout a tourné contre eux. Au fur et à mesure, la fatigue s’est fait sentir. Et à cinq minutes de la fin (en fait à la 57e minute de jeu), on a eu ce coup franc chanceux.
P : Tiré par Franz Roth. Oui, mais tu ne peux pas faire de comparaison entre le foot allemand et le foot français. Le foot allemand a une très longue histoire, vous gagnez la Coupe du monde 1954 contre la Hongrie. Saint-Étienne est un peu comme la Hongrie, d’ailleurs. Ils parlent toujours du passé, de cette période. Quand vous allez en Hongrie, tout le monde vous parle de Puskás, des joueurs de cette époque. À Saint-Étienne, c’est pareil. Le dernier championnat remporté, c’était avec moi, en 1981. C’est une erreur de réfléchir de la sorte… Toujours est-il que depuis 1954, à chaque Coupe du monde et à chaque Euro, vous êtes là. Vous êtes demi-finalistes, finalistes, vainqueurs… La France, notre histoire commence au début des années 1980. Nous allons à la Coupe du monde en 1978 en vacanciers. Nous perdons nos deux matchs contre l’Italie et l’Argentine. L’année avant le Mondial 1982, nous n’avons pas gagné un seul match pendant un an. Au premier tour, on perd contre l’Angleterre. On gagne contre le Koweït et on fait match nul contre la Tchécoslovaquie. Vous imaginez comme nous étions fiers d’arriver en demi-finales de la Coupe du monde. Pour nous, c’était un miracle.
Cela signifie-t-il que vous ne pouviez pas vous permettre d’avoir des ennemis, car vous n’étiez pas assez forts ?P : Oui. Il n’y a jamais eu de vraies confrontations entre l’Allemagne et la France sur un terrain de foot. Vous étiez à un autre niveau. Vous savez quand j’ai ressenti que le foot français devenait bon ? Le jour où nous avons perdu la demi-finale contre l’Allemagne à Séville, en 1982. Avant, nous n’avions rien. Ce jour-là, on a su qu’on pouvait gagner la Coupe du monde.
De ce match, l’histoire retient surtout la faute de Schumacher sur Battiston à la 57e minute. En France, l’incident réveille à l’époque des pulsions et rancœurs liées à l’histoire des deux pays. Certains médias feront référence à la Seconde Guerre mondiale, allant jusqu’à comparer le gardien à un SS.
P : C’est le job des journalistes d’ajouter un contexte politique au match. Entre nous, les joueurs, non, ce n’était pas la guerre. On se connaît tous. C’était un match, vous avez gagné, nous avons perdu. Le seul problème de ce match a été le comportement bizarre de Schumacher. Le reste, ce n’est qu’un match, point. Mais le comportement de Schumacher n’a pas été bon. Pendant, après, quand Battiston était KO… Il n’est jamais venu le voir, il était arrogant. À chaque attaque de notre part, il essayait de nous mettre un coup.R : Il était bizarre, oui. Après le match, alors que nous fêtions la qualification pour la finale, je lui ai dit : « Toni, allons dans leur vestiaire pour nous excuser et savoir comment il va. »Car j’étais moi-même choqué de ce qu’il s’était passé. Notamment quand son brancard est passé devant notre banc. Il m’a répondu : « Je ne peux pas. » Il en était incapable, il était dans sa bulle ce soir-là.
Il a expliqué dans son livre Coup de sifflet qu’il était dopé à l’éphédrine et qu’il n’était donc pas lui-même.
R : Je n’ai jamais lu son livre. Mais je me rappelle que lors des matchs entre le Bayern et Cologne, j’avais souvent très peur de me retrouver en face à face avec lui. (Rires.) C’était avant tout un très bon gardien, mais il était tout le temps agressif en un contre un. Il était spécial. Ce jour-là, l’Allemagne a été très chanceuse de se qualifier pour la finale, car nous avions face à nous la meilleure équipe de France de l’histoire. Quand je regarde aujourd’hui la composition… Ils avaient une défense fantastique avec Marius Trésor. Un ours. Et le meilleur milieu de terrain au monde avec Giresse, Tigana.
P : Et Genghini.R : Le seul truc qu’il leur manquait, c’est un bon buteur.P : Nous avons surtout manqué d’un bon arbitre. Lors des deux matchs.
En parlant de buteur, vous étiez blessé, M. Rummenigge. Finalement, vous entrez à la 97e minute de la prolongation et, sur un de vos premiers ballons, vous réduisez la marque alors que la France mène 3-1.
R : Le matin du match, le coach est venu me voir. J’avais un problème musculaire à la jambe droite et il m’a demandé : « Que veux-tu faire ? Commencer ou rester sur le banc ? »Je lui ai dit : « Laisse-moi m’asseoir sur le banc d’abord. » Et je vais vous dire quelque chose que je n’ai jamais dit publiquement : juste avant la fin du temps réglementaire, j’ai demandé au masseur, Erich Deuser, de me donner de la glace, et au gardien remplaçant de me prêter son gant. Et j’ai commencé à masser le muscle endolori avec. Je me suis frotté la cuisse pendant 20 minutes. Le coach est venu me voir après le deuxième but : « Tu dois entrer. » « Je ne sais pas si c’est sage. Mais c’est à vous de voir. » J’entre, et la France marque le troisième but. Je me suis dit que ça aurait été peut-être mieux de me rasseoir immédiatement.
P : Ça aurait été mieux, oui.R : Il reste 20 minutes à jouer, on est menés 3-1. J’ai le sentiment que l’on va perdre le match. Et puis mon but, cette touche de balle de l’extérieur du pied, a tout changé. La confiance légendaire de l’équipe d’Allemagne est revenue. Tout le monde a toujours craint l’énorme volonté et l’impact physique des joueurs allemands. Dans des circonstances normales, le match aurait été perdu, mais contre l’Allemagne, tu ne savais jamais. Les Bleus ont perdu leur football. La peur a changé de camp. Je l’ai lu sur ton visage, Michel, et sur celui de tes coéquipiers… (Platini se lève pour prendre à boire.) Tu bois du Coca-Cola ?
P : Zéro.

Vous avez pris peur après la réduction du score allemande ?P : Peur, non. Mais on a reculé. Et ça, tu ne sais jamais pourquoi. Pourquoi tu joues, tu attaques, et tout à coup, l’équipe, collectivement, se met à défendre. Tu ne sais pas ce qu’il se passe dans les têtes de chacun pour que ça change. (On lui montre une photo où il gueule après l’égalisation de Fischer.) Où sont les défenseurs ? Ils sont derrière le gardien de but. Ils ne sont pas au marquage. Donc je leur disais : « Qu’est-ce que vous foutez sur la ligne ? »
R : C’est un match qu’on aurait pu perdre 5-1. Finalement, nous sommes revenus à 3-3. Et on gagne aux tirs au but, avec beaucoup de chance. Tirs au but qui étaient également perdus (après la tentative manquée de Stielike). Trois fois, la France s’ouvre la porte de la finale, et trois fois, pour je ne sais quelle raison, on revient.
Comment l’expliquez-vous ?P : N’oubliez pas que lors de cette prolongation, Derwall a pu faire entrer Rummenigge et Hrubesch, les deux meilleurs buteurs européens à l’époque. Dans le même temps, nous avions deux blessés. Genghini était sorti blessé, et Battiston était à l’hôpital. Donc on ne pouvait plus faire de changements. Et vous savez, quand l’Allemagne se met à jouer, c’est difficile de les suivre. Quand Briegel se met à courir, c’est un Iveco. Au milieu, on a Tigana, Giresse, ils font 60 kilos chacun, et en face, ils en pèsent 120. Vous voulez faire quoi ? Dans notre équipe, il n’y a que moi qui jouais à l’étranger. Les autres joueurs ne savaient pas s’ils étaient bons ou pas. Michel Hidalgo n’a pas fait les bons… On ne pouvait pas se réorganiser. J’ai dit à Janvion : « Occupe-toi de Rummenigge. » J’ai mis Lopez au marquage de Hrubesch. Mais tactiquement, nous n’étions pas si bons à cette époque. Nous étions une équipe jeune.
Vous vous souvenez qu’à l’époque, François Mitterrand et Helmut Kohl ont été obligés de faire un communiqué de presse commun pour calmer les choses ?R : Quelqu’un m’a dit qu’en me voyant entrer sur le terrain, Mitterrand aurait dit : « Oh mon Dieu, Rummeniche. » Je ne sais si c’était vrai ou pas.
P : Je me souviens surtout de la photo de Kohl et Mitterrand se tenant la main à Verdun. C’était plus important.
L’écrivain américain Paul Auster dit du foot qu’il a été inventé pour remplacer les conflits…P : C’est totalement stupide.R : Aujourd’hui plus qu’hier, les joueurs se connaissent. Ils se rencontrent en championnat, en Ligue des champions. L’interprétation de ces rencontres par le public est souvent totalement fausse. Totalement dépassée.P : Le meilleur ennemi de la France dans le sport, c’est l’Angleterre. Et vos meilleurs ennemis, ce n’est pas nous, mais les Pays-Bas, non ? Nous devons modérer nos propos.
Giresse a dit qu’il était tombé dans un trou noir après ce match. Vous aussi ?P : Non. Je ne suis pas pareil qu’Alain. Il est très sensible à ce sujet. Pour moi, c’est un jeu. On gagne, on perd. Point, fini. Oh la la… C’était un match spécial, mais c’était un match dans notre carrière. Nous en avons perdu d’autres… Une carrière, c’est la somme de toutes les parties que tu as jouées. Ce match, c’est une photographie. Tu joues pour vivre ces émotions. Ça a été un traumatisme pour des millions de Français, mais pour moi, ça a été une grande nuit.R : Quelques années plus tard, j’ai un rendez-vous à Paris. J’étais un peu en avance et je me suis baladé sur les Champs-Élysées. Des Français m’ont reconnu. Ils ne m’ont pas appelé par mon prénom. Ils m’ont dit : « Oh, 82 ! »
P : C’était ton âge ! R : L’homme qui s’occupe du juridique au Bayern, il est marié à une Française et il est allé à Marseille un été, il y a 10-15 ans. Il est revenu et m’a dit qu’il avait été surpris de constater que ce match était encore un choc en France.P : N’oubliez jamais que c’était le début de l’histoire du football français. C’est pour ça que je ne le vois pas comme un jour noir. Mais comme un beau jour pour le futur du foot français. Ce jour-là, on a su qu’on était bons. Après, nous avons été invincibles pendant quatre ans. Sans ce match, nous n’aurions pas gagné l’Euro 1984. J’ai vécu toutes les émotions d’une vie dans ce match.R : Et moi j’ai peut-être joué les meilleures 20 minutes de ma vie. Ce match est historique dans l’histoire de la Coupe du monde. En 1970, il y a eu le 4-3 entre l’Italie et l’Allemagne, et en 1982, il y a France-Allemagne. Je suis fier d’y avoir participé. Le match a commencé, il faisait 40 degrés. La nuit était très noire. La rencontre s’est terminée, il était minuit passé. Ce match avait quelque chose de spécial. Nous avons fait un beau cadeau à la Coupe du monde espagnole, car jusque-là, ce mondial n’avait pas été fantastique.
Vous dites ne pas avoir été traumatisé par ce match. Ça signifie que, contrairement à vos coéquipiers de l’époque, vous pouvez le regarder sans problème ?P : Oui.R : Les défaites sont bonnes pour l’humilité. Je vais vous dire, nous avons perdu en 2012 la finale de la Ligue des champions contre Chelsea de la manière la plus stupide qui soit. Tout était fantastique ce soir-là. La météo, le stade, l’ambiance, le public, mais nous avons perdu ce match aux tirs au but. Depuis, chaque été, quand je suis dans ma maison de vacances à Sylt, je regarde ce match. Et chaque fois, je vois de nouveaux aspects que je n’avais pas vus avant. Ça permet de calmer les nerfs. Je regarde souvent les grandes défaites que j’ai eues dans ma vie.P : Il n’a pas tant de défaites, c’est pas difficile… R : Nous avons mal joué la finale en 1982. J’étais totalement mort. Pierre Littbarski était très énervé à l’époque. Il pleurait. Et je lui ai dit : « Ne pleure pas, car nous n’avions aucune chance de gagner aujourd’hui. » Tu dois accepter d’être battu. Surtout quand l’autre équipe est meilleure.
P : Surtout que vous êtes arrivés à 5 heures du matin à l’hôtel après la demie.R : Oui, car nous avons eu beaucoup de soucis. Nous arrivons à l’aéroport de Séville à 1 heure du mat’. Problème technique sur l’avion. Nous sommes arrivés à 6 heures du matin à Madrid. Je me réveille à 9 heures à cause d’un bruit à l’extérieur. Je me dirige vers ma fenêtre et je vois en contrebas, à l’entrée de l’hôtel, Toni Schumacher en train de donner une conférence de presse. J’écoutais et je me disais : « Oh Toni, ne donne pas cette interview. »
P : C’était difficile de dormir pour lui.
En 1986, à Guadalajara, France et Allemagne se retrouvent encore en demi-finales. Durant le match, il y a une situation de jeu où Schumacher capte la balle et vous montrez que vous voulez le frapper. Il se passe quoi dans votre tête à ce moment-là ?P : C’était stupide. Ce n’est pas parce que Schumacher est stupide que je dois l’être. Ce n’était pas prémédité, non. C’était de la frustration. Le sentiment que tu vas perdre le match. Quand on joue contre l’Allemagne, en 1982 comme en 1986, on sent qu’on ne va jamais gagner. On joue bien, mais tout est contre toi. Après 15 ans de foot et des matchs tous les trois jours, tu sens une partie. (Il hume l’air.)Tu sais que contre l’Allemagne, tu peux faire ce que tu veux, tu peux être bon, la balle va rouler vers les Allemands. Comme tu sens contre le Brésil en quarts de finale que, quoi qu’il se passe, tu vas gagner à l’arrivée. En 1982, la partie était équilibrée. Nous n’étions pas meilleurs que l’Allemagne. Le meilleur joueur chez nous, c’était notre gardien, Ettori, ce qui veut bien dire que c’était serré. Mais en 1986, nous méritions de gagner. Car nous étions meilleurs. Nous étions la meilleure équipe au monde. Et nous avons perdu. Le problème, c’est que pour gagner, nous devions toujours être bons. Alors que l’Allemagne, pour gagner, elle n’en a pas besoin. C’était le problème de notre génération : toujours bien jouer pour pouvoir gagner. Vous, c’est comme les Italiens.
En 1986, Beckenbauer a déclaré : « Cette équipe ne sait pas comment battre l’Allemagne. » Vous êtes d’accord ?
P : Tu changes l’arbitre, tu bats l’Allemagne. Point. C’est toujours comme ça. Quand tu perds, c’est de la faute de l’arbitre. Je pense comme tout le monde. (Rires.) En 1982, si l’arbitre met un carton rouge à Schumacher et siffle penalty, on n’est pas là à parler du 3-3. Le match est fini. En 1986, je mets un but, j’égalise, mais l’arbitre assistant, un Autrichien, un cousin à vous, siffle hors-jeu. Je n’étais pas hors jeu. Et l’arbitre central, Agnolin, il n’était pas en faveur de la France. Les Italiens n’aiment pas voir la France gagner. (Rires.)
R : En 1986, Franz était marrant. J’étais le capitaine, et il venait chaque après-midi de match dans ma chambre. Avant le quart de finale contre le Mexique, il me dit : « Si on sort, pas de problème. Quart de finale avec notre équipe, c’est déjà super. » Un match horrible. 0-0, tirs au but, et on se qualifie. Avant la demie, il me dit : « Normalement, demain, on n’a aucune chance. Mais d’être allés en demies avec cette équipe, c’est déjà super. Personne ne pourra se plaindre. » On gagne 2-0. L’après-midi avant la finale, il ne passe pas dans ma chambre. Ça a été son erreur. Car il pensait que si nous avions battu la France, nous pouvions battre l’Argentine, bien sûr.
P :Quand vous jouez un match de Coupe du monde à élimination directe, vous devez avoir beaucoup de paramètres en votre faveur pour que la balle aille dans votre sens, de votre côté. Et il n’y a qu’un match tous les quatre ans.
Gardez-vous une certaine amertume de cette revanche perdue ? De ce rendez-vous manqué avec l’histoire ?P : Vous pouvez dire que c’est l’Allemagne, la guerre… Mais Kalle, as-tu senti sur le terrain que nous voulions prendre notre revanche, que nous étions nerveux, qu’on voulait vous piquer ? Non ! Le public, c’est différent. Quatre ans s’étaient écoulés, on avait joué d’autres matchs, le foot français était devenu très bon, et on a joué et perdu. Point barre.
Finalement, l’Allemagne est votre bête noire. Vous perdez deux demies de Coupe du monde et une finale de C1 contre Hambourg à Athènes.P : Mais je gagne deux ans après contre Liverpool. Tu perds contre les grandes équipes.R : Peut-être que l’Allemagne était ta destinée.P : Les politiciens allemands m’ont fait plus de mal que les footballeurs allemands. (Rires.) Car ce sont eux qui m’ont exclu du football. Je ne vois pas l’équipe d’Allemagne comme une destinée, mais comme une grande équipe, avec un football contre lequel il nous était difficile de jouer. Je ne pense pas en matière de destin. On peut aussi se dire qu’on a gagné 5-0 contre le HSV à Hambourg. Ce n’était pas une finale certes, mais un huitième de finale.
Au regard du mondial en Russie, diriez-vous que l’équipe de France est devenue l’Allemagne et que la Belgique d’aujourd’hui est la France des années 1980. C’est-à-dire un vainqueur moche et un perdant magnifique ?P : Je ne pense pas.R : Il n’y a pas de vainqueurs moches. Tu mérites de gagner.P : La France de Deschamps était plus complète que la Belgique.R : Bien sûr, la Belgique était forte, mais la France était meilleure. Si vous comparez joueur par joueur, la France a ce truc en plus. Je l’ai toujours dit, ce sont ces 5 % qui, à la fin, font la différence.
Il vous manque, Michel Platini, en tant que président de l’UEFA ?R : On a eu une bonne relation sur le terrain, mais aussi en dehors. Quand on a dû prendre des décisions…P : … on a fait ce qu’on avait à faire.R : On l’a toujours fait en ayant en tête le bien du foot.P : Quand j’étais président, nos relations étaient toujours bonnes pour une raison : nous sommes des joueurs de foot. Nous avons grandi dans la rue, à jouer au foot. Nous savons ce qui est dans l’intérêt du jeu. C’est ce que j’ai tout de suite ressenti avec Kalle. Ce qui est bon pour nous est bon pour le foot. Et inversement. Le business est là, car le football est beau.R : Si tu penses d’abord business et ensuite foot, tu as tout faux. Dans un certain sens, aujourd’hui, dans différents comités d’organisation, ils inventent des compétitions parce qu’ils ont besoin d’argent… Ce n’est pas la bonne direction à prendre.P : Quand j’étais président, le football allait dans la bonne direction. Aujourd’hui, je ne sais pas.
C’est-à-dire ?R : Regardez le championnat d’Europe de football. Quand l’Allemagne a gagné l’Euro en 1972, il y avait quatre participants. En 1980, à Rome, il y en avait huit. Ensuite 16, maintenant 32. Il y a 55 pays membres de l’UEFA. Peut-être que quelqu’un voudra bientôt que tout le monde participe.P : N’oubliez pas que le président de l’UEFA est élu par les présidents des États membres… Et une Coupe du monde à 48, politiquement, c’est judicieux. Grâce à ça, il est réélu…R : Le problème du foot, c’est que c’est une course de rats. Tout le monde est demandeur d’argent. À un moment donné, quand tu t’assois autour d’une table, tu te rends compte que l’argent va de droite à gauche. Et à gauche, il y a les joueurs et les agents. C’est tout. C’est pour cela qu’il faut se demander ce qu’on peut faire. Mais tu ne peux pas stopper le système. C’est celui du monde industrialisé, de la globalisation.P : Le fait est que les clubs ont besoin de toujours plus d’argent. Le Bayern a besoin de plus d’argent, car s’ils en ont plus que le Real Madrid ou que la Juventus, ils auront les meilleurs joueurs. Ceux qui te font gagner. C’est le problème central du football. Tout ça à cause de l’arrêt Bosman. L’arrêt Bosman dit quoi ? Il dit qu’un joueur, à la fin de son contrat, est libre. À l’arrivée, ça a débouché sur la libre circulation des joueurs en Europe. Chaque gros club peut acheter n’importe qui. Tu peux avoir les onze meilleurs joueurs dans un club. Donc tu sais qui va gagner. Quand j’étais président de l’UEFA, mon combat a toujours été de dire : « Je dois donner la possibilité à tous les clubs de gagner la Ligue des champions. » Autrement, pourquoi tu vas voir un match où tu sais qui va gagner ?
R : Les politiques à Bruxelles ont fait beaucoup de mal au football. Avant que Michel n’instaure le fair-play financier, nous sommes beaucoup allés à Bruxelles pour défendre un plafonnement des salaires. Mais la Cour de justice des Communautés européennes n’en a jamais voulu, a toujours trouvé des lois contre, n’a jamais voulu comprendre que l’arrêt Bosman a changé le foot de manière dramatique et fait que les joueurs sont payés de manière irrationnelle.

Pourtant, dans le même temps, vous plaidez pour la création d’une Superligue réunissant les plus grands clubs européens.R : Faux. Je n’en ai jamais voulu. C’est une initiative défendue par les clubs d’Europe du Sud. Il y a tellement d’argent sur la table qu’ils étaient motivés pour que ça se fasse. Il y a deux ans, nous avons eu une réunion à Barcelone pour parler de ce projet. À un moment donné, j’ai pris la parole : « Gentlemen, pensez-vous vraiment que le monde du foot attend avec impatience une Superligue ? » Tout le monde m’a regardé circonspect, les yeux écarquillés. Mon estomac et mon cerveau disaient : « Je ne sais pas. » Je ne suis plus responsable de l’ECA (Association européenne des clubs, anciennement G14), et j’en suis content. Car autant cela était possible de stopper ce projet il y a deux ans, autant aujourd’hui, j’ai malheureusement le sentiment que cette Superligue va advenir. Je ne sais pas quand. Peut-être en 2025. Cette Superligue va endommager tous les championnats nationaux. La Bundesliga, la Liga, la L1, la Premier League, la Serie A vont du jour au lendemain devenir des D2. Les clubs sont de plus en plus gros et de plus en plus puissants. Ils sont bien mieux managés qu’il y a dix ans. C’est un fait. Et souvent, dans le passé, il y a eu des débats autour de cette question : « A-t-on besoin de l’UEFA ? De la FIFA ? On peut l’organiser nous-mêmes. » Probablement, mais alors, tu pénalises la famille du foot. Auparavant, c’était différent, nous nous demandions toujours comment ne pas la détruire.
Que dit votre estomac à propos de la Superligue, M. Platini ?P : Il dit qu’il a faim. (Rires.)
R : Nous avons une bonne cantine ici, tu sais.P : Ça va advenir. Quelque chose va advenir. Je ne crois pas que ce sera sous la forme d’une Superligue privée. C’est interdit par les lois européennes. Il doit y avoir un système de montée/descente. Plutôt sous la forme d’une organisation européenne du football. Je ne sais pas si l’UEFA et la FIFA vont encore exister dans quelques années, mais l’un des deux, ou une autre entité, va organiser cette nouvelle compétition. Car regardez les classements des championnats après un mois. Italie : Juventus. Allemagne : Bayern. Espagne : Real Madrid et Barcelone. Angleterre : Chelsea et Liverpool. France : Paris. Ça veut dire qu’après cinq journées, devant, tu as déjà les meilleures équipes de l’année dernière, et de l’année d’avant et des cinq dernières années. Les supporters ne comprennent pas pourquoi il y a tant de différences entre les clubs. Ils veulent quelque chose d’autre. Pourquoi la Ligue des champions est si populaire ? Parce que les meilleures équipes s’affrontent. Ça va poser problème dans le futur.
Quand vous vous regardez aujourd’hui, vous arrivez à voir le joueur qu’il était dans la personne assise à côté de vous ? Dans la manière dont il se comporte, répond aux questions ?P : Avec Kalle, nous avons pris deux chemins différents. Quand j’ai arrêté d’être sélectionneur, je n’ai pas voulu aller dans un club. J’ai voulu profiter, aller pêcher, jouer au foot avec mes potes, et puis j’ai choisi de me lancer dans la politique. Un monde où tu n’as pas de match le samedi et le dimanche. Rien. Kalle a une grande chance : que le Bayern soit dirigé par des footballeurs. De Beckenbauer à Hoeness, vous avez une histoire. C’est beau. On n’a pas ça en France ou ailleurs, dans les autres grands clubs. C’est très politique.R : Je vais aller au stade ce soir et vivre le match. Être heureux ou malheureux en fonction du résultat. Ou de la manière dont on a joué. Il y a quelques années, quand Guardiola était coach, nous avons réalisé un super match à Kaiserslautern. On aurait pu gagner 7-1 ou 8-1, mais on a fait match nul. Tous les joueurs étaient énervés. Pep est entré dans le vestiaire et a demandé à tout le monde de s’asseoir et de se taire. « Je voudrais vous féliciter. C’était de loin le meilleur match que j’ai dirigé depuis cinq ans. Et j’ai gagné la Ligue des champions avec Barcelone entre-temps. Je vous le dis aujourd’hui, les quinze prochains matchs, on va les gagner. » Et on a gagné les quinze matchs suivants. Dans l’avion du retour, j’étais assis à côté de lui. Je l’ai félicité pour son discours, et il m’a dit : « Bien sûr, on aurait dû gagner aujourd’hui. Mais à la fin, sur la durée, la qualité du jeu te fait gagner les matchs. »
P : C’est une histoire sans fin, le foot. C’est le sport le plus irrationnel au monde. Tu peux être le meilleur et perdre. Nous étions meilleurs et nous avons perdu. Pourquoi ? On ne sait pas. Seuls les journalistes savent. Nous non.
Propos recueillis par Tim Jürgens (11Freunde) et Maxime Marchon (So Foot)