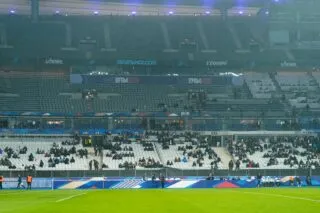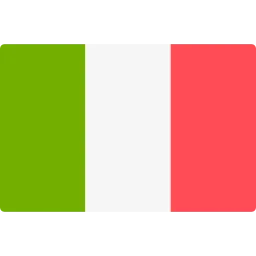- Coupe des confédérations
- Finale
- Brésil/Espagne
Pourquoi le Brésil n’a pas le droit de perdre

Au pays des quintuples champions du monde, la hantise de la défaite est plus forte que nulle part ailleurs. Une défaite face aux champions du monde espagnols ferait vaciller les bonnes bases jetées par Scolari.
L’Europe romantique vénère encore et toujours les Seleções de 82 et 86, modèles de beau jeu emmenées par le duo d’artistes Sócrates et Zico. Si les deux hommes ont laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du « futebol » , aucun n’arrive néanmoins à la cheville de Pelé, triple champion du monde (58, 62 et 70) et allégorie ultime du triomphe national. « Le Brésil a joué « bonito » au Mondial 82 et nous n’avons pas gagné. L’Espagne joue bien et gagne. Nous aussi en 2002. Mais ma philosophie, c’est que le « jogo bonito » passe. Ce qui reste, ce sont les résultats » , a clamé Luiz Felipe Scolari en conférence de presse, hier. Comment oublier l’accueil exécrable fait aux finalistes de 98 à leur retour au bercail ? Huit ans plus tard, l’Allemagne – et son palmarès en or massif (trois Coupes du monde, trois Euros) – avait célébré dans la liesse populaire sa troisième place dans « sa » Coupe du monde. La tragédie nationale du Mondial 1950 est l’exemple le plus frappant de l’inébranlable confiance accordée par les Brésiliens à leur sélection. Des dizaines de milliers de journaux titrant « Campeões do Mundo ! » étaient ainsi sortis des rotatives quelques heures avant le Maracanãzo. Après avoir tout gagné sous le maillot auriverde (Coupe du monde 2002, deux Copa América, Coupe des confédérations 1997), Roberto Carlos a fait les frais de cet extrémisme en 2006. Le sprinteur chauve devient persona non grata, après sa faute de marquage sur Henry en quart de finale de la Coupe du monde.
Les perdants au pilori
Omniprésent dans la société brésilienne, parfois étouffant, le football canalise et déchaîne les passions. Impossible de traverser une rue de Rio de Janeiro sans apercevoir d’immenses panneaux publicitaires mettant en scène Neymar et consorts, de longer les plages de Copacabana ou d’Ipanema sans observer des gamins en train de tâter le cuir sur le sable ou encore de se poser dans un botequim sans tomber sur un téléviseur diffusant un match ou un énième débat de spécialistes décortiquant la dernière sortie de la Seleção. Dans son investigation intitulée Contradictions du football brésilien, le professeur Jocimar Daolio constate que ce dernier serait « à la fois le modèle de la société brésilienne et un exemple dans lequel celle-ci se représente » . L’idéal et son expression. Il suffit de voir comment Neymar est devenu ces deux dernières années un produit marketing et l’étendard d’une nation qui l’a longtemps retenu au pays avant son transfert pour Barcelone, à l’instar de Pelé, déclaré « trésor national » par le gouvernement militaire et interdit d’exil dans les années 60.
L’enfer de Scolari
Ajoutez à cette aliénation le caractère d’hôte du tournoi et vous obtenez une pression maximale. De quoi flanquer une sacrée trouille aux joueurs. Face à l’Uruguay, on a vu un Thiago Silva fébrile, à l’instar de ses acolytes David Luiz et Marcelo ; des footballeurs qui commencent pourtant à être familiers des joutes internationales depuis plusieurs saisons, au sein de grands clubs. Le coach moustachu Scolari aurait même préféré jouer le Mondial sur la lune, si on lui avait demandé son avis : « C’est un enfer (de disputer ce tournoi à domicile, ndlr). Au Mondial 2002, c’était plus facile, car nous étions loin d’ici. Le principal problème pour cette équipe est que ce Mondial se joue au Brésil. » Daniel Alves voit l’affaire d’un autre œil. « Nous sommes dans notre maison, nous devons nous imposer et montrer qu’ici c’est le Brésil » , note le latéral droit, en référence à cette finale de Coupe des confédérations face aux Espagnols. L’expérimenté Carlos Alberto Pareira verse, lui, carrément dans l’excès de confiance. « Il est l’heure (pour l’Espagne de perdre, ndlr) et c’est ce qui va arriver. La Seleção traverse un moment sensationnel, elle a trouvé une identité et un style de jeu. » Pas sûr que Scolari s’attendait à ce sale coup de la part de son collaborateur. Ce n’est pourtant pas un hasard si les deux hommes ont été associés pour conduire le destin de l’équipe nationale à la Coupe du monde : ils sont les deux derniers à avoir rapporté le trophée au pays. « Si on gagne demain (aujourd’hui), on va envoyer un message au monde, mais aussi au supporter brésilien, qui doit croire en nous » , conclut un Felipão un brin masochiste. Et un poil hystérique.
Par Florent Torchut, à Rio de Janeiro