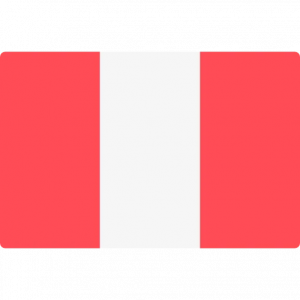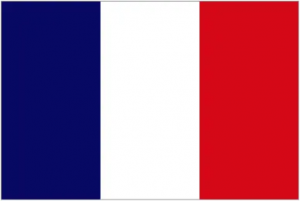- Mondial 2018
- Qualifs
- Argentine-Pérou
Pourquoi j’aime le football, par Diego Trelles Paz

À l'occasion de la sortie du numéro 150 de So Foot, dédié à l'amour du football, l'écrivain péruvien Diego Trelles Paz a pris la plume pour déclarer sa flamme au ballon rond. Et au Pérou.
Délire
Nous, nous avons appris à jouer au football sur la route, dans cet espace long et étroit où les voitures roulaient lentement avant que la circulation n’anéantisse la ville de Lima. Nos matchs étaient des batailles épiques. Nous n’étions pas pauvres, mais nous y jouions comme tels parce que dans le quartier, il n’y avait ni terrains ni parcs, et le football était si intense que personne ne semblait s’étonner du fait que, de temps en temps, il faille esquiver une voiture ou deux pour marquer un but. Les poteaux étaient souvent deux pierres équidistantes dont la longueur se mesurait en comptant nos pas, au rythme nerveux d’un équilibriste. Le but n’était valable que s’il entrait en touchant le sol. Pour gagner, il fallait marquer dix fois et avec deux buts d’écart. Impossible de faire match nul. Le football n’était pas un exercice sain ni solidaire. Il était passionné, insensé comme un délire, et procurait une douce addiction.
Traumatisme
Même si j’ai su très jeune que je serais écrivain, il y a toujours eu dans mes souvenirs d’enfance plus de ballons que de livres. À cette époque, je n’avais conscience de rien, j’agissais sur des coups de tête et cela me rendait heureux. Je n’ai jamais été un grand joueur. Il était clair que ma relation au football serait celle du supporter qui souffre. Après 1982, souffrir pour le football au Pérou devint un sport à part entière. Ce fut notre dernière qualification pour une Coupe du monde. Moi, j’avais six ans et la seule chose dont je me souvienne, c’est qu’après la victoire écrasante infligée par la Pologne, je m’étais mis à pleurer. J’ai aussi pleuré le jour où le Chili nous a battus à Santiago lors des éliminatoires de la Coupe du monde de 1998 en France. Il suffisait d’un match nul, et nous avons perdu 4-0. J’étais à deux doigts de casser le téléviseur de colère quand l’attaquant Marcelo Salas mit le dernier but et eut la lâcheté de fêter cela en se moquant de nos joueurs. Depuis, Salas est l’emblème du football hautain et mauvais esprit que je déteste et que je rejette, presque par traumatisme.
Cœur
Jorge Luis Borges détestait le football. Il préférait l’élégance des échecs au jeu populaire « des insensés » , « parce que la stupidité est populaire » . Pier Paolo Pasolini, grand joueur de football, pensait différemment. Pour lui, le football était un langage avec ses prosateurs et ses poètes où le but, comme le mot poésie, « est toujours une invention, un trouble des codes(…)une fulguration, stupeur, irréversibilité » et, de fait, « le meilleur buteur d’un championnat est toujours le meilleur poète de l’année » . Au-delà de leur véracité, il me semble intéressant d’opposer les citations de Borges et de Pasolini, — des écrivains que j’admire pour diverses raisons — pour ce qu’elles suggèrent et évoquent en moi. La première fois que j’ai entendu le mot « poète » associé au monde plutôt prosaïque du football, ce fut à travers César Cueto, le milieu de terrain magistral de la sélection péruvienne qui brilla dans les Coupes du monde d’Argentine en 1978 et d’Espagne en 1982, et qu’on connaît encore comme le « poète du pied gauche » . Cueto fut l’auteur de cette passe grâce à laquelle Juan Carlos Oblitas frappa les cages françaises le 28 avril 1982 lors d’un match amical qui, étonnamment, au sein même du Parc des Princes et avec Michel Platini sur le terrain, fut remporté par le Pérou.
Il est fort probable que ce souvenir, encore aujourd’hui élevé au rang de prouesse et remémoré par le citoyen péruvien pour se consoler de l’échec de 36 ans sans Coupe du monde, ne soit qu’une statistique oubliée du Français moyen. Sur le terrain de la logique, Borges avait raison, sans doute, de dénoncer ce non-sens. Le grand problème de cette rationalité froide, c’est qu’il reste Cueto et qu’avec lui demeure cette langue non verbale et poétique appelée football, dont il est impossible, selon Pasolini, de nier la beauté et l’émotivité.
J’aime le football pour cette contradiction qui, depuis l’enfance, est toujours parvenue à m’émouvoir.
La raison ne sert pas à comprendre ce qui a été fait pour se ranger du côté du cœur.
Par Diego Trelles Paz / Traduction : Mélanie Gros-Balthazard