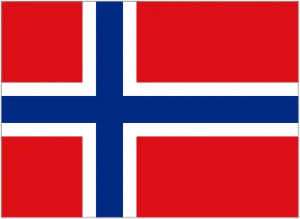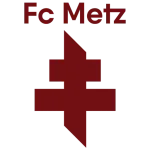- Liga
- J25
- Barcelone/Almeria
«Personne ne rêve de devenir entraîneur»

Juan Manuel Lillo est un peu le Cesar Luis Menotti de la Liga. Le genre de type qui serait capable de vous parler foot pendant des heures sans se fatiguer. Amoureux de France 86 et nostalgique d'une époque où le football n'était encore qu'un jeu, le Basque l'avoue lui-même : "Je n'aime pas le métier d'entraineur, mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour côtoyer les joueurs". L'un deux s'appelait Guardiola. Devenus amis et frères de sang au Dorados mexicain, les entraineurs d'Almeria et du Barça s'affrontent pour la première fois sur un banc de touche. Analyse de l'actualité du foot espagnol et même un peu plus, avec un passionné. Un vrai.
Comment vous êtes-vous retrouvé sur le banc d’Almeria ?
J’avais des contacts avec d’autres clubs, mais Almeria était celui qui me voulait le plus. J’aurais pu venir avant, mais Hugo Sanchez était encore “dans la maison”. J’ai dit aux dirigeants que je n’étais pas un vautour et que je ne trouvais pas ça très respectueux vis-à vis de lui. Quand les dirigeants ont finalement limogé Sanchez, nous avons repris les conversations et les discours du président et du directeur sportif m’ont plu tout de suite. J’ai aimé le fait qu’ils ne me prennent pas pour un bouche-trou… C’est moi qu’ils voulaient, personne d’autre. Je me suis très vite senti à l’aise et me voilà !
Un tel changement en milieu de saison est-il plus difficile pour un entraîneur ou pour les joueurs ?
Je pense que c’est difficile pour les deux. Au début, le changement fait peur aux joueurs, tandis que l’entraîneur a une certaine appréhension, mais c’est tout à fait normal.
Justement, comment avez-vous géré cette appréhension face à vos nouveaux joueurs ?
Un entraîneur peut affronter un nouveau groupe de deux façons : continuer le travail de l’ancien entraîneur ou tout reconstruire depuis zéro. Mon intention première, ce n’était pas de construire une œuvre mais de faire partie de l’œuvre déjà en place. Je ne me voyais pas arriver et casser des automatismes et des affinités déjà en place, ça aurait été prétentieux de ma part. Le changement ne doit jamais être brusque et totalitaire. Moi ce que je voulais, c’était insuffler de la confiance aux joueurs afin qu’ils s’expriment le mieux possible et qu’ils m’acceptent comme on accepte de se confier à quelqu’un. Quand tu prends une équipe en pleine saison, tu n’as pas le temps de tout reconstruire. Par contre, tu peux amener les gars vers le chemin du progrès en douceur. Lentement mais sûrement. Et ce chemin-là commence par l’héritage laissé par mon prédécesseur.
Oui, mais chaque entraîneur a une philosophie qui lui est propre. Quelque part, vous ne sentez pas une frustration de ne pas pouvoir l’appliquer comme vous le voulez ?
Ma philosophie, c’est d’optimiser… pardon d’essayer d’optimiser le rendement de mes joueurs. Mes joueurs sont ce qu’ils sont. Ils ne peuvent pas être ce qu’ils ne sont pas. Le plus important dans le football, ce sont les joueurs. Les états d’âme d’un entraîneur, c’est secondaire.
Selon vous ça ne sert à rien un entraîneur alors ?
Je ne dis pas que je ne sers à rien. Je dis juste que je suis beaucoup moins important que les joueurs.
Vous servez à quoi alors ?
Je sers à faire passer un message. Un entraîneur, c’est un majordome au service des joueurs. Ceux qui pensent le contraire ont tout faux. Tu as déjà vu un entraîneur entrer sur le terrain pour marquer un but ? Moi non ! Je n’ai pas la prétention de faire mieux que mes joueurs sur un terrain. Il faut garder le footballeur sur un piédestal pour qu’il donne tout ce qu’il a. Je peux aider, lui donner des consignes, le motiver mais je ne peux pas jouer à sa place. Au final, ceux qui décident, ce sont eux. Pas les entraîneurs.
En France, les équipes modestes comme Almeria sont complètement écrasées par la médiatisation du Real ou du Barça. Comment définissez-vous Almeria ?
C’est une entité qui a connu beaucoup de soubresauts. Le club a disparu plusieurs fois et aujourd’hui, il tente de se construire sa petite histoire. Almeria, à coté du Barça et du Real Madrid, c’est un club tout petit. Il manque une histoire, une tradition. C’est une limite très importante. Dans le football, quoi qu’on en dise, l’histoire compte beaucoup. J’ai voulu aider Almeria car c’est une équipe qui n’avait plus connu un statut de reléguable depuis sa montée il y a quelques années. Les joueurs ont du potentiel, je le sens. Je le sais. Et puis surtout, c’est un club qui est sain, dans tous les sens du terme. C’est d’ailleurs ce qui m’a le plus plu.
Vous avez entraîné l’un des clubs historiques de la Liga, la Real Sociedad. Qu’est-ce qui est le plus stimulant pour vous : créer l’identité d’un club comme Almeria ou pérenniser celle d’un club comme la Real ?
Les deux options sont extrêmement intéressantes… (il coupe) Tu sais je suis né à San Sebastian. J’ai été élevé avec la Real Sociedad. Mon identité d’homme, de joueur et d’entraîneur s’est construite à travers la Real Sociedad. Je veux dire par là qu’un club avec des racines et une identité aussi profondes et marquées, c’est quelque chose que tu ne peux pas retrouver partout. Avant de descendre en deuxième division, la Real avait passé 41 ans en Liga. Seuls le Real, le Barça et l’Atheltic Bilbao ont fait mieux. J’aime la Real d’amour, donc ce n’est pas comparable avec Almeria. Ici, l’histoire est encore à écrire, mais malheureusement, il faut du temps pour ça.
Pourquoi malheureusement ?
Parce que nous vivons dans une dictature du résultat. Dans les entreprises, ce sont les bénéfices qui comptent. Dans le football, si tu n’as pas de points, tu es mort. C’est la règle du jeu. Le football est devenu un sport d’urgence. C’est regrettable, mais je ne perds pas espoir : si je peux contribuer à ce que l’histoire d’Almeria s’étoffe, ce sera déjà une grande victoire.
Depuis votre arrivée, le club a pourtant remonté la pente (Almeria reste sur deux victoires consécutives en Liga, ndlr)…
C’est vrai qu’on a réalisé des bons matchs. Mais nous n’avons pas eu les points que nous méritions. Par rapport à ce que nous avons montré sur le terrain, la récompense a été moyenne.
Vous avez perdu une seule fois, contre Séville, le bilan est donc positif non ?
C’est clair. Même si on a gagné à 10 contre le Sporting, notre match référence, c’est celui de Séville. C’est bizarre de prendre une défaite comme point de repère dans une saison, mais s’il n’y avait pas eu une flaque d’eau favorable aux Sévillans, on aurait fait une bonne opération comptable.
Vous arrivez quand même à prendre du plaisir dans votre rôle d’entraîneur malgré la dictature du résultat ?
Tu sais j’ai arrêté de jouer au football à 16 ans. Je me suis rapidement rendu compte que je ne pourrais pas en faire mon métier. J’ai l’honnêteté d’avouer que je n’étais pas particulièrement doué. En tout cas pas autant que je l’aurais voulu. J’ai donc choisi d’être entraîneur pour côtoyer les joueurs et continuer à vivre ma passion pour le football. Ceux qui disent qu’ils rêvaient d’être entraîneur mentent ou alors il faut les mettre dans le frigo pour leur rafraîchir les idées. Personne ne rêve d’être entraîneur. Le rêve ultime de tous les gamins du monde, c’est devenir footballeur. Pas entraîneur.
Et alors, vous prenez du plaisir aujourd’hui ?
Des fois oui, mais pas tous les jours. Tu sais ce que je vais faire dans 20 minutes ?
Non.
Je vais aller jouer au futsal. J’ai passé toute la journée à diriger des entraînements, mais jouer au futsal avec des amis, ça va être mon premier gros plaisir de la journée. Le football, pour l’apprécier, il faut y jouer. Le reste, ça n’est que de la frustration et du désir non assouvi : vouloir entrer sur un terrain, tout en sachant qu’on ne pourra jamais être à la hauteur d’un professionnel. C’est pour ça que les joueurs font rêver. C’est aussi pour ça qu’on les envie.
En Espagne vous êtes l’un des rares à théoriser le phénomène football, alors que dans des pays comme l’Italie, par exemple, c’est quelque chose d’assez naturel. Comment l’expliquez-vous ?
La situation économique de l’Espagne est tellement alarmante qu’on ne s’arrête plus pour réfléchir. Les gens cherchent du concret. Dans les temps difficiles, la priorité c’est la survie. Dans le football, c’est un peu pareil. Les résultats ont pris le pas sur la philosophie de jeu ou la façon de concevoir ce sport. Tu sais, l’homme-footballeur que j’ai connu à mes débuts n’existe plus. Aujourd’hui, tout le monde raconte des banalités. La langue de bois, c’est le prolongement d’une paresse intellectuelle. Les joueurs d’aujourd’hui sont comme oppressés par ce qui se passe en dehors du football. Les problèmes de la société, ça les dépasse complètement. On leur a appris à taper dans un ballon, mais personne ne les a jamais poussés à mener une réflexion propre. C’est triste. Moi on me dit souvent que je suis un philosophe et un poète du football. Je ne prétends pas l’être. Je suis comme je suis. Mais ce qui m’inquiète le plus, c’est la connotation négative qui accompagne ces termes. C’est comme si quelqu’un qui réfléchissait un peu était dangereux pour les autres. La langue de bois, c’est l’arme de ceux qui ne veulent pas envahir des nouveaux champs de réflexion. En Espagne, les gens ont presque peur de réfléchir. Paradoxalement, les fous, ce ne sont pas ceux qui ont une réflexion, mais plutôt ceux qui ne pensent à rien non ?
Comment expliquez-vous cette faillite ?
Toute la journée je vois des personnes qui me disent « Je suis la mère de… » , « Je suis le frère de… » , « Je suis le cousin de… » . Et de l’autre côté, je vois des joueurs qui sont esclaves des regards extérieurs. Ils vivent pour leurs familles, pour le public, pour leur agent, et dans le meilleur des cas, pour leurs clubs respectifs, mais ils ne vivent pas pour eux. C’est comme si l’humain qui était en eux n’existait plus. Les gens qui leur tournent autour ne voient plus que la condition de footballeur qui leur permet d’exister dans la société. Entre cette image et leur statut de footballeur, il y a une sorte de vide qui n’est pas comblé. Le football leur a donné un statut et de l’argent mais a oublié de les former en tant qu’hommes. Aujourd’hui, je suis terrifié, car la plupart du temps, les mecs que j’ai en face de moi ne sont même pas heureux. Et ça c’est terrible.
C’est tragique même…
Pour eux, être remplaçants, c’est ne pas exister. Ils vivent par le jeu. C’est le seul moyen qu’ils ont pour se respecter eux-mêmes. Ce que j’aimerais, c’est qu’ils se détachent un peu de ce carcan qui les étouffe, mais sans formation, c’est très dur.
Deuxième partie de cet entretien, dès demain sur www.sofoot.com…
Par