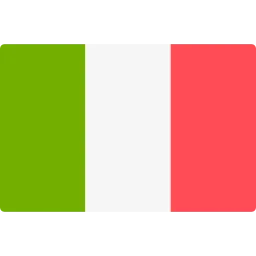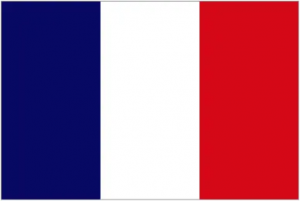- France
- Médias
Paul Tchoukriel : « Je ne suis pas un footballeur raté »

À 30 ans, Paul Tchoukriel est devenu la voix du foot de Canal+, succédant cette année à Stéphane Guy au poste de commentateur numéro 1 de la chaîne cryptée. L'occasion de revoir au ralenti ses premières sensations européennes, la définition de son métier, ses une-deux avec Rudi Garcia, mais aussi un parcours plutôt atypique. Et pour cause, ce milieu de terrain formé à l'OL jouait il y a encore dix ans avec la réserve de l'AS Nancy Lorraine.
La semaine passée à Lille et Bruges, tu commentais tes premiers matchs de poule de Ligue des champions. Ça fait quoi d’entendre la fameuse petite musique ?Elle est forte, déjà. Bien plus forte au stade qu’à la télé. Mais c’est vrai que ça fait quelque chose. Bon, quand elle retentit, ça fait déjà deux heures qu’on est en branle-bas de combat avec tout l’avant-match. Cette musique marque en fait le moment où il y aura le moins d’incertitudes pour nous : commenter un match est ce a à quoi on est habitué. C’est tout le décorum autour qui diffère, un soir de Ligue des champions. Ce qui était marquant à Bruges, par exemple, c’était la première titularisation de Messi avec le PSG. On attendait de savoir comment il allait être accueilli au moment des échauffements, comment il allait se comporter, etc.
Ce genre de contexte te conditionne-t-il par rapport à des affiches plus traditionnelles ?Il y a forcément plein de souvenirs qui remontent. Quand on était petits, les seules fois où on avait le droit de manger devant la télé, c’était quand il y avait Ligue des champions sur Canal+. Ça me renvoie à Thierry Gilardi et Michel Platini aux commentaires, c’est Aimé Jacquet qui parlait tout le temps de « percussion », les gars autour avec les casques qui font les premiers résumés à la mi-temps. C’est un privilège d’être à cette place aujourd’hui. Si le curseur a été mis à ce niveau-là il y a une vingtaine d’années, tu sais qu’il y a aussi énormément d’attentes aussi chez les téléspectateurs. C’est la grand-messe de la semaine, il faut être très bon, meilleur que d’habitude.
À quoi ressemblait l’ambiance dans les couloirs de Canal ces dernières saisons quand la Ligue des champions se jouait sur d’autres chaînes ?On sentait avoir perdu quelque chose d’énorme. Et ça se mesure au bonheur qu’on a eu de retrouver cette compétition. Après, des matchs de foot, il y en a toujours eu sur Canal. Et quand on faisait un peu moins de Ligue 1, plus de Premier League, on était quand même bien servi. L’an dernier, la chaîne a sauvé la LFP en reprenant la diffusion de la fin de saison (à la suite du fiasco de Mediapro, NDLR). Bref, il y avait du boulot pour tout le monde.
Comment s’est passée ton arrivée dans ce groupe ?Je suis arrivé il y a sept ans. Je rentrais à l’IPJ, une école de journalisme parisienne, et je cherchais un apprentissage. Infosport m’a proposé de faire un test, et quinze jours plus tard, j’intégrais la rédaction. Après deux ans d’apprentissage, puis de la pige, Canal+ m’a proposé un contrat pour commenter les matchs sur Jour de foot, puis la D1 féminine, la Premier League et donc la Ligue 1 depuis l’an dernier.
![]()
C’est à la suite du licenciement de Stéphane Guy que tu as été propulsé numéro 1… (Il coupe.) Tu utilises le mot « propulsé » , je comprends pourquoi, mais j’ai été choisi avant ça par la direction des sports pour commenter des matchs de Ligue 1 et remplacer Stéphane Guy sur les grosses affiches, lorsqu’il allait par exemple sur un choc de Premier League. Il s’est passé ce qu’il s’est passé avec Stéphane, et j’ai donc été amené à reprendre ses matchs. Ça coïncidait avec le moment où Canal avait récupéré les affiches du dimanche soir. Donc c’est allé très vite.
Certes, mais le grand public ne te connaissait pas avant ça. C’était un surplus de pression pour toi ?Je ne me suis pas posé la question de savoir comment ça allait être pris par les gens. On était en plein Covid, il n’y avait personne dans les stades, on récupérait des matchs… J’ai juste fait mon boulot. Après, effectivement, c’était sur des matchs plus prestigieux, mais avec les tribunes vides, c’était difficile à mesurer. Ça ne m’a pas mis plus de pression que ça.
Dans ces conditions, comment trouve-t-on son ton, son style ?Inconsciemment, tu t’inspires des gens que tu as trouvé très bons comme Thierry Gilardi, Grégoire (Margotton), Denis (Balbir) ou Stéphane (Guy). Mais je ne veux copier personne. Le style, tu le trouves avec le temps, tu t’imprègnes aussi de tout ce que tu as vu et entendu. Et plus tu commentes de matchs, plus tu t’améliores. Il y aura cette tournure de phrase qui sonnera mieux, cet adjectif qui est plus pertinent, cette intonation plus jolie… Moi, trop souvent, j’utilise le mot « important ». Ça ne veut pas dire grand-chose, et je cherche donc des équivalents pour varier et être plus juste.
Tu écris tes lancements ou ta première tirade sur l’engagement ?Non, pas spécialement. En revanche, j’ai un petit gimmick que j’aime bien caser, en parlant de « l’entrée des artistes ». C’est une image sympa qui résume bien ce qu’est le foot pour moi : c’est un art, un spectacle, les gens y viennent pour voir des artistes, pas un 0-0. Et puis ça lance le truc : dès cet instant, c’est aux footballeurs de jouer.
C’est donc là qu’il faut savoir se détacher de ses fiches ?C’est beaucoup de travail en amont, ces fiches. Elles sont bien remplies. Mais pendant le match, si j’utilise 10% de ce que j’ai marqué, c’est déjà bien. Ça va plus être une sorte de béquille. Par exemple, si le consultant me dit « j’adore tel joueur de Bruges », j’aurai forcément une ou deux billes sur lui.
Puisque tu évoques le consultant : comment arrive-t-on à créer une complicité avec son binôme ?Ça aussi, ça vient avec le temps. Il y en a certains avec qui ça prend direct, d’autres moins. On s’apprivoise. On parlait de légitimité tout à l’heure, mais quand tu te retrouves assis à côté de personnes qui ont fait carrière dans le foot, il ne faut pas passer pour un guignol. Il faut qu’il puisse voir le travail que tu as fait pour qu’il se dise : « Ok, il a fait son job. » Et quand tu prends confiance, le consultant sait ensuite qu’il va pouvoir te chambrer ou rebondir sur ce que tu dis. C’est comme ça que je me suis retrouvé la dernière fois à mettre un tir à Habib (Beye) qui parlait des grands buteurs, alors que lui ne connaissait pas trop cette sensation. (Rires.)
![]()
Comment ça se passe avec Rudi Garcia, la dernière recrue en date ?Il est excellent. Je le connaissais en tant qu’entraîneur, et c’est une belle découverte de l’avoir en tant que consultant. Il connaît ce rôle pour avoir déjà commenté auparavant, et c’est quelqu’un de très intelligent, avec cette capacité d’adaptation. Très humble, finalement.
Est-ce qu’un « pas ça Zinédine » ou un « c’est pas Gijón, c’est pas Valladolid », ce genre de phrases devenues légendaires, sont un objectif dans la carrière de commentateur ? Ça dépend si tu te déchires ou pas ! Mais oui, ces phrases accompagnent des émotions que tout le monde vit à l’instant T. Même celle avec Gijón, à 3-1 pour le PSG avant que le Barça ne réalise sa remontada, c’était un ressenti partagé par tous. Je ne cours pas après les récompenses, mais, un jour, si jamais j’arrive à être très bon, dans un très grand match, avec une formule qui donne de l’émotion aux gens, alors oui, c’est un objectif. De toute façon, tu peux être le meilleur, si le terrain n’apporte rien, les commentaires ne resteront jamais. Thierry Gilardi n’a pas attendu la finale de la Coupe du monde 2006 pour être un immense commentateur, mais il faut que le plus grand joueur français de tous les temps commette l’irréparable pour que ces mots entrent pour toujours dans la mémoire collective.
Tu regardes ce qui se dit sur Twitter ?(Catégorique) Non, non. Je ne suis pas sûr qu’il y ait beaucoup de bon à en retenir. Déjà, ça a un effet de loupe. Quatre millions de gens ouvrent quotidiennement l’application et, parmi eux, seulement un infime pourcentage est actif. Donc ce qu’il s’y passe n’est en rien représentatif de ceux qui regardent le match sur leur télé. Et puis, je sais qu’il n’y a pas beaucoup de bienveillance sur Twitter. Je n’ai pas envie d’être pollué par les avis de gens qui, pour la plupart, ne donnent pas leur nom. Si je donne du crédit à ce que @Neymar968 ou @Alvaro1383 disent de moi, je n’en finis plus. J’essaye de faire le mieux possible pour les abonnés, pour mes patrons, pour les gens qui me font confiance, mais je ne cherche pas à faire l’unanimité. On ne fait jamais l’unanimité, d’ailleurs.
N’y a-t-il pas, dans la confrérie des commentateurs, la propension à vouloir faire de chaque match — notamment ceux du PSG — un moment historique ? Ne galvaude-t-on pas cette notion ?Autant, on peut parfois événementialiserun peu trop les choses. Autant voir Messi être titulaire pour la première fois avec le PSG, ça va au-delà du foot. Ce gars, c’est une icône ! C’est Mick Jagger ! C’est encore plus fort que Neymar. Tu le vois quand il a été présenté, l’attente des gens au Bourget alors qu’il était en slip dans sa piscine à Barcelone. À Bruges, il y a des stewards qui sortaient leur téléphone pour immortaliser ce moment…
Une particularité de ton parcours, c’est que tu as joué au foot jusqu’en CFA. En quoi ça peut t’aider en tant que commentateur de connaître les arcanes de ce milieu, les subtilités du jeu et l’ambiance de vestiaire ?Je ne pense pas qu’il faille avoir été un bon joueur de foot pour être un bon commentateur. Ça, c’est évident. Après, sur certaines actions, quand tu as joué, tu sens peut-être un peu plus les choses. Je me rappelle un match d’Arsenal que j’ai commenté avec Robert Pirès. Au tout début d’une action, Ceballos fait ce petit pas en arrière qui lui permet de recevoir le ballon avec plus de confort et donc d’avoir un temps d’avance sur son adversaire. Au bout, ça permet à son équipe de marquer. J’insiste sur ce mouvement et je vois Robert acquiescer. Je sens que je suis pile là où le consultant voulait que j’aille. C’est sur ces situations que ça peut aider d’avoir été footballeur.

Il y a dix ans encore, tu étais joueur de la réserve de l’AS Nancy Lorraine. Pourquoi en être resté là ?J’ai fait mon dernier match le 1er mai 2011 (défaite 0-2 contre le PSG d’Alphonse Areola, NDLR). Je n’avais pas le niveau pour aller plus loin, c’est tout. La CFA est un moment charnière : tu joues contre des hommes, qui sont prêts physiquement, pour qui c’est un complément de revenu et tous les week-ends. Moi, j’avais 19-20 ans et j’ai vu tout de suite qu’il me manquait des choses.
En parallèle, tu suivais déjà un cursus pour devenir journaliste ?Non, j’ai arrêté mes études pendant deux ans après mon bac pour me consacrer pleinement au foot et c’est seulement après que j’ai repris une licence d’histoire et de sciences politiques à Paris I. À l’origine, je savais que le métier de journaliste m’intéressait et que cette formation préparait bien aux concours.
Avant cela, puisque tu es lyonnais, il y a aussi eu un passage à l’OL…J’y ai joué pendant quatre ans chez les petits. Mes parents n’étaient pas trop chauds à l’idée que j’intègre le centre de préformation et que je m’entraîne tous les jours à 11 ans. Donc je suis allé au CASCOL à Oullins. Et à 16 ans, Nancy est venu me chercher et je suis reparti. C’était le bon moment, et à l’école, c’était hyper sérieux. C’était primordial pour mes parents, qui étaient tous les deux profs.
À l’OL, tu as quand même eu le temps d’échanger des ballons avec Clément Grenier et Alexandre Lacazette. Ça fait quoi de les voir aujourd’hui où ils sont ?C’est cool parce qu’à chaque fois qu’on a l’occasion d’échanger, même s’ils sont dans une autre dimension, on retrouve tout de suite des réflexes de gamins. Ce sont des mecs qui ont des sélections en équipe de France et qui ont joué la Ligue des champions, et tu en reviens à parler du tournoi où on mangeait des merguez entre les matchs. Ce qui nous lie, c’est l’amour du foot, jouer au ballon.

Deux pros sur les côtés, et Paul, quatrième en partant de la gauche.
As-tu senti une fracture entre le monde du foot et celui des études supérieures ?À Nancy, il y avait un peu une ambiance de colo par moment, en dehors du programme de fou qu’on avait. On faisait tout ensemble, la Playstation, le ping-pong, le baby-foot, ça chambrait… Donc tu es tout le temps avec tes potes pendant quatre ans. Et quand je suis arrivé à Paris, j’ai ressenti ce décalage. Tout d’un coup, je me retrouvais avec des gars qui lisaient les rapports de la Cour des comptes. Trois mois plus tôt, je regardais quatre matchs par jour avec mes potes de l’ASNL. Je ne dis pas que c’est moins bien, mais c’est complètement différent. J’ai pris conscience que j’avais quand même du retard, donc je me suis mis à lire des journaux, des classiques de la littérature, à regarder le JT tous les soirs, des films… Tout simplement pour partager les centres d’intérêt des gens qui étaient avec moi. J’ai fini par trouver ma place et me faire des potes pour la vie.
Laurent Bonadéi, ton dernier coach à Nancy, te prédisait pourtant dans les colonnes du Parisien une carrière d’arbitre international ou de directeur sportif. Pourquoi ? Je sais très bien pourquoi : je venais de me faire opérer d’une pubalgie, qui m’a écarté des terrains pendant un an. Et lors d’un match amical, il leur manquait un arbitre. Bonadéi me dit : « Bah tiens Paul, tu n’as qu’à prendre le sifflet ! » Normalement, quand tu fais arbitrer un joueur, il le fait en dilettante, mais moi, j’ai pris les choses hyper à cœur. Je sifflais, j’allais voir les gars, je leur parlais… Et à la fin, il me dit que j’aurais pu être arbitre international. Mais moi, je voulais être footballeur international ! (Rires.)
En commentant des matchs de Ligue des champions, vis-tu ton rêve d’être footballeur pro par procuration ?Honnêtement, non. Je ne suis pas un footballeur raté qui s’est dit un jour qu’il devait être journaliste pour connaître ces choses-là. Je voulais être journaliste parce que j’aime ce métier et j’aurais totalement pu faire des faits divers ou de la politique. Le foot a été une opportunité, je l’ai saisie.
Maintenant que tu connais l’envers du décor du monde professionnel, est-ce qu’il est comme tu l’avais fantasmé gamin ?Je ne le regarde plus avec les mêmes yeux que lorsque j’avais 10 ans. On côtoie ceux qu’on aurait perçus auparavant comme des héros, on les a en interview, c’est normal. Tu ne peux pas être dans une posture de groupie et demander à Cristiano Ronaldo son maillot à la fin du match. Il faut savoir prendre du recul et mettre une certaine distance. Mais cet émerveillement revient ponctuellement, quand tu entends l’hymne de la Ligue des champions, par exemple.

Propos recueillis par Mathieu Rollinger
Photos : Canal+ et collection personnelle de Paul Tchoukriel.