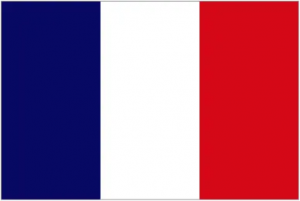- Amérique du Nord
- Canada
Patrice Ferri : « Il y a une vraie culture foot au Canada »

À l'été 1993, alors en fin de contrat à l'Olympique lyonnais, Patrice Ferri décide de franchir l'Atlantique pour rejoindre l'Impact Montréal. Entre la période Pélé/Beckenbauer et celle de Drogba et Giovinco. Ce qui n'a pas empêché l'actuel consultant pour beIN Sports d'emmagasiner les souvenirs dans une Amérique du Nord où les footballeurs étaient des citoyens ordinaires.
Au niveau football, quand tu signes à l’Impact Montréal, cela ressemble à quoi le championnat nord-américain ?Ce championnat professionnel était dans le cahier des charges en vue de l’attribution du Mondial 1994 aux États-Unis. La FIFA avait demandé impérativement à ce qu’une ligue professionnelle soit recrée. Celle-ci avait disparu après la période du New York Cosmos avec Pélé, Beckenbauer, Chinaglia. Depuis, il n’y avait que des Ligues intérieures, avec des États organisant leurs propres championnats, mais il fallait quelque chose à l’échelle nationale ou nord-américaine. Et donc ils ont créé l’APSL (American Professional Soccer League), où s’est inscrit l’Impact Montréal car il y a une vraie culture foot au Canada. Évidemment, il y avait des problèmes de structures, mais il y a toujours eu un réel intérêt, dans les universités par exemple, et au niveau des jeunes. Chez les filles, c’était le sport le plus pratiqué par les moins de 14 ans. Le Canada, c’est aussi un pays de communautés, donc les ressortissants de toutes les communautés européennes et sud-américaines, beaucoup d’entre eux jouaient au foot. Après, l’approche des événements sportifs était très « américaine » . Quant au niveau, il était plutôt bon, l’équivalent d’un second de tableau de Division 2 française de l’époque.
Qui vous avez mis en relation avec l’Impact Montréal ?
J’avais un contact qui travaillait au magazine Onze Mondial, qui m’a mis en relation avec l’un de ses collègues, marié à une Québecoise, qui repartait vivre là-bas. Il avait eu vent du projet de franchise qui se mettait en place. À Lyon, il me restait une année en option, ce contact m’a demandé si cela pouvait m’intéresser d’aller au Canada et j’ai dit « oui, éventuellement. » J’ai commencé à discuter avec des gens de là-bas par téléphone, l’idée de recruter un Français leur plaisait, surtout que Jean-François Larios avait lui aussi joué à Montréal par le passé (au Maniac Montréal en 1983, ndlr).
Niveau ferveur, il y avait du monde au stade ?Toutes proportions gardées, c’était pas mal, 4000 à 5000 personnes au stade. Tous les après-midis, avec les communautés, tu pouvais suivre les matchs européens. Tu allais dans un restaurant grec, il y avait le championnat grec à la télévision. Dans un pub anglophone, tu avais la Premier League… Il y avait un réel engouement, et puis le Canada était déjà engagé dans les compétitions internationales donc ils avaient des matchs importants à jouer. Après, ce n’était pas le même engouement que pour le hockey ou le baseball, mais quand même. L’intérêt pour le soccer était réel.
Au niveau de la vie quotidienne, très différent de l’Europe ?L’approche de l’événement, de la compétition, je suis passé de tout à son contraire. Très encadré en Europe. En Amérique du nord, tu n’as aucune excuse quant au résultat, tu dois aller au bout de toi-même. Mais on s’entraînait dans l’ancien stade d’entraînement des JO de 1976, tous les sports étaient représentés.
En même temps que l’on s’entraînait sur le terrain de foot, il y avait aussi des nageurs à la piscine olympique par exemple. Notre vestiaire était au milieu de tout ça, on avait un créneau horaire convenu par la municipalité pour utiliser les installations, et on était noyés au milieu des autres sportifs. Pour donner un exemple parlant, un peu comme à Charléty. Pendant que nous on s’entraînait sur le terrain de foot, d’autres étaient sur la piste d’athlétisme. L’esprit de la communauté au Québec, c’est que l’équipement public profite à un maximum, nous n’avions aucun privilège. Moi qui venais de la Division 1, le contraste était fort. Il nous est arrivé de nous entraîner dans des parcs publics car nous n’avions pu obtenir le bon créneau pour le terrain. Dans ces cas-là, on prenait la voiture et on allait s’entraîner trois kilomètres plus loin dans un parc.
Cela tranche avec le milieu du football actuel où l’on met les joueurs dans une bulle…Oui oui, on n’était pas du tout isolé de la population, pas du tout privilégié. Certes, on avait un aspect professionnel dans notre pratique, mais certains de nos partenaires ne l’étaient pas et allaient travailler dans la journée. On était baignés dans un ensemble de choses, au milieu des gens. Mais aujourd’hui, ce n’est plus la même chose, les joueurs sont protégés, isolés, même en Amérique du Nord. À l’époque, c’était déjà le cas en Europe, mais pas au Québec.
Si l’arrêt Bosman avait eu lieu deux ans plus tôt, tu serais quand même parti à l’Impact Montréal ? On peut imaginer que tu aurais eu plus d’opportunités en Europe…Cela reste une possibilité, j’aurais peut-être réfléchi différemment, eu l’envie de goûter à un autre championnat, une autre culture… J’aurais eu la réflexion, sauf qu’à l’époque, je n’ai pas eu à faire de choix. Je ne connaissais pas l’Amérique du Nord, c’était l’occasion de voir autre chose, une culture différente, une mentalité différente.
C’était un choix de vie plus qu’un choix de carrière ?Un mélange des deux. J’ai été surpris par le niveau, une bonne surprise. Il y avait de très bons joueurs et moyen de se faire plaisir sur le plan humain et sur le plan sportif. Il y avait notamment pas mal d’internationaux canadiens dans l’effectif, des gars qui se frottaient parfois à de grandes équipes, je me souviens notamment d’un Canada-Brésil.
Si tu devais retenir une grande image de tes deux ans au Canada, ce serait quoi ?D’abord sur le plan humain, cette capacité d’accueil envers les gens qui ne sont pas Canadiens ou Québecois. Sportivement, ce sont des détails drôles liés au fonctionnement du club. Il y avait une grosse capacité d’acceptation des autres. Dans notre effectif, il y avait des Canadiens, des Québecois, des Sud-Américains, des Européens, des Jamaïcains.
Et puis il y avait un fonctionnement plus léger qui m’a permis de souffler avec douze années rigides et strictes en Division 1. Quand on partait en déplacement, vu que la Ligue n’était pas différenciée en conférences, mais à l’échelle nationale, on partait parfois toute la semaine pour trois matchs. On allait à Denver, Seattle, Los Angeles. On faisait comme une tournée, sauf que c’était du championnat. Quand on est partis la première fois de Montréal, le directeur sportif attendait chaque joueur dans la salle d’embarquement pour lui remettre une enveloppe. J’ai ouvert ça avec curiosité, dedans, c’était ton budget pour les repas des six jours plus les billets d’avion.
Vous étiez donc totalement autonomes ?Tu faisais ce que tu voulais avec ça. Si tu dépassais le budget qu’ils avaient calculé, tu payais de ta poche. Et si un mec loupait son avion, il se payait un nouveau billet avec son argent. On n’était pas obligés de manger ensemble le jour du match, certains partaient en ville manger un hamburger à trois heures du coup d’envoi.
Pour mon premier séjour à Los Angeles, avec un partenaire croate, on avait loué une voiture pour visiter l’après-midi du match car c’était ma première fois dans la ville. En revanche, au moment où l’arbitre sifflait le début du match, tu n’avais plus d’excuse, il fallait répondre présent. Autre anecdote, c’est arrivé que nous procédions au décrassage dans les couloirs de l’hôtel car le temps était exécrable dehors. Une quinzaine de mecs en chaussettes en train de courir sur deux étages de l’hôtel pour le décrassage… Loin du cadre que j’avais connu en Division 1, comme les contrats. Pour certains, c’était des piges, des joueurs signaient pour faire un seul match. Moi je revenais le lundi, je demandais « mais il est passé où untel ? » On me répondait qu’il était parti, il avait terminé son contrat, il était là pour un match parce qu’il y avait un blessé.
Cela ressemble un peu aux prêts courte durée en Angleterre…C’est l’esprit anglo-saxon, des gens peuvent être là pour un seul match. Autre aspect atypique, la période hivernale. Les joueurs partaient jouer dans des Ligues intérieures de foot en salle. C’est là que j’ai découvert le futsal. Ils avaient déjà le principe que l’on connaît en Urban Foot : ils avaient déjà tout développé par contrainte. Certains autres joueurs partaient pendant trois mois jouer au hockey parce qu’ils aimaient ça…
Humainement, cela doit être fantastique à vivre…Cela donne un éclairage différent sur certaines choses. Après, il faut replacer tout ça dans un contexte. C’était en 1993. Aujourd’hui, c’est bien différent. En 2013, ils m’ont invité pour célébrer les vingt ans du club, j’ai bien vu la différence. Aujourd’hui, ils ont Drogba et leurs propres infrastructures. En revanche, pour tout ce qui était merchandising, techniques de promotion, ils étaient déjà au top, mais cela fait partie de la culture américaine. Ce qui se fait aujourd’hui en Europe, cela vient un peu de là-bas.
Tout ce qu’il faut savoir sur le tirage au sort du Mondial 2026Propos recueillis par Nicolas Jucha