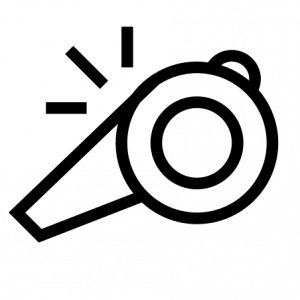- Ligue 1
- J10
- OM-Strasbourg
Pascal Johansen : « Si je n’avais pas réussi, je serais rentré à la SNCF »

Pascal Johansen a enchanté les pelouses de Ligue 1 dans les années 2000, avec Strasbourg, d’abord, puis Marseille, ensuite. Entre le décès de son grand frère Frédéric, ses années collège et la fin de sa carrière, l’ancien milieu de terrain revient sur sa vie, tout en simplicité.
Quel genre d’éducation as-tu reçue ?J’ai grandi dans un quartier populaire, mon père était cheminot, et ma mère était secrétaire dans une boîte de tissus. On vivait dans un appartement très simple, dans un quartier où il y avait beaucoup d’espaces verts. Pour commencer à jouer au ballon, c’était idéal. Notre situation était assez classique. Mon père a passé tous les échelons des cheminots, il a commencé en étant contrôleur, puis chef de gare… Tranquille, quoi. Petit, durant les vacances, il y avait un truc cool : on ne payait pas le train. On était un peu privilégiés, d’autant qu’à l’époque, prendre l’avion était quelque chose de cher. Bon, ça a duré jusqu’à mes 18 ans, après plus rien ! (Rires.)
Tu as un grand frère, Frédéric, de sept ans ton aîné. Comment ça se passait quand vous étiez petits ? On était très proches. C’était mon grand frère, dans le sens où, au niveau de mon éducation, il m’a beaucoup aidé.
À l’époque, il n’y avait pas autant de discussions entre les parents et leurs enfants. Mon père était quelqu’un… de l’ancienne école. Il ne communiquait pas trop, à part quand ça n’allait pas ! Là, tu te faisais reprendre de volée ! (Rires.) C’était plutôt notre mère qui était proche de nous, et notre père était là pour remplir le rôle du chef. Donc mon frère m’apprenait les petites choses de tous les jours. Je l’admirais beaucoup… C’était un peu mon idole, en fait. Déjà, il a partagé avec moi la passion du ballon. Très jeune, il est parti en sport étude, puis en centre de formation, puis en équipe de France de jeunes. Donc, il me racontait des anecdotes, les histoires de vestiaires, les rouages du métier… C’était passionnant ! Avec mes parents, on était souvent invités dans des clubs, pour visiter leurs installations. Je me rappelle une chose : on était allés à Auxerre voir Guy Roux. J’étais tout petit, et j’étais reparti avec un maillot, j’étais comme un dingue ! Vingt ans plus tard, je me retrouve dans le même bureau de Guy Roux, car j’avais une possibilité de signer à Auxerre. C’était très bizarre comme sensation. Parfois, on pouvait voir Guy venir voir des matchs à Colmar, avec son avion privé.
Comment ça se passait à l’école ? À l’école, ça se passait plutôt bien jusqu’au lycée. J’étais bien dans mon petit collège, avec mes potes, j’ai eu facilement mon brevet. En cours, ça se passait bien. J’ai toujours bien aimé le français. Au collège, j’avais gagné un concours où il fallait écrire une histoire, un conte de Noël ou une connerie comme ça, et il fallait l’illustrer avec un dessin. Bon, j’avais un peu triché car j’ai demandé à un pote, qui savait bien dessiner, de me faire le dessin. J’avais gagné ce petit prix, et la récompense, c’était un livre. Je ne lisais jamais, c’était vraiment un super cadeau ! (Rires.) En revanche, un truc qui me tuait, c’est qu’à l’école et au collège, on n’avait pas le droit de jouer au foot dans la cour. Même en sport, on ne faisait pas de foot ! On jouait au basket, au volley, au handball… J’ai même gagné le cross de mon collège. J’avais tellement envie que ça se finisse que j’ai commencé à courir et je me suis retrouvé premier ! Le collège, c’est aussi les premiers flashs sur les filles, les premières amourettes, mais rien de particulier, quoi. Il y avait une fille qui me plaisait bien, mais elle était 3e et moi en 6e. Elle m’aimait bien, mais ce n’était pas possible ! (Rires.)
À part footballeur, il y a un métier que tu aurais aimé faire ?
Non, c’était vraiment l’angoisse, je n’ai jamais su ce que je voulais faire. Même footballeur, je n’ai jamais vu ça comme un métier. J’avais un frère qui était tellement fort… je vivais dans son ombre. Dans notre famille, c’était normal, on avait l’enfant prodige. Je vivais dans son ombre et ça ne me dérangeait pas. J’adorais ça même, je me disais qu’il allait faire une grosse carrière. Moi, j’avais ce côté nonchalant, je jouais pour me faire plaisir. Lui avait déjà un caractère de champion. Comme il était un peu connu, j’étais la petite star par procuration. Tout le monde te connaît par rapport à ton frangin, ça te donne un petit côté « frère de » , j’aimais bien. Il y a aussi les : « Ah ! C’est lui, son frère ? Bah, il est beaucoup moins bon… » C’était relou, surtout quand t’es jeune et que tu veux seulement t’amuser sur le terrain. Parfois, je me faisais engueuler par mon père, car, l’après-midi d’un match, une heure avant la rencontre, je jouais au foot avec mes potes. Forcément, j’étais un peu K.O sur le terrain, et mon père me disait : « Qu’est-ce qui se passe ? T’as pas bien joué, je te sens fatigué… » , « J’ai joué au foot toute l’après-midi, je ne suis pas au top, c’est normal » , il commence : « Mais t’es complètement con, en fait ? »

Alors que tu as 13 ans, en décembre 1992, ton frère décède dans un accident de voiture…Oui, c’était juste avant Noël. Il était avec Jean-Pierre Bosser, l’ancien du PSG qui avait fini sa carrière à Mulhouse. Bosser était un peu son grand frère. Jean-Pierre aimait bien parler avec lui, lui donner des conseils. À la maison, c’était toujours moi qui répondais au téléphone, donc on reçoit un coup de fil de Frédéric, me disant : « J’ai fini l’entraînement, je vais déjeuner avec Jean-Pierre et je rentre à la maison. » Une heure après, Jean-Pierre appelle à la maison. « Ça va Boboss ? » D’habitude, il était très joyeux, mais là, il avait une voix très bizarre. « Allô ? Tes parents sont là ? Passe-moi ton père, il faut que je lui parle… » Mon père se décompose et me dit : « Frédéric a eu un accident. » C’était la panique, et on reste longtemps sans savoir. À l’époque, il n’y a pas de portable, on était dans un village perdu, sur une départementale, on ne sait pas qui l’a pris en charge. Les pompiers ? Si oui, dans quel hôpital ? On commence à appeler tout le monde, pendant une heure. Puis, on reçoit un coup de fil d’un proche de la famille. Mon père se retourne vers moi pour me dire que c’était fini. Et c’était fini.
Comment tes parents ont-ils réagi ? Je n’ai plus de souvenirs… Peut être que le cerveau sélectionne certains moments, mais je me souviens du chaos ambiant qui traînait chez nous. Le fait d’être aussi jeune m’a aidé, finalement. Je ne comprenais pas… C’était assez bizarre. Si j’avais été plus jeune ou plus vieux, je crois que ça m’aurait détruit. C’est comme si je n’avais jamais réalisé le décès de mon frère.
Comment ça se passe pour toi, après ce drame, à la maison, à l’école, au foot ?Je sais qu’il y avait un match de Coupe de France, ce week-end-là. Colmar recevait Nancy et je me rappelle que mon père insistait en disant : « Il faut qu’on sorte de la maison, sinon on va devenir fous. » Alors, on n’est pas allés au match, mais à une petite bouffe organisée après. Ça a été dur.
Tout le monde pleurait. Je voulais arrêter le foot, j’étais dégoûté, ça me faisait chier de retourner sur les terrains. Tout le monde savait pour l’accident… Tout le monde me regardait… avec un peu de pitié. Et puis, on est décembre/janvier, il fait un temps dégueulasse… J’étais à la ramasse. Tout le monde kiffe ses vacances de Noël, et en reprenant le foot et l’école, ma mère m’a dit : « Écoute, ne commence pas à dire n’importe quoi. Tu sais bien que ton frère n’aurait pas aimé que tu arrêtes, tu continues. C’est normal que tu ne te sentes pas bien pour le moment, mais ça va te faire du bien. » Et puis, c’est passé. Je n’ai jamais réalisé la chose et j’ai continué en me disant que rien n’était arrivé. Quelque part, l’avantage qu’on avait, c’était qu’il ne vivait plus à la maison depuis longtemps. Il était parti très jeune en sport étude… Ta vie ne change pas énormément, on était habitués à son absence. Je me souviens d’une phrase de mon père : « Si ça avait été Pascal, ça aurait été encore plus dur, car il était tout le temps à la maison. » Ça ne change pas ton quotidien, mais je voyais mon père très malheureux, même s’il ne le montrait pas. Ma mère a été la plus forte, comme d’habitude. Je pense que les femmes, en règle générale, elles sont plus fortes mentalement.
Comment se remet-on d’un tel drame quand on est aussi jeune ?On essaye de reprendre une vie normale. On va à l’école, on va au foot, mes parents vont au travail. Il fallait continuer à vivre. On a toujours été très actifs, des sorties, des bouffes… Rapidement, on s’est remis dans cette vie, car on savait que sinon, ça allait être foutu. Je n’attendais rien de rien, je continuais ma vie, toujours en ne sachant pas ce que je voulais faire. Ensuite, j’arrive au lycée, ça ne se passe pas bien. Je suis mal orienté, je me retrouve dans un bac techno. Au lycée pro, tu pouvais faire un sport-étude, mais pas en général. Je pouvais m’entraîner avec le sport étude le lundi et le mercredi, et avec mon club le mardi et le jeudi. Un gros rythme quand tu as 15-16 ans, mais comme c’était dans la même ville, je pouvais aussi faire le con avec mes potes. Une année plus tard, je fais un BEP menuiserie, alors que je sais à peine changer une ampoule. C’est tout de suite une catastrophe. Pendant deux ans, c’était le bordel. Je ne foutais rien en classe et, pire, je ne comprenais rien. On ne m’a pas dit : « On va t’apprendre » , mais « tu devrais déjà savoir » . « Mais vous n’allez pas m’apprendre ? » , « Non, normalement tu dois avoir des bases. » Je ne sais pas qui s’occupe des orientations à l’éducation nationale, mais parfois, c’est vraiment n’importe quoi ! (Rires.) Surtout que les professeurs d’ateliers sont antisportifs. Je commençais à jouer en équipe une en DH dans mon club, ça tournait bien pour moi, et le lundi, j’étais souvent en photo dans la presse locale. Les profs avaient les boules ! Ils me voyaient rien foutre de la semaine, et le week-end, je ramassais les honneurs grâce au football.
Ils t’en faisaient voir de toutes les couleurs ? Ils voyaient tous bien que j’étais un mec qui n’en branlait pas une. Je me faisais fracasser ! T’as joué le dimanche, t’es forcément K.O le lundi et tu te retrouves avec huit heures d’atelier debout. Physiquement, ce n’est pas facile.
Il fallait que j’arrive à passer huit heures d’ateliers sans rien faire. Tu vois la performance ? L’atelier était assez grand, tout le monde est aux machines. Moi, j’étais tout le temps à droite, à gauche en faisant semblant de bosser sur des trucs. Tu parles à tes potes, tu reviens, tu refais semblant, tu demandes à tes potes de te faire des trucs que tu ne savais pas faire. En passant par là, je savais ce que je ne voulais pas faire de ma vie. J’ai aussi fait un stage dans une entreprise de fenêtres. Parfois, tu avais des gros chantiers en construction, donc l’été, tu as trop chaud, tu deviens fou, car tant que tu n’as pas fini, tu ne rentres pas. L’hiver, il fait trop froid, c’est insupportable. Je rentrais chez moi et je me disais : « Il ne faut pas que je fasse ça de ma vie. Je ne veux pas me retrouver à bosser toute ma vie là-dedans. » Comme j’étais plutôt bon niveau foot, je me dis que ça peut devenir une option. Si je n’avais pas réussi, je serais rentré à la SNCF par le biais de mon père et j’aurais commencé en bas.

C’est aussi l’époque des premières soirées entre potes.Les premières sorties en boîte, même ! On s’entraînait du lundi au jeudi et comme on jouait le dimanche, notre sortie, c’était le vendredi soir. Pour 100 francs, t’avais une entrée + deux consos. Tu buvais deux Desperados, t’avais ton compte, t’étais déjà bourré ! Ça ne marchait pas trop avec les filles… J’étais bon quand il fallait danser d’une manière privée, sinon j’avais trop honte de danser en boîte ! (Rires.) C’était l’époque de la dance avec les 2 Unlimited, les conneries comme ça ! Attention, j’écoutais ça uniquement en boîte. Sinon, c’était du rap, à fond ! L’album de ma vie, c’est NTM – Paris sous les bombes. À cette époque, c’était le top niveau. On ne fera pas mieux en rap français. À la Fnac, il n’y avait pas de rayon rap, il y a juste un petit bac avec quatre CDs. Il y avait NTM, IAM, Cypress Hil et Snoop Dogg et son fameux Doggystyle. À l’époque, il n’y a pas Youtube, il y avait les clips de M6, à minuit. Au début, j’écoutais plus du rock, The Doors, Pink Floyd, tout ça. Quand j’entends NTM, je deviens fou. Quand j’écoute « Tout n’est pas si facile » , je prends une claque. Je n’étais pas fan de IAM, mais l’École du micro d’argent, c’était quelque chose. C’était l’album que j’écoutais tout le temps avant les matchs. Avant mon premier match pro, dans le bus, j’écoutais ça. Je m’étais mis dans une ambiance… J’étais concentré comme jamais ! Ce soir-là, j’ai senti un truc de ouf !
Finalement, tu fais ta formation à Strasbourg, pour ensuite rejoindre l’équipe une. Pour un Colmarien, ce n’est pas rien…
En tant que Colmarien, notre rêve était de jouer à Mulhouse. C’était ce club de Ligue 2 qui donnait sa chance aux jeunes. Strasbourg arrive, mais je ne veux pas y aller. Nous, les Haut-Rhinois, on n’aimait pas trop Strasbourg… Mon père ne voulait pas revenir à Mulhouse par rapport à mon frangin. On va là-bas pour signer mon contrat et le soir même, on est invités pour un Strasbourg-Nantes. On regarde le match, et mon père se tourne vers moi et me dit : « Dans trois ans, tu signes stagiaire et tu te retrouves dans cette équipe. Tu penses en être capable ? » « Oui, oui » , mais c’était pour lui faire plaisir, dans ma tête, c’était impossible ! Je voyais le match en vrai, ça allait plus vite, c’était plus costaud, avec la Meinau qui pousse… Je ne me voyais pas réussir.
Tu te souviens de ton premier match en pro ?Oui. On est en janvier 2000. On doit jouer le derby contre Metz. La veille à l’entraînement, on me dit que je vais démarrer. On me dit : « Tu vas prendre Fréderic Meyrieu. Tu vas le couvrir et le tuer physiquement. » Dans ma tête, c’était impossible. J’avais peur, je n’avais jamais défendu sur un mec comme ça, je me dis : « Si je me rate, en jouant à un poste qui n’est pas le mien, c’est horrible ! Putain, si je fais un match de merde, ça ne va pas être beau… » Je rentre chez moi, je suis avec ma copine, stressé de fou. La nuit n’est pas facile, et finalement, le jour du match, je me dis : « Ça passe ou ça casse, c’est aujourd’hui ou jamais ! » Le coach me met parce qu’il est un peu obligé, il fallait donc que je l’épate. Pour me faire une petite place, même un match normal n’allait pas suffire. Donc là, L’École du micro d’argent à fond, quoi, et ça s’est super bien passé pour moi.
Tu gagnes la Coupe de France 2001, et ton gardien de but s’appelle alors José Luis Chilavert.Jouer avec lui, c’était incroyable. En 1998, je regarde la Coupe du monde comme tout le monde, et c’est déjà un gardien de folie. Il s’embrouillait avec les adversaires, il tirait les coups francs… C’était dingue ! Et en dehors du terrain, c’est un mec posé, calme. Tu te dis : « Wahou, le mec est complètement l’inverse de ce qu’il fait penser, il est hyper cool ! » En revanche, il ne faut pas lui casser les couilles… (Rires.)
Et cette finale de Coupe de France, du coup ?
C’était compliqué… En quarts, on reçoit Lyon, on les bat 3-0, et je marque mon premier but en pro. En demi-finales, on reçoit Nantes, les premiers du championnat. De l’autre côté, c’est Troyes-Amiens, et on se dit qu’on n’a vraiment pas de chance, c’était la catastrophe. Finalement, on leur met 4-1. Le problème, c’est que ces deux matchs-là, on fait de belles choses, mais la finale était très dure. Amiens était en National, nous, on est en Ligue 1 et on tombe en Ligue 2. On se retrouve au Stade de France contre Amiens, une équipe que personne ne connaît. On se dit que si on ne gagne pas, c’est la honte. On n’entre pas bien dans le match, tout le monde essaye de faire son cinéma ! Plus le temps passe, plus c’est tendu, on se dit : « Les gars, on est en train de rater totalement notre finale. » Ils ont une occasion à la fin du match, et le gars envoie une frappe au-dessus. Aux penaltys, tu sais qu’avec Chila, ça va le faire. Chila avait beaucoup de charisme, et tu sentais que c’était pour lui. Il a arrêté le penalty qu’il fallait et il a marqué celui qu’il fallait.
La fête a dû être belle.Quand le match se termine, on est soulagés de soulever la coupe, mais on n’a pas kiffé ! Les émotions étaient en quarts et en demies, c’est là où on a vraiment kiffé. C’était chiant, car il y a beaucoup de monde qui passe dans les vestiaires. Tout un tralalala, avec les sponsors, les conneries… Il y avait aussi les femmes et les enfants qui sont venus pour prendre des photos avec la coupe. À un moment donné, notre vestiaire, ce n’était plus notre vestiaire. J’avais l’impression qu’on n’était pas entre nous, quoi. Ensuite, tout le monde est allé au Lido, car c’est la tradition de dîner là-bas. Finalement, ce n’était pas un truc de fou.
Vous descendez quand même en D2 à la fin de cette saison…C’est catastrophique… Quand Patrick Proisy (président du club entre 1997 et 2003, N.D.L.R.) arrive quelques années avant, tu sens que le gars veut faire un gros truc, et ça ne prend pas. Avant, le club tournait normalement avec l’ancien président Roland Weller, c’était LE club alsacien, avec les vraies racines, avec l’accent… mais ça marchait bien ! Il y avait une belle équipe, la Coupe d’Europe… Quatre ans après, tu te retrouves dans cette situation, c’est une catastrophe.
Comment s’est fait ton transfert à l’OM, lors de l’été 2002 ?
Je me sens de mieux en mieux à Strasbourg, de plus en plus important, je viens de prolonger, enfin tout se passe bien pour moi. Je me dis : « Ça y est, c’est lancé » , je commence à être le jeune qui confirme. Je me rappelle que je suis à table et je vois mon téléphone qui n’arrête pas de vibrer. Appels manqués, textos, messages… Il est taré ou quoi ?! Mon agent est en pleine folie. Je le rappelle : « Qu’est-ce qui se passe ? » , « Écoute, Alain Perrin m’a appelé, il veut te faire signer ! Il veut te faire signer tout de suite ! » Ça te met un choc. Surtout que moi, je n’aimais pas forcément Marseille, j’étais plus un gars du PSG. Marseille, t’avais l’impression que tous les six mois, il y avait une nouvelle équipe. Christophe Bouchet arrive et veut reconstruire une équipe solide, plus cohérente. Finalement, t’es dans une situation où tu te dis que ça ne se refuse pas. C’est ça, le truc. Tu vois que les gens autour de toi sont tellement contents, tellement excités. Ton agent, tes parents, tes amis sont comme des fous. Mon père m’a dit : « Tu ne peux pas dire non. » Même si aujourd’hui, je te le dis franchement, je n’aurais pas dû y aller. Je pense que c’était trop tôt. Ça m’aurait fait du bien de faire une année de plus en Ligue 1, avec Strasbourg, surtout à un poste qui était le mien.
Une année après ton arrivée, tu retrouves une équipe de monstres : Drogba, Mido, Van Buyten… Comment ça se passait au quotidien ? Perrin veut jouer en 4-4-2, avec une équipe offensive. Déjà, comme ça, je sens qu’il n’y a pas forcement de place pour moi. Comme on est en Ligue des champions pour la saison 2003-2004, les objectifs sont encore plus hauts et donc la demande plus forte. C’est là que tu sens que t’es dans un gros club. En championnat, ça ne se passe pas bien. En Ligue des champions, on n’a pas de chance. On tombe contre le Porto de Mourinho qui vient de gagner la Coupe de l’UEFA. On perd le premier match contre eux, on se fait rentrer dedans, alors que ce n’est QUE Porto. Sauf que, Porto, ils vont la gagner à la fin ! (Rires.) Le deuxième match, on tombe contre les Galactiques de Zizou… Au bout de deux matchs, tu as zéro point.

Alors, ça fait quoi de jouer au Bernabéu ?
C’est incroyable. Tu vois des gars qui jouent à 50% ! (Rires.) Ils accélèrent quand ils ont envie. On mène 1-0 et j’entre en cours de jeu, le coach n’était pas content de Marlet. Le pauvre, il avait les boules. J’entre, et là, c’est exceptionnel. Quand ils ont le ballon, ils font ce qu’ils veulent. C’était incroyable. Tu joues contre eux et en même temps, tu es spectateur. Tu joues contre Zidane, Ronaldo, Beckham, mais tu ne te dis pas « Je vais y aller, je vais lui mettre un tacle. » C’est très, très bizarre. Ils sont tellement forts, et toi, tu déjoues parce que tu joues contre eux. C’était une équipe de Playstation. Quand le coach, durant la causerie, met l’équipe adverse au tableau, tu te dis : « C’est quoi ce truc ! » (Rires.) Et il commence : « Bon, toi, tu t’occupes de Ronaldo. Toi, tu t’occupes de Zidane. Toi, tu fais gaffe à Roberto Carlos quand il monte. » C’est un sketch le truc. (Rires.)
Le bon côté des choses, c’est que vous êtes reversés en Coupe de l’UEFA… Avec l’épopée jusqu’à la finale contre Valence.Oui… On arrive à passer contre le Dnipropetrovsk, ça se passe bien. Il y a Liverpool derrière, je suis remplaçant pour le match aller, et ensuite, Anigo me sort du groupe. Voilà, c’est fini pour moi. Au début, il me faisait confiance, puis il a commencé à jouer en 5-4-1. Je me blesse, et Flamini commence à prendre ma place dans l’équipe. Il a son onze, et ils battent Liverpool, l’Inter, Newcastle… Les matchs sont exceptionnels.
Comment tu l’as vécu ? À l’époque, à l’OM, c’était la mode du loft et tout ça. Au début, tu ne comprends pas trop, tu te mets dans ton coin. Tu ne participes plus, t’es content pour tes potes, mais toi, t’es en dehors. Tu as un double sentiment. T’es content, mais forcément, t’es quand même déçu. Tu te dis : « Putain, je devrais y être ! » Tu regardes les matchs à la télé, tu commences à penser à ton départ, parce que tu sais que c’est fini. T’as le sentiment de ne servir à rien. Tu commences à trouver le temps long, puisque, sur la deuxième partie de saison, je ne joue plus. Ensuite, tu dois trouver une solution. Je ne me souviens même plus de la finale contre Valence. Je savais que l’OM était derrière moi, ce n’était même plus mon équipe.
Quand tu reviens à Strasbourg, en 2004, les supporters te reprochent « d’être prétentieux et d’avoir une grande gueule » . Ils avaient raison ?
Je ne sais pas ! (Rires.) Comme je râlais beaucoup sur le terrain, ils ont pu penser que j’étais un joueur avec une attitude… Il y a des joueurs qui sont des connards sur un terrain et des crèmes en dehors, et l’inverse existe aussi. Après, même moi, quand je me voyais jouer, je ne me kiffais pas de ouf non plus ! Maintenant, avec du recul et 40 ans, peut-être que si je m’étais croisé à 25 ans, j’aurais envie de me gifler. Je revenais d’un gros club comme Marseille et quand j’arrive à Strasbourg, j’ai envie que ça se passe bien. C’est mon club et j’ai envie d’en être le patron.
Tu gagnes la Coupe de la Ligue 2005, contre Caen. C’est aussi un beau souvenir, je suppose ?L’expérience de la Coupe de France de 2001 m’avait aidé, je savais comment ça allait se passer. Ce n’était pas une grosse affiche, mais bon, tu ne choisis pas. J’aurais aimé jouer une finale contre une grosse équipe, l’OM, le PSG, Lyon… Bon, on a gagné, et pour fêter ça, on avait organisé une soirée entre nous. On avait loué une salle à côté du Stade de France. C’était un grand truc, sympa. On a bien rigolé, c’était cool, quoi ! On est sortis au VIP derrière. C’était une belle soirée ! Le lendemain était un peu compliqué… J’avais la tête à l’envers !
Lors de ton retour, tu portes le numéro 18, en référence à ton frère (le numéro 10 de Frédéric + le numéro 8 de Pascal, N.D.L.R.). Tu pensais à lui durant ta carrière ? Ça a toujours été une force de me raccrocher à ça. Je me disais que le destin a fait que, là où il s’est arrêté, moi j’ai repris le truc. De toute façon, je n’étais pas fait pour ça au départ, je ne m’imaginais pas être pro. J’étais plus content pour mes parents, pour mon père qui venait voir les matchs et je pense que j’ai essayé de lui faire vivre un truc qu’il aurait dû vivre avec mon frère. J’étais content, ça n’a pas toujours été facile, j’ai dû m’accrocher. J’étais plus fier pour ça que pour moi-même. Bizarrement, ce n’est pas sur le moment que t’y penses, mais après. Tu te dis : « Ça va, j’ai gagné ça, j’ai gagné ça, c’est pas mal ! » Tu ne te rends pas compte sur le moment, mais avec le recul, tu vois le positif.
L’aventure à Strasbourg s’est un peu terminée en eau de boudin. Tu peux nous raconter ?La saison 2007-2008 était sur le point de se terminer. Il nous restait une petite chance de ne pas descendre et je ne sais pas… (Il hésite) On devait recevoir Caen et aller à Marseille pour le dernier match. Je savais que j’allais partir, je me disais : « Allez, au moins un dernier match à la Meinau ! » Je voulais me souvenir de mon premier match à la Meinau comme de mon dernier. Ça m’aurait fait plaisir de finir à Marseille, mon ancien club, ça tombait bien. La veille, je comprends que je ne vais pas jouer. On fait des exercices de coups de pied arrêtés et on me prend pour faire le mur, j’avais les boules ! Surtout qu’on devait faire une mise au vert alors qu’on était à domicile, ça m’a gonflé.
Je me suis dit : « Tu sais quoi ? J’ai même pas envie d’y aller. » Donc je vais voir le directeur sportif et je lui dis : « Voilà, je ne vais pas venir. J’assume, je ne ferai pas partie du groupe. De toute façon, je vais faire la gueule pendant deux jours, je vais être vénère sur le banc, ça ne va servir à rien. Juste, laisse-moi tranquille. S’il y a une amende, je la payerais. » J’ai dû la payer, cette amende, 4/30e de mon salaire, et j’ai eu un conseil de discipline. J’y suis arrivé, je n’ai rien dit, j’ai payé mon amende et j’ai assumé.
Tu as fini ta carrière en 2015 après quelques aventures à Metz, Grenoble et en amateur. Qu’est-ce que tu as envie de faire maintenant ?Je n’ai pas forcément d’idées. Peut-être travailler dans un club… Bizarrement, je me sens encore assez joueur. Je joue encore avec les anciens, je me régale les vendredis soir. Entraîneur, ça ne m’a jamais attiré. Plutôt travailler dans un club au recrutement, d’abord en amateur… Mais pour l’instant, je n’ai pas le truc pour le faire. Je suis trop joueur dans ma tête. Le foot, c’est ma vraie seule passion, c’est la seule chose où je pourrais être utile.

Quand tu regardes ta carrière, qu’est-ce que tu y vois ? Je suis assez content de me dire que c’est derrière moi. J’ai quand même réalisé mon rêve, ce n’est pas tout le monde qui peut en dire autant. Je suis parti de ma petite ville, j’ai joué à Strasbourg, j’ai joué à Marseille, j’ai gagné des trophées, j’ai été international espoir, mon frère était pro. C’est sûr, j’aurais pu faire mieux, j’aurais pu avoir un meilleur comportement parfois. Aujourd’hui, je suis beaucoup plus relax, beaucoup plus tranquille. Tout ceci a permis cela, certainement.
Propos recueillis par Gad Messika