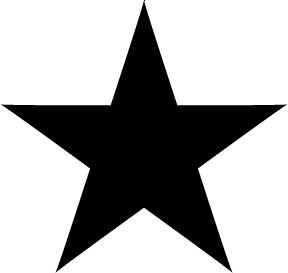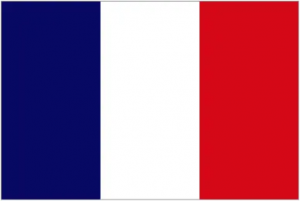- France
- Ligue 1
Marseille ou les embarras de l’identité

Qui est « mon » club si le supporter devient un obstacle à sa survie ? La crise du football français, en plus d’être sportive et économique, est donc aussi (et surtout) une crise identitaire. Enquête philosophique.
En période de tempête, la langue technocratique est pénible à entendre. Cette semaine, La Provence rapporte les mots de Hubert Ouvrard, DG de l’OM, tâchant vaillamment de chanter les mérites de son patron devant des supporters excédés par autant d’arrogance. « McCourt a renouvelé sa confiance à Eyraud. Pour lui, c’est la bonne personne à la tête de l’OM. C’est son club, il a mis 370 millions dedans, il a le droit de décider qui le dirige. Je ne vous dis pas qui doit être le dirigeant de vos associations. » Le club appartient à celui qui paie. On a bien compris le message. À Nantes, autre style, même conception du monde. Un président-actionnaire tout puissant enfonce le clou. Cette fois dans L’Équipe : « Le club est bien géré, tout le monde est payé tous les mois.(…)Un club, une société, ce n’est pas un rêve, c’est la réalité. »
Et dans les deux cas, une même contestation. Les deux présidents se voient reprocher leur stratégie de rupture avec « l’identité » du club. À Marseille comme à Nantes (ou à Bordeaux) s’opposent donc deux visions du monde : la mémoire contre le présent, la continuité historique contre la rupture. Pour les uns, la critique tient en un seul surnom : « FC Kita », pour les autres en une seule phrase : « L’OM est une religion, transmise de génération en génération, c’est un membre à part entière de chaque famille. ». Et planté au milieu de cette forêt de préjugés, un arbre comme une énigme : c’est qui MON club ? Les supporters ou le président ? Celui qui pousse ou celui qui paie ?
Qui sommes-nous ?
L’habile marketing avait prescrit jusque-là un viatique efficace. Il avait réussi la prouesse de substituer à la délicate notion de « club », celle, plus facilement identifiable (et donc commercialisable), de « marque sportive ». Ce signe distinctif avait pour principal avantage de rameuter les adeptes à peu de frais tout en proposant aux directions avides de devises une marchandise nouvelle à commercialiser. Les années 1990, sur le modèle des sports US et de Manchester United, puis du Real Madrid et de ses Galacticos en Europe, se sont donc naturellement remplies de parapluies, de slips ou de David Beckham aux couleurs sacrées des institutions adorées. Mais, prévisible phénomène, à force de reproduire les images païennes sur les lieux de culte, les marchands ont pris la place des maîtres de cérémonie, les clients celle des adeptes et la superstition celle de la foi sincère.
Désormais, à part quelques romantiques patentés, plus personne ne croit en l’idée de club. Au point même que JHE a, un jour, fini par admettre (en mettant définitivement le feu aux poudres) que le fan était même devenu un problème pour faire des affaires : « La première chose dont il faut se méfier est de recruter, je cite, un « fan in a suit » (un fan en costume, NDLR), car il aura tendance à laisser parler sa passion pour son club, son équipe, plutôt que de regarder le cap défini ensemble et qui devra être tenu coûte que coûte ». « Qui est MON club si le supporter devient un obstacle à sa survie », s’alarment donc les Marseillais depuis plusieurs mois ? La crise du football français, en plus d’être sportive et économique, est aussi (et surtout) une crise identitaire.
Ces chênes qu’on abat
Soit. Alors pour essayer d’éclairer cet étrange embarras, tentons maintenant une expérience de pensée. Prenez un club, n’importe lequel. Ensuite, retirez lui toutes les composantes provisoires. Les joueurs d’abord qui chaque saison changent. Les maillots et les logos qui varient au fil des saisons maintenant (l’écusson de l’OM a varié une dizaine de fois en 120 ans, idem pour celui du Barça), puis le stade (le Real n’a pas toujours joué au Bernabéu, l’Atlético a déménagé en 2017), les entraîneurs (une petite centaine depuis la fondation de l’OM), les dirigeants (toujours de passage), le public (idem).
Ne parlons même pas des groupes de supporters (Ultra’84 est créé 85 ans après la fondation du club) qui, par définition, ne préexistent jamais aux institutions et sont en permanente mutation. Bref, un club de football est un organisme vivant. Et comme n’importe quel chêne qui, d’une petite pousse, devient un grand arbre, le club mûrit sans qu’une seule particule de matière ne reste la même depuis sa création. Telle est peut-être la plus grande énigme de l’identité. Rien n’y demeure jamais identique. Et pourtant, cela suffit pour que nous disions que c’est un même club. Sur quel substrat immatériel repose donc cette étrange idée ?
La vie qui a réussi
La réponse est curieusement à trouver auprès d’un homme sur le point d’arriver dans la cité phocéenne. Il n’a jamais entraîné à Marseille (ni sans doute lu Bergson), mais s’apprête à y occuper le siège le plus brûlant. Lundi dernier, dans son communiqué adressé aux supporters de l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli a décrit très précisément ce qu’était un club de football. Pas un commerce, ni une église. Un club, c’est une lumière. « 2020 a été une année difficile pour l’humanité. Nous avons essayé d’être créatifs et nous avons voulu constituer une équipe qui, lorsque vous allumez la télévision, vous fera oublier la tristesse pendant un certain temps. Nous n’avons pas seulement cherché à gagner : nous avons essayé de vous rendre heureux. »
Là où le marketing sportif, tout en stimulant nos bas instincts, proposait de consommer des plaisirs éphémères, Sampaoli nous offrait une parabole fructueuse sur les communautés humaines. Un club est une joie commune, dit-il, c’est-à-dire l’exact contraire d’un plaisir consumériste par nature éphémère et substituable. Tel est peut-être le secret de la permanence de l’identité des clubs à travers les âges, les hommes et les choses : l’intarissable désir d’une communauté humaine de persévérer dans sa joie. Un club est une vie qui a réussi à grandir au-delà d’elle-même. Un club est un arbre.
Par Thibaud Leplat