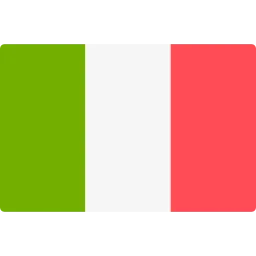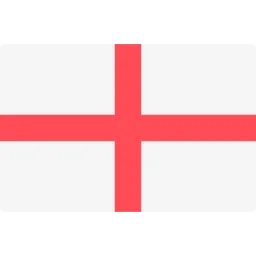- Entretien Marcello Lippi
Marcello Lippi : « Celui qui gagne, c’est celui qui réussit à pénétrer dans la tête des joueurs »

Que ce soit à la Juve, avec la Nazionale ou même en Chine, Marcello Lippi a marqué l'histoire du football transalpin et mondial par sa capacité à gagner. Alors qu’il a officiellement mis un point final à sa carrière de coach, le septuagénaire se pose pour regarder dans le rétro, mais aussi vers demain, en ce qui concerne le football italien.
Vous avez mis officiellement un terme à votre carrière d’entraîneur en octobre 2020. Pourquoi maintenant ?Quand je suis revenu de Chine au mois de septembre 2019, j’avais déjà laissé entendre que je n’entraînerais plus ou seulement une sélection nationale non loin de l’Italie. Ce que j’ai dit le mois dernier n’est pas vraiment une nouveauté : si on me propose un rôle dans un club, autre que celui d’entraîneur, je pourrais m’y atteler même si ce n’est pas une nécessité. Mais ma position n’a finalement pas tant changé que ça depuis l’an dernier.
Vous êtes l’un des coachs ayant le plus gagné au cours de votre carrière. Dans un pays qui ne jure que par cela, cela doit avoir une saveur encore un peu plus particulière ?Bien sûr. Je suis chanceux d’avoir eu une telle carrière, d’avoir entraîné un paquet de très grands joueurs et d’avoir gagné tous ces trophées. Mais parmi toutes ces victoires, si je ne devais en ressortir qu’une, remporter un mondial avec son pays n’a pas d’égal. Voir la joie de toute une nation est un sentiment unique. Et je dis cela quel que soit l’adversaire, non pas car nous avons battu les Français ! Mais pour quelqu’un qui fait ce métier, remporter la Coupe du monde est la chose la plus belle qui puisse arriver.
À quel point estimez-vous avoir pesé sur le parcours de votre équipe durant ce Mondial 2006 ?Pour dire la vérité, très peu durant le tournoi. Ce sont les années qui précèdent le coup d’envoi du Mondial qui sont les plus importantes. Il y avait dans ce groupe une force, une confiance et une unité impressionnantes. Avant le début de la compétition, nous avions gagné 3-1 aux Pays-Bas, battu l’Allemagne 4-1. On se sentait forts et prêts. Et puis le moment de vérité est arrivé, vous connaissez la suite.
Quel serait le moment qui symbolise le mieux votre succès et votre parcours durant cette Coupe du monde en Allemagne ?Je dirais que c’est ce match face à l’Australie en huitièmes de finale. On fait une excellente première période, mais on ne réussit pas à marquer. On a beaucoup d’occasions, et puis finalement, nous terminons la rencontre à dix avec l’exclusion de Materazzi à la 50e minute. Les Australiens n’ont pas d’énormes occasions, et il en fallait pour espérer inquiéter Buffon. Et puis, il y a ce penalty au bout du temps additionnel provoqué par Fabio Grosso que Totti a transformé. C’était le type de match qui pouvait autant tourner en notre faveur qu’en notre défaveur. En le remportant, j’y ai vu un signe prémonitoire. Un signe du destin.
Après la finale face à la France, vous êtes rentré à l’hôtel et vous avez revu le match. À quoi pensiez-vous à ce moment-là ?Revoir le match presque immédiatement est quelque chose que je faisais tout le temps. Juste avant, j’ai quand même pris le temps de manger et puis j’ai tout revu. J’en ai profité, mais c’est quelque chose que beaucoup de coachs font.
Mais on parle quand même là d’une finale de Coupe du monde…Mais j’ai pris mon pied à revoir ce match à ce moment-là ! Tout était parfait : j’allais rentrer chez moi après 50 jours de Mondial en étant champion du monde et heureux, l’équipe était magnifique… Alors je me suis allumé un cigare et je me suis remis la partie.
Dans la mémoire commune, la Nazionale de 2006 n’était pas forcément la plus spectaculaire de l’histoire, mais elle gagnait à la fin. Moi, je trouve que mon équipe était toujours belle à voir. (Sourire.) On a fait le record de 31 victoires consécutives (sur les deux mandats de Lippi à la tête de la Nazionale, N.D.L.R.), on a dû perdre un seul match en deux ans… Alors oui, évidemment, certains matchs étaient peut-être un peu moins aboutis que d’autres. Mais mon Italie a été comme je la voulais : pleine de croyance, de convictions et à certains moments spectaculaire. Et ça m’allait très bien comme cela. Ça ne m’intéresse pas d’avoir une équipe purement spectaculaire qui finirait deuxième ou troisième et ne gagnerait rien au bout.
Vous croyez justement qu’en cherchant à davantage jouer au football, un peu comme l’Espagne par moment, l’Italie a un peu oublié ce qui la rendait si forte par le passé ?Non, je ne crois pas. L’équipe actuelle par exemple développe un football très agréable en ayant inclus des joueurs d’origine étrangère. Quand j’entraînais, il y avait 60% d’Italiens et 40% d’étrangers dans les clubs de notre championnat. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Mais malgré cela, Mancini a réussi à trouver un équilibre en incorporant des jeunes prometteurs. Ils pratiquent un beau jeu et sont réalistes. L’équipe est superbe. Selon moi, cette Nazionale a de grandes chances de faire des résultats de tout premier ordre dans les mois et années à venir.
![]()
Quel serait l’ADN du football italien selon vous ?(Il coupe.) Mais vous, enfin les Européens, vous êtes restés bloqués sur le catenaccioitalien. C’est vrai, le catenaccioa fait partie de l’ADN du foot italien. Mais ensuite, on a vu des clubs comme ma Juventus, le Milan de Fabio Capello ou celui d’Arrigo Sacchi, pour ne citer que ces équipes, faire de grands résultats en Europe en se détachant totalement de cela. Aujourd’hui, il n’y a plus ou quasiment plus aucune équipe italienne qui pratique le catenaccio. Et c’est impossible de parler d’ADN du football italien car il y a beaucoup d’étrangers dans les équipes italiennes : il y en a parfois sept, huit, neufs titulaires, il n’existe pas cet ADN dans les clubs aujourd’hui.
La France a remporté la quasi-totalité de ses titres internationaux avec Didier Deschamps sur le terrain ou comme sélectionneur. Que pensez-vous de lui ?Pour tout vous dire, lorsque la France gagne la Coupe du monde en 1998, j’étais en contact avec Aimé Jacquet. J’étais aussi très proche de l’un de ses collaborateurs, Christian Damiano, nous échangions régulièrement avant le Mondial, car la France voulait Zidane et Deschamps pour ses matchs amicaux, mais nous avions encore la Ligue des champions à jouer (défaite en finale face au Real, N.D.L.R.). Je leur avais promis : « Ne vous inquiétez pas, ils finissent la Ligue des champions avec moi et ensuite ils seront dans une condition optimale pour le Mondial avec vous. » Après la victoire de la France, j’ai été invité à Clairefontaine pour rencontrer Claude Simonet qui m’avait remercié pour la gestion d’avant-compétition.
Pour en revenir à Deschamps, vous êtes surpris de le voir avoir ces résultats ?Je ne suis absolument pas surpris. C’est le type de joueur qui était déjà entraîneur lorsqu’il jouait. J’ai eu la chance d’entraîner énormément de joueurs, de grands joueurs. Qui sont pour certains devenus de grands entraîneurs par la suite. Pour tout vous dire : quand j’ai gagné le Mondial en 2006, dix-sept de mes joueurs sont devenus coach par la suite. Et puis, au-delà d’eux, il y a eu Antonio Conte, Paulo Sousa, Zidane… Mais pour la plupart, rien ne laissait présager avec certitude qu’ils deviendraient entraîneur après leur carrière. Deschamps, si. Il veillait en permanence à l’organisation de l’équipe, et lorsque je m’adressais à lui, il avait souvent déjà compris où je voulais en venir avant même que je ne parle.
Vous comprenez qu’il ne jouisse pas d’une immunité absolue en France malgré ses résultats ?Je ne le savais pas et je ne préfère pas le commenter. Je ne cherche pas à avoir de polémiques avec le peuple français.
Comme vous le disiez, nombre de vos joueurs sont devenus entraîneurs. Quand vous voyez jouer la Juventus d’Andrea Pirlo ou le Napoli de Rino Gattuso, vous retrouvez certains de vos préceptes de jeu ?Je pense que ce n’est pas en matière de tactique qu’il peut y avoir des points communs aujourd’hui entre un jeune entraîneur et un ancien coach. C’est davantage dans la gestion du groupe, la gestion des hommes. Ce sont ces critères là qui sont déterminants pour préparer une victoire future, ce n’est pas la tactique ou que sais-je. Et je revois ma façon de faire en beaucoup d’eux là-dessus.
Vous pensez aujourd’hui que la tactique prend une place trop importante par rapport à l’importance de la gestion d’un groupe ?Oui, je viens de le dire ! Quand je rencontre des entraîneurs ou jeunes entraîneurs, je leur rappelle que tu ne gagnes pas un match simplement en mettant en place un pressing haut ou avec des schémas de jeu. Celui qui gagne, c’est celui qui réussit à pénétrer dans la tête des joueurs. C’est celui qui parvient à mettre dans les meilleures conditions ses joueurs pour que leurs qualités exceptionnelles soient au service du collectif. Cela doit faire partie intégrante de leur méthodologie de travail, sinon, tu ne peux pas gagner.
C’est pour cela que vous rabâchiez au cours de votre carrière que le collectif primait toujours sur le talent individuel d’un joueur.Bien sûr. Il y a une chose que je répétais sans cesse à mes joueurs qui était : « Nessuno di noi è forte come tutti noi » (Aucun d’entre nous n’est plus fort que nous tous réunis). Cela n’existe pas, un joueur qui gagne des matchs à lui seul. Non, ce qui existe, c’est un groupe de joueurs au sein duquel plus tu as de grands joueurs, plus tu as de chances de gagner par la suite.
En 2006, vous aviez ce groupe ?Oui, je l’avais. La France aussi l’avait, mais elle s’est finalement inclinée aux tirs au but. C’était tout sauf étonnant de la voir en finale en face de nous. Nous avons gagné en ayant eu ce brin de chance, indépendamment de l’exclusion de Zidane. Il restait à peine cinq-dix minutes lorsqu’il a été exclu. Derrière, il y a eu les penaltys et nous les avons tous marqués. Le seul qui a manqué, c’était David Trezeguet. Mais au cours de cette séance, même avec Zidane encore sur la pelouse, Trezeguet aurait tiré quoi qu’il arrive.
Le football d’aujourd’hui, avec la VAR ou la place grandissante laissée aux statistiques, est-il le même que celui que vous avez connu ?Non, ce n’est plus le même football. Pour ce qui est des statistiques, certes j’ai arrêté d’entraîner en Europe en 2010, mais en Chine, même si le niveau est moins élevé, ils travaillent aussi avec. La VAR a détruit, accablé ce football. Il n’y a pas un dimanche où l’on se demande « Pourquoi » , comment les gens en poste qui gèrent cet outil et sont censés aider l’arbitre prennent les décisions. Même si quelques fois il faut le reconnaître, cela aide à faire les bons choix.

La VAR est-elle la cause majeure de ce changement ?Non, je répondais simplement à votre question sur la VAR. Les raisons, il y en a plein. Tous les vingt ans, tout change dans la vie. Votre télévision change, votre façon de manger, le cinéma, tout change en permanence. Le football, c’est pareil. L’Espagne d’aujourd’hui ne joue plus comme l’Espagne d’il y a dix ans, il y a beaucoup plus de verticalité. Si je devais décrire le football international actuel, je dirais qu’il y a 3-4 transmissions pour se dégager de la pression adverse pour ensuite aller toucher de façon verticale les attaquants. La majorité des équipes en ont trois ou quatre qui traversent le reste du terrain avec ou sans le ballon. C’est ça, le football international actuel.
Vous aimez ce football ?Je l’aime beaucoup ! C’est celui que j’ai essayé de proposer, sur lequel j’ai travaillé notamment lorsque j’ai eu la chance d’entraîner l’équipe chinoise la plus forte, Guanghzou. La deuxième année, on a même remporté la Ligue des champions asiatique. Pour une équipe chinoise, triompher devant des équipes japonaises, sud-coréennes ou australiennes, c’est loin d’être monnaie courante. On a réussi une belle campagne grâce aux joueurs locaux et à quelques joueurs extra-communautaires très forts. Aussi, je ne trouve pas que les joueurs d’aujourd’hui ont moins de caractère ou de personnalité fortes.
Ah oui ? Pourtant, dans la façon de célébrer des titres, on voit de moins en moins d’équipes engloutir des litres de bières ou se retrouver en caleçon.Moi, je les ai vus, les litres de bière, lors du sacre du Bayern Munich en Ligue des champions l’an dernier. (Rires.) La bière a toujours été l’un des composants d’une victoire allemande. Il y en aura toujours. Mais j’insiste : tout ça, ce n’est pas vraiment important.
Les entraîneurs italiens ont, dans l’histoire, été la référence pour n’importe quel coach. Mais depuis quelques années, ce n’est plus vraiment le cas, et des coachs allemands, portugais ou espagnols ont un peu pris le relais. Comment expliquez-vous cette perte du monopole ?Tout simplement parce que le dernier entraîneur italien qui a apporté quelque chose au foot mondial se nomme Arrigo Sacchi. Il y a eu ensuite des coachs importants comme Fabio Capello, je m’inclus au même niveau que lui, qui ont eu des succès internationaux et européens. Mais la chose la plus importante est celle-ci : aujourd’hui, ce n’est plus un football au sein duquel un entraîneur peut arriver et tout révolutionner pour que cela devienne une sorte d’école pour tout le monde. Ce n’est pas comme il y a vingt/vingt-cinq ans, quand Rinus Michels proposait un football bien spécifique avec les Pays-Bas qui est ensuite devenu la norme pour tout le monde. Je m’explique : aujourd’hui, tout le monde joue un football plutôt moderne. Ce serait très difficile de reproduire ce qu’a fait Michels, d’arriver et de chambouler le football actuel avec de nouvelles idées.
Le football est-il en train de devenir un football de plus en plus individualiste ? Celui où les méga-stars font finalement un peu ce qu’elles veulent.Je pense le contraire. Par exemple, Ibrahimović aujourd’hui à Milan peut donner l’impression de faire ce qu’il veut. Mais en réalité, il fait ce que lui dit Pioli. C’est Stefano Pioli qui le met dans des conditions idéales pour qu’il puisse s’exprimer pleinement et renvoyer cette image. Ibrahimović devient un exemple pour les autres. Si tu es réellement un grand joueur, tu mets tes qualités hors normes au service de ton équipe et tu deviens décisif. Sinon, cela ne sert à rien.
Qu’est-ce que cela vous fait de voir qu’aujourd’hui en Serie A, Ibra ou Cristiano Ronaldo, qui sont deux joueurs extraordinaires, mais proches de la fin de carrière, soient les méga-stars du championnat ? Qu’est-ce que cela veut dire de l’état du foot italien ?À première vue, cela voudrait dire que si des joueurs de 39 ans dominent le championnat, c’est que le foot italien n’est pas vraiment en très bon état, pas vrai ? La réalité, à l’inverse, est que le football italien propose une équipe nationale séduisante composée d’une trentaine de joueurs d’un très bon niveau et qui offre l’un, si ce n’est le meilleur jeu en Europe actuellement. Et ce, même si les meilleurs de Serie A sont des étrangers qui ont 36 ou 39 ans.
Comment voyez-vous le développement du football italien dans les prochaines années ?Je suis confiant, et il n’y a qu’à voir le groupe de Roberto Mancini qui est jeune et de grande qualité. Ils peuvent bien performer dès le prochain championnat d’Europe.
Dernière question : avez-vous un regret ?Je n’en ai aucun, mais si je peux m’autoriser une blague, la voilà : j’ai eu la chance d’avoir gagné toutes les compétitions auxquelles j’ai participé. Mon seul regret donc, ce serait de n’avoir jamais pu participer à un championnat d’Europe !
![]()
Propos recueillis par Andrea Chazy