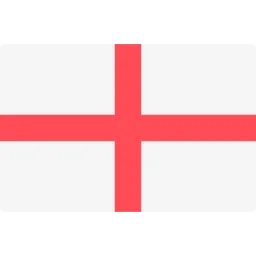- So Foot
- Hors Série "Supporters"
« L’univers des tribunes dit quelque chose de notre société »

Paru en 1990, son livre Génération Supporter, fruit de cinq années d’enquêtes auprès des supporters européens, est devenu mythique parmi les acteurs et les observateurs des tribunes. Depuis, Philippe Broussard a continué à suivre le monde des supporters, en tant que journaliste au Monde puis à l’Express, où il est aujourd’hui chef du service « Enquêtes », mais aussi en tant qu’amateur de football et supporter du PSG. À l’occasion de la réédition de Génération Supporter avec le Hors-Série Supporters de So Foot, Philippe Broussard revient sur la genèse de son ouvrage et sur les transformations des tribunes françaises et européennes. Après les quelques extraits publiés dans le magazine, sofoot.com livre les meilleurs moments de cet entretien, en version longue et en deux volets.
Quels ont été les éléments déclencheurs de ce voyage dans un monde alors inconnu du grand public ?
Des raisons à la fois personnelles et professionnelles. Personnelles, parce que je me suis toujours intéressé au foot et que j’ai commencé à aller très tôt au Parc des Princes. Mon premier match, c’est celui de la montée en première division, le barrage PSG-Valenciennes en 1974, où Just Fontaine, alors entraîneur, fait une alerte cardiaque. Toute la deuxième moitié des années 70, alors que je suis lycéen, je vais au Parc, à Boulogne, qui n’était pas encore la tribune qu’elle est devenue ensuite. Je baigne donc dans cette ambiance supporter. Surtout, je suis fasciné par le foot anglais et ses fans. Je connaissais les noms des stades des 80 clubs pros ! Parallèlement, je fréquente aussi la scène musicale punk et skin non raciste, en France et en Angleterre, avec des groupes comme Angelic Upstarts ou Cockney Rejects, des Londoniens fans de West Ham. D’une certaine manière, j’ai un peu grandi entre tribunes et salles de concert. Automatiquement, je m’intéressais à ces cultures. Devenu journaliste, j’ai continué à m’intéresser au football et au monde des supporters à titre personnel, mais aussi à titre professionnel. Ce mélange perso-pro, pour moi, a toujours existé.Après, il y a d’autres éléments déclencheurs importants. Notamment un, vraiment décisif à mes yeux. Lors de ma dernière année au Centre de Formation des Journalistes (CFJ), on avait deux semaines de vacances, au printemps 1985. Avec un de mes copains de promotion, Claude Askolovitch [aujourd’hui au Point, ndlr], on décide de partir tous les deux à Liverpool – un rêve de jeunesse – pour faire des sujets sur les deux clubs de foot de la ville et les vendre à des journaux. On part là-bas sur nos propres deniers d’étudiants. Claude fait des sujets sur Everton et moi sur les Reds, en particulier le Kop, qui ne comportait alors aucune place assise. Au retour, on finit notre année au CFJ, et nos articles sont publiés dans différents journaux et magazines. De mon côté, j’étais en contact avec Le Matin de Paris pour y signer après l’été, au service des sports. À la fin du mois de mai 1985, alors que j’étais encore pigiste, ce quotidien me demande, un peu en urgence, d’aller couvrir la finale Liverpool-Juventus, un mercredi soir, à Bruxelles. Là, j’ai vécu la catastrophe du Heysel. L’horreur absolue.
Comment as-tu vécu ce drame ?
J’étais très jeune, presque 22 ans. J’étais pour la première fois envoyé spécial d’un journal. Et il se passe ce drame dans les tribunes. En plus du choc émotionnel, j’avais la pression pour envoyer le papier, que je devais boucler à 22 h 15. Ça a été un gros moment de frayeur. J’avais passé toute la journée avec les Anglais, dans Bruxelles. Je les avais déjà vus en 1984, à Paris, lors d’un France-Angleterre qui connut son lot d’incidents. Je venais de les voir à Liverpool, au cœur du Kop, pour la demi-finale contre le Panathinaïkos. Je commençais donc à bien connaître le milieu des fans anglais. En ville, ce jour-là, il y avait une ambiance de tension et de violence qui laissait présager quelque chose. Après, personne ne pouvait imaginer que la partie basse de la tribune s’écroulerait sous le poids des spectateurs paniqués. Parce que n’oublions pas que le drame est dû à un double phénomène : les mouvements de foule provoqués par les hooligans, mais aussi la vétusté du stade, inadapté à un tel événement.À mon retour du Heysel, j’ai eu d’autres articles à écrire sur la France et la violence, notamment sur le Kop de Boulogne qui, à l’époque, faisait de plus en plus parler de lui. C’est là que j’ai vraiment commencé à embrayer professionnellement sur ces thèmes.
Comment as-tu réussi à entrer en contact avec ces supporters qui ont la réputation d’être plutôt hostiles aux journalistes ?
J’ai commencé par des papiers sur Paris. Comme c’est un milieu que je connaissais bien, j’ai acquis assez vite une forme de crédibilité auprès des supporters. Ensuite, mes contacts parisiens m’ont permis de connaître deux cadres historiques des Brigate Rossonere à Milan, Gabriele et Iappo. Ils ont joué un rôle important dans la suite des événements. C’étaient deux personnes très intelligentes, très cultivées qui ont compris ma démarche et m’ont fait confiance. C’est notamment par eux, et par Fabio Bruno, un ami génois supporter de la Sampdoria, que je suis entré dans le milieu ultra. Ensuite, ces différents contacts italiens m’ont permis de rebondir en Belgique auprès de siders, et tout s’est enchaîné naturellement, par des liens de cooptation. Je ne débarquais pas en disant : « Coucou, c’est moi, je suis journaliste français » . À chaque fois, j’étais recommandé par quelqu’un du milieu supporter. Sauf pour les Allemands. Là, j’ai eu la baraka. Le premier contact date d’un France-Allemagne à Montpellier en 1990. Je ne connaissais pas du tout le hooliganisme allemand à l’époque. J’étais resté sur l’image du supporter allemand avec les écharpes, les blousons en jean et les écussons. À l’Euro 88, j’avais vu les hooligans allemands à l’œuvre contre les Anglais, mais je n’avais pas réalisé ce qu’était l’organisation à l’allemande. Ce soir-là, avant la fin du match France-Allemagne, un groupe de hools provoque des incidents en tribune avant de sortir du stade montpelliérain. Je les suis dans le quartier de la Paillade. Dans les mouvements de foule, je commence à discuter avec l’un d’eux. J’ai eu du pot parce que j’aurais pu être pris pour un flic en civil et ça aurait pu mal tourner. Mais ça a collé. Je lui ai dit : « Je suis journaliste, j’aimerais voir comment ça se passe en Allemagne » . Le gars m’a laissé son numéro. C’était un mec du Borussen Front, les hooligans de Dortmund. Grâce à lui, j’ai pu me rendre sur place et appréhender le phénomène allemand.
Tu n’as jamais été pris pour un flic en civil ?
Si, en Italie, à la suite d’un reportage sur les ultras de Vérone, des néo-fascistes. J’avais obtenu leur contact par Fabio Bruno, qui m’a beaucoup aidé parce qu’il travaillait pour Supertifo le magazine de référence dans ce milieu. Quelques temps après, une vaste opération policière a visé les ultras de Vérone. Parmi les gars que j’avais rencontrés, certains ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines. Persuadés que j’étais un flic en civil, ils croyaient être en prison à cause de moi ! Fabio a dû monter au créneau pour leur dire: « Non, non, regardez, il est vraiment journaliste, il met bien des noms d’emprunt quand il parle de vous dans ses articles, etc. » Après, il y a eu des situations un peu chaudes où je me suis dit qu’on pouvait me prendre pour un flic en civil. Mais je n’ai pas eu cette sensation très souvent. Globalement, j’avais le bénéfice de l’âge et l’avantage de connaître ce milieu, parfois assez parano. Et puis, lors de mouvements de foule, et de charges de flics, je ne sortais pas ma carte de presse, je courais dans le même sens que les autres. Tu sais, il y a tout un art de courir dans le même sens… À contre-sens, ou trop isolé, tu te fais repérer, et cela peut devenir dangereux.
Comment tu expliques que tu aies été le premier journaliste français à vraiment traiter ce sujet ?
Il ne faut pas voir là une forme de censure de la part de mes confrères. Simplement, la plupart d’entre eux ignoraient tout de ce monde et rechignaient à s’y intéresser. Comme si cela ne concernait pas le foot. Ce phénomène, nous l’avons un peu retrouvé au sujet des banlieues. À une époque, tu avais l’impression, dans les rédactions, que le fait d’envoyer un journaliste dans les cités revenait à envoyer un reporter de guerre à Kaboul ! Pour les supporters, il y avait, chez les journalistes, un mélange de méconnaissance et de difficulté à nouer contact avec ce monde. Ce qui était paradoxal, c’est que, de mon côté, j’avais le sentiment que ce n’était pas spécialement compliqué de voir les gens, de leur parler. Pour moi, c’était très naturel. Bien sûr, je rencontrais des gens qui étaient parfois à la limite de la légalité, qui parfois se tapaient dessus, mais ce n’étaient pas non plus des terroristes. Mes collègues me demandaient : « Comment tu fais pour avoir des contacts ? » . De leur côté, ils avaient l’habitude de rester en tribune de presse et donc d’ignorer le monde des virages. Je les comprends, ils faisaient leur boulot en se limitant au match, au côté sportif. Moi, je devais passer pour un hurluberlu à aller avec les types derrière les buts.
Le projet du bouquin, il vient comment ?
Progressivement, j’ai eu le sentiment d’avoir des tas de souvenirs, d’archives, de rencontres que je désirais raconter. J’ai donc songé à un format plus long. Un jour, un éditeur de Robert Laffont m’appelle en m’annonçant : « On rêve d’une biographie de Guy Roux. » Nous déjeunons, il me parle de l’entraîneur d’Auxerre, puis s’arrête : « Je ne vous sens pas trop chaud. » Je lui réponds : « J’ai autre chose à vous proposer : un livre sur les supporters, le sujet n’a jamais été traité en France. » Il me dit banco. J’ai eu carte blanche totale.
Qu’est-ce que tu voulais montrer à travers ce livre ?
Mon but était de raconter ce monde tel que je le voyais, avec ses bons et ses mauvais côtés, sans clichés. C’est vrai que parmi ces supporters, certains font des conneries, il y a parfois une forme de violence, mais le phénomène est plus complexe qu’il n’y paraît. L’univers des tribunes dit quelque chose de notre société, de l’époque, des jeunes. Mais pour le savoir, il faut aller au-devant d’eux, les suivre. Après, tu peux critiquer, mais tu dois faire la démarche de comprendre. L’essence même du journalisme, c’est cela : « Je vais voir, je raconte » .
Dans « Parmi les hooligans », Bill Buford décrit la même scène que toi en Sardaigne avant Angleterre-Pays-Bas en 1990. Mais sa version est beaucoup plus sensationnaliste que la tienne.
C’est vrai que nous ne montrons pas la même chose. Je me suis d’ailleurs permis de faire une chronique de son bouquin dans le Monde où je lui reprochais d’en rajouter sur ce match du Mondial 1990. Que lui ait vécu ces violences comme il les décrit, c’est possible, parce qu’il était novice dans ce milieu. Mais je crois qu’il faut se méfier de l’effet de loupe, du côté « grossissant » de toute sur-médiatisation. Le hooliganisme est un monde de l’apparence où il faut savoir faire la part des choses. La véritable apocalypse, je l’avais vécue au Heysel. Quand tu vois les mecs qui chargent et ensuite les gens qui étouffent puis les morts alignés par dizaines devant toi, là tu te dis : « J’ai vécu quelque chose d’apocalyptique » .
Certains ont dû te reprocher de cautionner la violence.
La question de la violence, je me la pose tout au long du bouquin, et même encore aujourd’hui. J’étais parfois témoin d’actes de violence. Je ne participais pas, mais j’étais là, c’est vrai. Et je me demandais : « Quelles sont tes limites ? Est-ce que tu ne fais pas leur jeu ? Est-ce que tu ne contribues pas à amplifier le phénomène ? » . Des gens me l’ont reproché, y compris des copains. Ils me disaient : « C’est bien, on apprend des choses en te lisant, mais quelque part tu leur fais de la pub » . J’ai toujours assumé et répondu : « Non, je raconte une réalité, qu’elle plaise ou non » . Ce n’est pas pour autant que je cautionne ce qu’ils font. Avec une règle, tout de même : je ne voulais pas que ma présence incite les gars avec lesquels j’étais à provoquer des incidents, juste pour être cités dans le journal ou dans le bouquin. Ce n’est jamais arrivé. Certains de mes confrères ont cédé à la tentation… À la fin des années 80, les médias ont beaucoup parlé du Kop de Boulogne. Il y a eu plusieurs reportages télé qui, selon moi, étaient plus que « limite » . On sentait que les mecs de Boulogne qui acceptaient d’être filmés, et qui d’ailleurs n’étaient pas forcément les plus crédibles, avaient un intérêt à faire parler d’eux. Du côté des télés, on avait dû passer un ou deux billets ici ou là…
Est-ce que tu t’es fait peur parfois ?
J’étais sans doute inconscient, et emporté par mon boulot, mais j’ai rarement craint pour ma sécurité. Sauf en Allemagne, à Bochum. Là oui, j’ai eu la trouille. J’étais seul. Les bastons éclataient de tous les côtés. Il faisait nuit. Le type du Borussen Front que j’avais connu à Montpellier avait disparu. Là, tu te dis que si les mecs te tombent à dix dessus, ça peut mal se passer. Mais bon, j’étais habitué aux situations tendues, notamment dans les concerts skin. J’avais aussi bossé sur des manifs très violentes à Paris, en particulier en 1986, à l’époque de la mort de Malik Oussekine. J’avais l’habitude d’être dans des milieux sous tension et d’évaluer les risques. Il est arrivé un moment où ma connaissance du milieu des supporters m’a permis de repérer, dans une masse de fans, les 50 qui allaient bouger. Je n’avais aucun mérite : n’importe quel fan initié sait à quoi s’en tenir en pareil cas. Tout se devine dans les regards, les attitudes… En tout cas, je ne me suis jamais retrouvé dans une situation de griserie personnelle face à la violence. J’ai plutôt connu des moments de griserie professionnelle en éprouvant cette sensation : « Là je suis vraiment au cœur du truc. Je vois ce qui se passe, je vais pouvoir le raconter à mes lecteurs. »
Outre le Heysel, tu as vécu d’autres tragédies. Par exemple, le recueillement à Anfield le lendemain du drame d’Hillsborough. Dans le livre, tu écris : « Jamais il ne m’avait été donné de vivre moment plus intense » .
J’ai vécu ce moment de manière très intense, en effet, du fait de mon histoire personnelle. Liverpool a toujours été pour moi un club particulier. Dans les années 70, à la télévision, dans les premiers articles de magazine, ce que je regardais, c’était le Kop, la tribune de référence. Le Liverpool FC incarnait les supporters de foot. Le fait de revenir dans cette ville, à nouveau dans des conditions terribles, alors que j’avais déjà vécu le Heysel, ça a été pour moi un moment très fort.
Et trois ans plus tard, tu es à Furiani quand ça s’écroule…
J’étais là-bas pour le Monde, installé sur la rangée réservée à la presse, à côté de Gilles Verdez, qui était à l’époque au Parisien. J’étais assis sur un siège en plastique un peu moulant, qui, d’une certaine manière, m’a sauvé la vie. Car je suis tombé de toute la hauteur de la tribune, environ 15 mètres, mais par à-coups, et sans jamais quitter ce siège. Heureusement, sinon les armatures de fer me seraient tombées dessus et je ne serais plus là pour en parler. J’ai été évacué assez rapidement à l’hôpital d’Ajaccio. Je me souviens d’un hôpital en état de guerre. Des gens partout dans les couloirs, certains avec des morceaux métalliques en pleine cuisse. Je suis arrivé à l’hôpital vers 21 heures. Je n’ai pu passer une radio que vers 4 ou 5 heures. Autant d’heures sans savoir ce que j’avais, sans savoir si mon incapacité à marcher serait définitive ! Ce sont des moments d’angoisse terrible. En fait, j’ai subi un déplacement du bassin. J’ai été allongé pendant deux mois puis j’ai dû faire pas mal de séances de rééducation. Pendant ces moments douloureux, j’ai reçu des messages de soutien d’ultras de toute la France qui avaient aimé mon livre.
Quand Marseille part en émeute contre les hooligans anglais, en juin 1998, tu es là aussi…
Je suis arrivé sur place la veille d’Angleterre-Tunisie. Les Anglais ont débarqué sur le Vieux Port et très vite, j’ai vu des Marseillais chercher le point d’accrochage. J’ai reconnu des leaders du Vélodrome, mais aussi des policiers en civil qui laissaient plus ou moins faire les Marseillais. Assez vite, c’est parti en couille. D’autant que certains Anglais, minoritaires, n’attendaient que ça. L’image qui me reste en tête est celle d’un Anglais réfugié près de la gare, coincé par un groupe de locaux. Ils lui ont arraché son pantalon et l’ont traîné sur des mètres et des mètres. C’est une nana qui l’a sauvé en criant : « Lâchez-le! » Ils étaient en train de le lyncher. C’était fou. On avait vraiment le sentiment que certains quartiers n’étaient pas sous contrôle policier. Je l’avais écrit dans le Monde. Ça m’avait d’ailleurs valu un coup de fil courroucé du préfet. Peu importe, je persiste : ce jour-là, la police a été nulle.
Propos recueillis par Nicolas Hourcade, Franck Berteau et Damien Jeannes.
Demain, deuxième volet de l’interview de Philippe Broussard : les transformations des tribunes, le rôle des ultras, le cas parisien.
Lire : Génération Supporter édité en 1990 aux éditions Robert Laffont, épuisé.Réédité en 2011 par So Press, disponible uniquement en kiosque avec le magazine Hors-Série « Supporters » de So Foot.
Lire : La deuxième partie de l’interview de Philippe Broussard
Euro 2025 : quatre équipes pour décrocher la lunePar