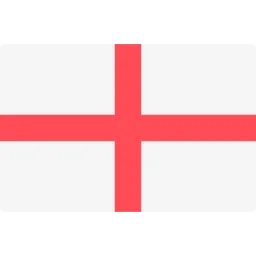- En route vers l'Euro 2016
- Top 100 Espagne
- N°5
Luis Suárez : « La boucherie, ce n’était pas ma tasse de thé »

Entre un rendez-vous matinal pour une prise de sang et l’heure du déjeuner, Luis Suárez Miramontes se donne toujours du temps pour discuter de sa grande passion, le football. Passé par l’Espagne, puis l’Italie, le Ballon d’or 1960 aura caressé la gonfle comme un vase en porcelaine. Entretien avec une légende vivante de 80 ans.
Luis, vous êtes 5e de notre classement des joueurs espagnols les plus marquants de l’histoire, félicitations. Comment se passe votre vie aujourd’hui ? Aujourd’hui, je ne travaille plus ! Il y a deux ans, j’étais encore au sein de l’Inter Milan en tant que conseiller. Maintenant, la vie est plus tranquille. Je travaille simplement en tant que consultant pour Radio Barcelona, et je vais voir du football quand cela est possible. Peu m’importent l’heure et l’endroit, même si je dois être plus attentif à mon état de santé désormais.
Quand vous sortez à Milan au supermarché ou au cinéma, est-ce que les gens savent vraiment qu’ils ont face à eux une légende du football ?Sincèrement, je pense que oui ! Dans la ville, et surtout dans la zone où je vis, les gens me connaissent et savent qui je suis. Je reçois souvent des compliments, des supporters de l’Inter comme de personnes qui supportent d’autres équipes. Quand on me parle de « la Grande Inter » , c’est forcément très agréable… Mais je préfère me fondre dans la foule et être considéré comme un Milanais. Je fais mes courses habituelles, je ne mène pas une vie de château. J’aime être tranquille, c’est plus ma philosophie.
Vous êtes milanais d’adoption, mais votre histoire commence à La Corogne, votre père était charcutier… Comment s’est passée votre jeunesse là-bas ?C’est drôle, parce que tout a aussi commencé de façon très tranquille. C’était un quartier modeste, un milieu de travailleurs. De là, j’ai commencé à jouer au football très petit. La Corogne à l’époque, c’était différent d’aujourd’hui, tu avais plein de champs pour pratiquer le football, les routes sont venues ensuite. J’ai joué donc, et puis j’ai progressé, jusqu’à ce que je puisse intégrer les jeunes du Depor. Au total, j’ai dû jouer deux ou trois ans avant de pouvoir rentrer au sein du groupe professionnel.
Le football, c’était un moyen pour vous de trouver un métier qui vous plaise ?Oui, mais il fallait y mettre beaucoup, beaucoup d’envie. Mon père m’a toujours aidé dans ce sens-là. J’avais deux frères plus âgés que moi, et je les voyais aussi jouer au football. Je trouvais toujours du temps pour m’entraîner avec eux si je pouvais. Quand l’école était finie et que j’avais fait mes devoirs, la fin d’après-midi, c’était football. Avec les amis, les frères, ceux qui voulaient. On prenait un ballon et on jouait dans la rue. Dès tout petit, indiscutablement, le foot était ma passion. J’aimais bien regarder du sport et en faire, mais celui qui me tenait le plus à cœur, c’était le foot. Bon, j’avais bien un niveau assez bon en ping-pong et j’aimais jouer parfois aux échecs, mais là où je prenais le plus de plaisir, c’était avec un ballon. Dans le cas contraire, j’aurais sûrement suivi les traditions familiales. Même si la boucherie, ce n’était pas ma tasse de thé (rires) !
Le Deportivo La Corogne, c’est votre premier club professionnel, à 18 ans. Quelles étaient vos ambitions à cette époque ?Mon objectif, c’était de jouer au Deportivo La Corogne. Savoir si j’avais le talent pour jouer plus haut ou non, ce n’était pas une question à me poser, parce que rien n’était acquis. Le défi, c’était de porter ce maillot en première division. Quand j’ai commencé à jouer, c’était déjà un rêve pour être franc. D’ailleurs, le cadre était plutôt spécial pour ma première, c’était face au Barça à Les Corts. Nous avions perdu 4-1, mais j’avais tapé dans l’œil des dirigeants du FC Barcelone. En vrai, le Barça s’intéressait beaucoup à l’attaquant Dagoberto Moll avant le match, mais ils m’ont aussi vu ce soir-là pour la première fois. En fin de saison, Moll partait pour le Barça et moi aussi. J’ai dû jouer 13 ou 14 matchs pour le Deportivo au total, mon ascension nationale s’est faite en six mois. Et le premier match que j’ai joué avec le Barça, c’était contre… le Depor !
En six mois donc, vous n’avez pas le temps de croiser Helenio Herrera comme entraîneur, en 1953…Non. J’étais trop jeune à ce moment-là et je ne jouais pas encore chez les pros. Je l’ai seulement connu à partir de ma troisième année au sein du Barça.
Le Barça repère votre talent, vous signez dans le club à 19 ans. C’était un sacré changement de dimension…(Il coupe) C’est un vrai changement. À cette époque, il n’y avait pas tous les jeux vidéo ou même les matchs retransmis en direct à la télévision. Pourtant, on savait bien que le Barça était un club différent des autres. Quand le Barça venait jouer à La Corogne et que j’étais jeune, je venais demander des autographes aux joueurs… En six mois, j’étais de l’autre côté. C’était vraiment une chose incroyable pour moi.
Comment les dirigeants du Barça vous ont-ils convaincu ? Oh, ils n’avaient pas franchement besoin de me convaincre, c’est plutôt moi qui devais les convaincre (rires) ! Envisager de jouer au Barça, c’était une vraie merveille. Au moment où j’arrive, nous étions toujours à Les Corts. Le projet de construction du Nou Camp n’était pas encore en état de marche…
Est-ce que vous auriez pu signer au Real ?Je savais que le secrétaire technique du Real Madrid était venu me voir jouer à La Corogne, une fois. Mais ce match-là, je n’avais pas été très brillant… Je pense qu’ils ne m’ont pas retenu. Ce qui est sûr, c’est que le Barça a plus insisté pour me faire venir chez eux. Je pense avoir été chanceux que Moll soit aussi dans le viseur du Barça. Le club que j’avais dans le cœur, c’était celui de ma ville à ce moment. Choisir entre le Real ou le Barça, c’était une question que je ne m’étais pas posée.
Au Barça, vous côtoyez notamment la grande star de l’époque, Laszlo Kubala. Qu’avez-vous appris à ses côtés ?Beaucoup, vraiment beaucoup. C’était un joueur avec une excellente technique individuelle, et il aimait pratiquer son sport sans retenue. Il aimait travailler sa rapidité, son efficacité, ses dribbles. Nous étions tous habitués à faire deux entraînements par jour au Barça. Mais parfois, on souhaitait aussi s’entraîner en fin d’après-midi. Nous y allions à 4 ou 5, et on travaillait les mouvements, les phases d’attaque. Un gardien de la réserve venait aussi, et de ces entraînements, j’ai appris beaucoup. Kubala, c’était un homme déterminé. Le lundi, quand c’était le jour des bains et des massages, lui sortait sur le terrain et jouait toujours avec le ballon pour travailler ses mouvements, sans forcer, mais il le faisait. C’était un joueur qui faisait plus que les autres, et cela m’a beaucoup servi pour la suite de ma carrière.
La première au Nou Camp, vous y étiez. Quel effet cela faisait de voir un stade aussi grand rempli de spectateurs à la fin des années 50 ?L’inauguration de 57 était juste merveilleuse à voir. Notre ancien stade de Les Corts, c’était une enceinte très petite, où tout le monde était proche du terrain, il y avait un vrai contact avec les gens. C’était très agréable bien sûr, mais le FC Barcelone cherchait à grandir sur la forme. Arriver sur un terrain si grand et admirer les tribunes du Nou Camp pleines pour notre premier match, c’est fantastique, même l’une de mes plus belles émotions sportives. Ce stade, c’était ce qui allait nous permettre de franchir un palier et réaliser des parcours sportifs encore plus importants.
De votre côté, votre importance augmente au fur et à mesure des années au sein du Barça, vous devenez un cadre de l’équipe où vous trouvez Helenio Herrea de 1958 à 1960…La concurrence était déjà très forte au milieu de terrain. Les joueurs titulaires étaient choisis chaque semaine, et les autres ne participaient pas au match… En clair, soit tu étais dans le onze, sois tu étais spectateur ! Quand Helenio est arrivé, il a commencé par faire des tests individuels pour chacun d’entre nous. Quand mes tests étaient terminés, il est venu me voir et m’a dit : « Luis, j’ai confiance en toi et je vais te faire jouer. J’espère que de ton côté, tu es prêt et que tu répondras à la confiance que je te donne. » Quand la saison a débuté, j’étais titulaire d’entrée de jeu. Et pour être honnête, je pense avoir très bien répondu à la confiance que Helenio m’a donnée. Cela m’a vraiment fait franchir une nouvelle étape dans ma carrière. Helenio Herrera est devenu un père pour moi. Jouer aux côtés de stars comme Kocsis, Czibor, Kubala, Evaristo, Eulogio Martínez, Villaverde… On avait une attaque de feu et c’était très compliqué de jouer ! Mais Helenio a gardé confiance en moi, cela m’a donné encore plus d’envie. Je le remercie encore aujourd’hui.
Comment êtes-vous parvenus à prendre le dessus sur le Real Madrid d’Alfredo Di Stéfano, la meilleure équipe du monde à l’époque ?Ohlala, c’était un rival terrible… Pendant deux ans, nous avons gagné deux championnats consécutifs, parce nous aussi, nous possédions une équipe fabuleuse. C’était même dommage, parce qu’à l’époque, seul le champion d’Espagne était convié à la Coupe des clubs champions (actuelle C1, ndlr). C’étaient deux équipes exceptionnelles, et il fallait toujours déplacer des montagnes pour vaincre le Real Madrid.
Votre relation avec Di Stéfano était très forte, c’était votre idole. Comment se fait-il que votre collaboration sur le terrain n’ait pas donné plus de titres à l’Espagne ?C’était plus un concours de circonstances qu’autre chose si l’on observe bien. En 1960, l’Espagne refuse de participer à l’Euro en URSS pour des raisons politiques. Les relations diplomatiques étaient inexistantes à l’époque, et Franco n’a pas voulu entendre parler de cet Euro. Je pense vraiment que nous aurions pu le gagner… En 1962, nous partons au Chili sans Di Stéfano, qui s’était blessé avant de partir. Avec lui, nous aurions pu réaliser un meilleur parcours. En vrai, il nous manquait toujours quelque chose pour remporter une compétition, c’était assez bizarre.
Don Alfredo vous surnommait l’Architecte quand il jouait avec vous dans la Roja… Quels sont les joueurs d’aujourd’hui qui, comme vous, pourraient mériter un tel surnom ? Avec Di Stéfano, nous avons débuté ensemble en sélection espagnole, contre les Pays-Bas à Madrid. Ensuite, j’ai joué beaucoup de matchs avec lui… Bon, je ne vois pas beaucoup de joueurs actuels dans le même style de jeu que moi à l’époque. Mais celui qui me ressemble le plus dans cette catégorie, c’est Pirlo. Nous avons des choses en commun, même si nous ne sommes pas égaux. Je ne crois pas que la similitude parfaite entre deux footballeurs puisse exister.
Votre élégance combinée à vos succès avec le Barça vous font devenir Ballon d’or en 1960, à 24 ans. Qu’est-ce que l’on ressent au moment de recevoir ce trophée ?La sensation était belle, mais je vais te dire une chose. Comme on ne donnait pas autant d’importance à cette récompense à l’époque, ce n’était pas aussi dingue qu’on puisse le penser. Un correspondant sur Barcelone m’avait expliqué en toute discrétion que le club allait être prévenu et que j’allais gagner. Le directeur de L’Équipe est effectivement venu à Barcelone pour voir un de mes matchs de Liga, puis il est descendu des tribunes à la fin du match pour me remettre le Ballon d’or. Et voilà, c’était fini ! C’était un trophée important, mais comme la médiatisation n’était pas la même, on avait l’impression que cela était un trophée comme un autre, après un match de football… Par la suite, le Ballon d’or a gagné de l’importance grâce à la publicité. Mais là, c’était une remise tout à fait normale. Pourtant, c’est vrai que cela reste beau : quand tu es élu meilleur joueur européen de l’année, ce n’est pas rien.
C’est à partir de ce moment que l’on vous a appelé Gallego de Oro (Galicien d’or, en VF) ? Non, c’était un peu avant. Quand je suis arrivé à Barcelone, il fallait me trouver un surnom et c’est tombé sur ma région. J’étais d’ailleurs très heureux de ce surnom, parce qu’en Galice, les gens émigrent beaucoup et partent en Amérique du Sud. Par exemple, les trois frères de mon père sont tous partis vivre à Buenos Aires, quand mon père a décidé de rester… Porter ce nom galicien un peu partout, c’était honorifique. Et d’ailleurs, mon homonyme qui joue en ce moment au FC Barcelone, tu le connais, n’est-ce pas ? Eh bien son père vient de Galice, et il a émigré en Uruguay. Suárez, c’est un nom très connu en Galice. Et son père m’a aussi dit que s’il s’appelle Luis, c’est de ma faute (rires) !
France Football vous décrit avec ces mots : « L’autorité d’un duc, la précision d’un géomètre et la beauté d’un Apollon » . Avec les filles, ça marchait aussi bien qu’au foot ? (Rires) Non, pas ça ! Avec les filles, cela se passait de façon très normale. C’était seulement sur le terrain de jeu, parce que j’étais un joueur élégant dans la course, dans la façon de jouer. Je les remercie pour ces mots en tout cas.
Malgré votre finale perdue face à Benfica, vous décidez de partir à l’étranger, une chose jusque-là impensable pour un joueur espagnol… C’est cette amitié avec Herrera qui vous a dirigé vers l’Inter Milan ?Oui, très certainement. En tant que footballeur en Espagne, j’étais bien, je gagnais bien ma vie. C’est vrai que le départ à l’étranger n’était pas dans les mœurs de l’époque. Mais comme Helenio est arrivé à l’Inter et que notre relation était très forte, j’ai étudié la proposition. J’ai pensé à ce que cette équipe pouvait faire dans le futur, et à ce que je souhaitais faire aussi. Et après réflexion, j’ai compris que j’étais le joueur idéal pour ce qu’Herrera souhaitait mettre en place. L’Inter avait vraiment fait le forcing pour réaliser le transfert. J’étais déjà très reconnaissant envers mon ancien entraîneur et je m’apprêtais à prendre un risque : j’étais dans un club issu de l’élite mondiale, et je signais au sein d’une équipe plus normale. Mais Helenio était vraiment convaincant. Je me suis dit : « Allez, tentons le coup ! Et puis qu’est-ce que j’ai à perdre ? Je n’ai plus grand-chose à faire au Barça, parce que je l’ai déjà fait. » Donc je me suis lancé.
En Italie, vous n’appréhendiez pas de vous retrouver à parler une autre langue ? Le monde n’était pas aussi mondialisé que maintenant…Oui, mais l’italien est issu de racines communes. Et comme Herrera était sud-américain, je savais que je pouvais parler de tout avec lui sans problème. En vérité, j’appréhendais plus le fait de ne pas être à la hauteur des attentes (l’Inter avait payé 250 millions de lires, transfert le plus cher du Calcio à l’époque, ndlr). Quand les gens voient certains chiffres, ils pensent que tu es capable de faire l’impossible. Malgré une blessure au départ, Herrera est tout de suite venu me rassurer. Je me suis adapté sans problème, c’en était même surprenant.
À Milan, le derby della Madonnina était aussi l’occasion de voir une opposition entre vous et Gianni Rivera, la star du Milan AC. Comment voyiez-vous Rivera pendant ces matchs ? Rivera était un grand joueur, aucun doute là-dessus. On sentait qu’il avait de grosses facilités intellectuelles et techniques, une vision du jeu rarissime. Mais pour être franc, cette rivalité n’était pas mauvaise entre nous, elle était saine. À l’époque, l’Inter était surtout dans une grosse confrontation avec la Juventus.
Rivera, c’était aussi fort que Di Stéfano ? Non, je ne crois pas. Rivera est au même niveau que moi, mais il n’est pas à la hauteur de Di Stéfano. Je dis toujours que j’admire Di Stéfano, et je l’admire encore. Pour moi, trois joueurs sont au-dessus des autres : Di Stéfano, Pelé et Maradona. Ces trois-là, nous les regardons tous d’en bas.
Lors de votre arrivée en Italie, vous dites aux journalistes que vous voir à la télévision, cela vous rendait plus vieux… Vous pensez avoir eu le rôle de père spirituel de Facchetti ou Mazzola par exemple ?Oui, tout à fait. Ces joueurs étaient issus des catégories de jeunes de l’Inter, ils s’intéressaient beaucoup à moi, parce que je venais du FC Barcelone et que j’avais déjà un statut avec ce Ballon d’or. Ils me suivaient beaucoup et j’étais un peu un phare dans leur progression, je leur donnais toujours des conseils. Et puis un jour, les élèves ont dépassé le maître (rires) !
Vous avez aussi dit : « La chose la plus importante que j’ai faite à l’Inter, ce n’était pas le terrain, mais en dehors. » C’est-à-dire ? C’était plus pour expliquer mon implication dans l’équipe. Je parlais de mon comportement au quotidien, de l’exemple à suivre, d’être le premier à arriver et le dernier à partir, avoir une vie saine en dehors du football… Tout cela est important pour des jeunes joueurs, ça leur montre la voie à suivre. De cette manière, ils voient que tu continues à être irréprochable pour gagner des titres. Cela a même construit notre équipe.
Vous atteignez le zénith de votre carrière en 1964 : votre première Ligue des champions avec l’Inter gagnée face au Real, le premier trophée continental de l’Espagne à l’Euro et la Coupe intercontinentale contre l’Independiente… Quels souvenirs forts gardez-vous de ces succès ?Chaque trophée que tu gagnes possède une saveur particulière. Avec la sélection, c’était bien sûr très fort. Nous n’avions encore rien gagné à cette époque, et remporter ce championnat d’Europe à domicile, c’était merveilleux. Je fais la passe décisive à Pereda sur le but en finale contre l’URSS, et après le but, c’est indescriptible. C’était une belle réussite personnelle, car j’étais l’un des seuls à avoir une grosse expérience en sélection. Nous étions parvenus à former une vraie équipe en deux ans, un collectif. On aurait dit que cela faisait des années et des années que l’on jouait ensemble ! La finale contre le Real Madrid, c’était aussi incroyable… Le Real Madrid venait de gagner 5 coupes d’Europe consécutives, c’était hors norme. Mais cette nuit-là, nous avions pris conscience que l’Inter Milan était vraiment une équipe de niveau mondial. Entrer dans ce gotha, c’est ce qui m’a le plus marqué. Mais encore une fois, toutes les victoires sont belles !
Comment est-ce que l’on se remet au travail après avoir presque tout gagné ? Quand tu gagnes ce genre de compétitions, je peux te dire que tu as envie d’y goûter à nouveau l’année suivante ! C’est tellement unique, tellement beau… Tu ne peux pas te dire « Okay c’est bon, j’ai tout gagné… » Il faut toujours en vouloir plus ! Si une équipe ne gagne plus, c’est qu’elle ne peut plus, et non qu’elle ne veut plus.
Pourquoi être parti à la Sampdoria et ne pas avoir terminé votre carrière à l’Inter ? J’avais 35 ans, et mes discussions avec Heriberto Herrera (coach de l’Inter de l’époque, ndlr) s’étaient conclues sur le fait qu’il fallait laisser place à la nouvelle génération. J’ai parlé avec le président et je lui ai dit que j’allais partir ailleurs. C’est normal de se faire prendre sa place par un joueur de 28-29 ans quand tu en as 35… L’Inter devait s’arranger avec la Sampdoria sur un transfert, et j’ai accepté de faire partie de la transaction. J’ai joué trois ans là-bas, de façon plus tranquille pour assurer le maintien. C’était une belle expérience.
Le trophée suivant pour l’Espagne, c’est en 2008… Quelles sont les raisons d’une disette de 44 ans selon vous ? Je ne saurais pas vraiment l’expliquer… Déjà, l’Espagne a pu choisir un grand sélectionneur comme Luis Aragonés, et elle a trouvé un groupe de 7-8 joueurs de très haut niveau. Je me souviens de périodes où seuls 2 ou 3 joueurs étaient vraiment au-dessus du lot par exemple… Mais en 2008, l’Espagne s’est enlevée cette épine du pied. Je dirais que la Selección a vraiment fait son meilleur tournoi international au niveau de son jeu. Et puis Aragonés a eu beaucoup de cran, comme quand il s’est décidé à enlever Raúl de l’équipe nationale.
Aujourd’hui, quelles chances donnez-vous à l’Espagne pour cet Euro ?L’Espagne sera l’une des grandes équipes favorites. Mais elle ne sera pas seule : la France à domicile poussée par tout un public, l’Allemagne championne du monde en titre… J’aime beaucoup la Belgique également, elle est capable de beaucoup de choses.
Luis Suárez, comment voyez-vous l’intégration de votre homonyme au Barça ?Parfaite. Les trois se sont intégrés parfaitement dans le jeu. Il n’y pas de raison de savoir qui est le meilleur ou pas des trois… L’objectif final, c’est de faire gagner l’équipe. Ils se sont bien mis d’accord dès le départ, et ils marchent sur l’eau en ce moment. Suárez a donné au Barça des qualités fortes : la garra, l’agressivité et le sacrifice. Dans chaque match réalisé, ce mec veut marquer, il a le but dans la peau. Quand l’un n’est pas dans un bon jour, l’autre prend le relais, et quand ils sont tous dans un bon jour, ils t’écrasent. Dans le football, tu peux être bon et gagner une bataille, mais si tu veux gagner la guerre, il faut être parfait.
Est-ce que Luis Suárez gagnera le Ballon d’or comme son aîné ?Il peut le faire. La saison passée, sa suspension lui a réduit son temps de jeu, mais maintenant, il est impressionnant, il fait des passes, il marque… Mais bon, la compétition est grande ! On ne sait pas ce qu’il va se passer. Mais déjà, tu peux considérer que lorsque tu es dans les trois premiers, tu es l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Ce qu’il faut ensuite, c’est perdurer dans le temps.
Nico Williams, le choix de la maisonPropos recueillis par Antoine Donnarieix