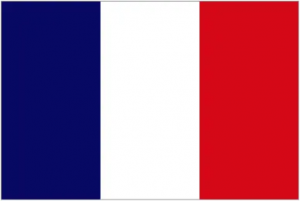- France
- Supportérisme
Ludovic Lestrelin : « Beaucoup de dirigeants connaissent mal leur public »

Après avoir étudié la thématique du supportérisme à distance, Ludovic Lestrelin, maître de conférence en STAPS à l’université de Caen Normandie et chercheur au CNRS, revient avec un petit ouvrage au titre explicite : Sociologie des supporters. Ce manuel condense tout ce qu’il faut savoir sur un acteur du football relativement complexe à cerner et qui ne se limite pas à sa forme la plus visible : les ultras.
Comment est né ce projet d’écrire une Sociologie des supporters ?
Il a débuté fin 2019, mais avec le Covid, je n’ai pas pu me mettre véritablement à l’écriture avant début 2021. Quand on me l’a proposé, je ne pouvais pas dire non, car, quelque part, c’était une forme de reconnaissance des travaux existants sur le supporterisme, mais aussi une occasion de les hiérarchiser et d’en faire la synthèse. Le point de départ, c’est bien Christian Bromberger dans les années 1980. Pour moi, c’est son ouvrage Le Match de football, paru en 1995, qui marque un tournant. Je le découvre étant étudiant et à ce moment-là, je réalise qu’on peut travailler sur le supporterisme.
Le sujet fait-il désormais complètement partie du paysage de la recherche universitaire ?C’est sans doute plus facile aujourd’hui qu’il y a trente ans, quand Bromberger a commencé et que ses collègues se foutaient de sa gueule, mais cela dit, je vois bien que je ne bénéficie pas d’une grande attention de collègues spécialistes d’autres objets de recherche. Je regrette d’ailleurs l’absence de dialogue entre les travaux portant sur les publics du sport et ceux d’autres formes de culture populaire.
À quoi cela est-il dû selon vous ?Le sport est vu comme un monde hors sol et qui s’est construit avec un rapport ambivalent avec le reste de la société. La complexité de son histoire vient de là. On dit souvent que le sport est apolitique, comme s’il s’agissait d’un univers déconnecté des réalités économiques, sociales et politiques. Ce qui peut concerner les affaires sportives et le cas des supporters de football, sur lesquels pèsent de nombreux clichés négatifs, va beaucoup moins alerter, retenir l’attention, bien qu’il y ait des évolutions. La thématique intéresse d’ailleurs grandement les étudiants et les jeunes chercheurs. Parce qu’ils se sont imposés comme des acteurs importants dans les tribunes, beaucoup vont vouloir travailler sur les ultras, parfois par effet d’âge. Quand on a la vingtaine, on se sent logiquement plus proche des ultras que d’autres types de supporters.
Ceux que l’on nomme communément les lambda ?Oui, par exemple. Mon livre est construit contre cette forme de réductionnisme qui assimile le supporter au seul groupe de supporters organisés, qui chantent et animent les tribunes. J’explique que les choses sont plus nuancées, différenciées. Dit autrement, il n’y a pas que les ultras, et je regrette qu’il n’y ait pas plus de travaux sur les formes ordinaires de suivi du sport. La tendance serait plutôt de s’intéresser aux formes les plus exceptionnelles, les plus visibles.
Les plus violentes aussi ? Vous rapportez à leur propos certaines expressions comme « brutes avinées » ou « cancer social », qui laissent penser qu’il est impossible pour les ultras de décoller cette étiquette de leur front.
C’est compliqué. Les mots que vous évoquez proviennent d’une presse reconnue, comme Le Monde, Libération, ou Le Figaro, on ne peut donc pas parler de torchons. Cette étiquette violente s’explique car elle correspond à une réalité au sein d’une branche minoritaire, mais bien existante, avec une tradition violente que le monde du football n’arrive pas à appréhender ou à gérer. L’image du supporter de football bascule dans les années 1980, avec une sorte de menace permanente qui plane sur les compétitions autour des débordements violents qui accompagneront les rencontres. Mais cette réalité fait écran à d’autres dimensions de la situation, bien qu’il est indéniable qu’elle en fasse également partie. Beaucoup de représentations très puissantes sont accolées au monde des supporters, ce qui rend l’exercice d’analyse d’autant plus délicat.
Dit autrement, cherche-t-on des réponses simples à des questions compliquées ?Ce n’est pas toujours évident ! (Rires.) Surtout dans le cas du football, autour duquel gravite une résonance médiatique très forte, ainsi que de nombreux commentateurs et amateurs, qui l’aiment et qui le suivent. Le chercheur doit donc faire un travail de recul analytique vis-à-vis de ces prénotions et contre lesquelles il n’est pas toujours évident de se positionner. Si dans vos travaux, vous dites : « Les choses sont plus complexes que ça », vous aurez toujours quelqu’un pour répondre : « Ah non, moi je connais le foot aussi bien que vous et ce n’est pas ce que j’ai vu la semaine dernière au stade Marcel-Picot », par exemple. Tout le monde à son mot à dire en ce qui concerne le football.
![]()
Vous parlez de la nécessité d’historiciser les moments charnières d’évolution de la violence. En vit-on un depuis le retour post-pandémie du public dans les stades et la multiplication d’incidents visibles ?Pour observer des moments charnières, il faut prendre du recul. Ce qui est sûr, c’est qu’aujourd’hui, les stades sont très sécurisés, on est clairement à mille lieux de ce qui existait dans les années 1980. On est plutôt dans le prolongement d’une tendance qui s’est affirmée il y a une vingtaine d’années, avec le déplacement des affrontements violents hors des enceintes sportives. On voit bien que ça monte en puissance depuis le début des années 2000, avec l’organisation de combats préparés à l’avance entre groupes de tailles relativement équivalentes et une approche du hooliganisme comme un sport de combat. En revanche, ce qui semble préoccupant est l’extrême jeunesse, autour de 16-17 ans, des protagonistes qui caractérisent la période récente. Mais la problématique n’est pas nouvelle, on retrouve la transmission de génération en génération de la fascination et de l’excitation pour l’affrontement physique violent autour du football. Cette dynamique-là, les dirigeants ou les pouvoirs publics n’arrivent pas à l’enrayer.
En marge de la rencontre France-Maroc, près d’une quarantaine de militants d’extrême droite ont été interpellés. Faut-il y voir la résurgence d’un phénomène ancien ?Ces connexions entre le hooliganisme et l’extrême droite existaient effectivement déjà dans les années 1980 et 1990, mais leur résurgence n’est pas spécifiquement française, on les observe également en Italie ou dans les pays d’Europe de l’Est. Selon moi, il n’est pas surprenant que de tels liens se reconstituent au vu du climat politique qui est le nôtre, des discours tenus par des responsables politiques d’extrême droite, ou de la montée en puissance d’Eric Zemmour ou du RN, qui fait des scores électoraux assez importants. Donc, de fait, l’activisme du militantisme d’extrême droite est plus prononcé aujourd’hui qu’il ne l’était il y a une vingtaine d’années. Mais on peut souligner une nouveauté : dans les années 1980-1990, les groupuscules d’extrême droite provoquaient une certaine fascination chez les hooligans, tandis qu’aujourd’hui, ce serait plutôt l’inverse. On retrouve un fond culturel assez proche entre ces deux univers : l’organisation, le sens du collectif, de l’honneur, une masculinité agressive, une virilité construite à travers le combat physique pour l’emporter sur l’adversaire…
Votre éditeur, La Découverte, a la particularité de publier des ouvrages scientifiques plutôt accessibles. S’agit-il donc d’un texte grand public ?Pas seulement, mais oui, en partie. Il y a un défi : que le lecteur mesure tous les enjeux autour de ce sujet qui peut paraître accessoire. Cet ouvrage doit donc servir de point de repère. Il y a aussi une volonté de parler aux décideurs. J’aimerais bien que ce bouquin soit lu dans les clubs, par les dirigeants, la Ligue, la fédé, chez les politiques… Ça va paraître surprenant, mais beaucoup de dirigeants connaissent mal leur public, ils sont surtout sur des représentations, et j’ai l’impression que dans beaucoup de clubs, il n’y a pas de projet clair sur la façon dont ils veulent travailler avec leurs supporters, je pense que c’est un problème. Cela dit, je ne donne pas de leçon, car ce n’est pas mon rôle, mais je mets à la disposition du plus grand nombre des connaissances que l’on a aujourd’hui. Aux intéressés de s’en saisir. On peut penser le football intelligemment, l’Angleterre et l’Allemagne l’ont déjà démontré.

Propos recueillis par Baptiste Brenot et Julien Duez
À lire : Sociologie des supporters, éditions La Découverte (2022), 128 pages, 10 euros.