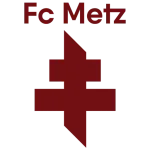- Ma vie de joueur pro
- Épisode 3
Loïc Puyo : « Je commençais toujours par enfiler la jambe droite »

Formé à Auxerre puis passé par Amiens, Orléans, Nancy, Angers ou encore le Red Star la saison dernière, le milieu de terrain Loïc Puyo (31 ans) a décidé de prendre la plume pour So Foot afin de raconter son quotidien de joueur. Alors qu'il vient de se poser au Macarthur FC, en première division australienne, le gaucher signe sa troisième chronique. Il y parle superstitions et, inévitablement, blessures.
« D’abord la jambe gauche, toujours, chaussettes, chaussures, puis la jambe droite. » On se souvient tous de cette pub mythique de Zizou. Si je n’ai pas le même talent que lui, j’ai en revanche la même routine. Et quand je dis routine, j’attribue avant tout ça à de la superstition. Je ne sais pas à quand remonte cette pratique dans ma carrière, mais j’ai l’impression d’en avoir toujours été imprégné. De toujours avoir calculé les moindres gestes, répété les mêmes programmes d’avant-match. Et dans le monde du foot, je suis sûr de ne pas être un cas isolé car les superstitions sont omniprésentes. Que ce soit chez les joueurs, les coachs et même les supporters. Moi, en tout cas, j’en ai plein. J’irais même jusqu’à dire que ça m’a bouffé, pendant ma carrière. Mes superstitions ont fluctué au fil des saisons et sont de moins en moins présentes aujourd’hui, mais c’est à Amiens que j’ai été le plus touché. Pourtant, on ne peut pas dire que c’est là-bas que j’ai le plus brillé !
Avant chaque match, j’observais la même routine. Pour les matchs à domicile, je savais exactement à quelle heure je devais commencer à me changer. J’allais d’abord voir le kiné pour poser un strap, je choisissais toujours la même couleur de la bande et je revenais à mon casier (j’en avais encore un, à l’époque !) pour me changer. Que ce soit enlever une chaussette, retirer le pantalon ou changer de caleçon, je commençais toujours et quoi qu’il arrive par la jambe droite. Ensuite, c’était la salle de muscu avec mes écouteurs. Un peu de vélo, des jongles, des étirements, une routine de mouvements toujours avec la même playlist dans les oreilles, plutôt éclectique : Play hard de David Guetta succédait, par exemple, à l’hymne national sud-africain. Avec toujours le même ordre des chansons, le même moment où je zappais sur une autre. Avant d’entrer sur le terrain, je finissais toujours pas enlacer mon ami Romain Ruffier et il me disait toujours les mêmes paroles a l’oreille : « Bon match minot, prends le jeu à ton compte, fais-toi plaisir et frappe. » C’était devenu incontournable. Pour tous les déplacements en bus, il fallait que je sois assis à la même place. Pour les repas, je mangeais toujours exactement la même chose. Les mêmes crudités, les pâtes avec la viande blanche – même si parfois, le saumon me faisait plus envie – et la tarte aux pommes en dessert.
Tabou et hypocondrie
Alors, dans quel but ? Je me disais que si je ne suivais pas ce « protocole » à la lettre, il m’arriverait malheur : être mauvais, perdre… Mais surtout ce qu’il y a de pire dans le foot, la blessure. Car j’en revenais toujours à cette pensée, c’était ma hantise. On peut toujours revenir d’une contre-performance quelques jours après, on peut toujours se défendre pour regagner sa place après un mauvais match. Mais si on est blessé, c’est cuit. On ne sert plus à rien, et en fonction de l’importance de la blessure, si on n’a pas le statut de titulaire indiscutable, on disparaît alors rapidement des radars, puis plus personne ne nous calcule. Être blessé, c’est être de côté. On est en marge du groupe pendant les entraînements, donc on ne vit pas les mêmes choses. On ne rigole pas des mêmes événements qui ont pu se produire pendant la séance, on ne peut pas chambrer. On est juste en tête-à-tête avec le kiné ou le préparateur physique, pour des séances individuelles. Quand j’étais blessé, cela m’arrivait aussi d’être envahi par des mauvais sentiments comme la jalousie ou l’envie. Je n’ai jamais souhaité la blessure de qui que ce soit, même au mec que je déteste le plus, car moi-même j’en suis effrayé. En revanche, je me suis déjà réjoui qu’un mec qui prenait ma place pendant que j’étais inapte soit mauvais ou critiqué. Je me nourrissais de ça, pour me rattraper à l’espoir de rejouer rapidement. Je souhaitais souvent que l’équipe gagne, mais qu’elle joue mal, pour qu’on se dise que cela serait mieux avec moi. En réalité, des idées pareilles sont néfastes et ne favorisent en aucun cas la guérison.
Être blessé est une chose, avoir peur de se blesser en est une autre. Par exemple, je sais que je ne parle jamais de grosses blessures avec qui ce soit. Du moins, je n’en plaisante jamais de peur que ça m’arrive. Alors que des potes du Red Star comme Jimmy Roye, David Oberhauser ou Loïc Goujon passaient leur temps à en rigoler. Sans se moquer, mais en rigoler. Et pourtant, deux d’entre eux n’ont jamais connu la moindre blessure. Tandis que moi, j’ai déjà été absent huit mois en 2016 et un an en 2018… Alors, qui a raison ? Toujours est-il que c’est un sujet tabou, chez moi. Ça me ronge souvent l’esprit de m’imaginer en béquille, ou d’être opéré. Même là, j’hésite à l’écrire de peur que ça me porte la poisse. Mais mon cousin me l’a dit dernièrement : ce n’est pas parce qu’on parle de quelque chose que cela va se produire. Au bout d’un moment, on écoute son corps sans doute un peu trop. La moindre petite douleur ? On pense à une déchirure. Une tendinite ? C’est la fin du monde. Les adducteurs qui sifflent ? C’est la pubalgie. Parfois, ça devenait compliqué à gérer parce que je ne jouais pas libéré. Ou alors, je ne profitais pas des moments qui se passaient bien car je me disais : « Si ça se passe bien, ça veut dire que ça va bientôt mal tourner. » Autant dire que c’est plutôt à la tête que je me faisais du mal.
Bordot et Nadal, même combat
La superstition était donc, pour moi, une tentative d’éviter la blessure. Je mets toujours le protège-tibia droit avant le gauche, je vais toujours aux toilettes à des instants précis et je mets mon maillot après avoir mis mes crampons. Mais au fur et à mesure, j’ai appris à être beaucoup moins touché par tout ça. Sans doute qu’on pourra parler d’expérience, même si c’est pour moi un terme qui n’a pas de sens. En tout cas, je me suis rendu compte que j’ai très souvent été touché par des blessures malgré tout ces efforts et j’ai loupé énormément de matchs à cause de ces pépins. Donc l’efficacité est à revoir. Cette superstition me poursuit, aussi, dans la vie de tous les jours. Je m’oblige à faire les choses trois fois, je ne marche jamais sur les lignes et je ne passe jamais sur les places handicapés. Tout un tas de comportements qui me valent souvent des moqueries, de la part de mes proches. Mais que je ne veux surtout pas bafouer, quitte à paraître ridicule.
Je pense que ces attitudes sont une manière de contourner la peur et l’appréhension de ce qu’on ne va pas maîtriser, pendant le match. J’ai connu des entraîneurs qui changeaient de banc après une série de défaites, mon coach du Red Star la saison passée (Vincent Bordot) qui s’habillait exactement de la même manière lors de notre série de douze victoires consécutives et s’est changé après la première défaite, des routines de joueurs à n’en plus finir. L’exemple le plus frappant ne se trouve même pas dans le foot, mais dans le tennis. C’est, bien sûr, Rafael Nadal. Comment expliquer un tel acharnement, sur sa routine ? C’est impressionnant, ce qu’il s’impose. On dit bien que « la peur n’évite pas le danger », alors changer votre vieux caleçon ou slip fétiche de match ne changera pas la trajectoire de votre carrière !
Ligue 2 : Troyes bat Montpellier, le Red Star étrille GuingampPar Loïc Puyo, avec Jérémie Baron
Retrouvez ses autres chroniques :
➩ La vie d'un joueur libre lors d'un mercato
➩ La mise à l'écart dans un « loft »
➩ Le rapport entre joueurs et médias
➩ Le grand saut vers un autre continent
➩ La découverte de l'Australie et de son championnat
➩ L'entourage et la vie de couple d'un footballeur
➩ Le bilan d'une saison à l'étranger