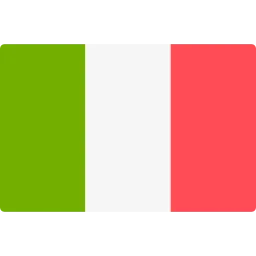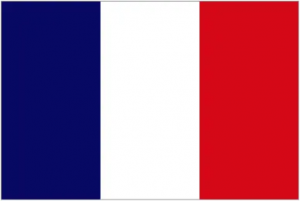- Rétro
- Argentine 2004
- Tactique
Les leçons tactiques de l’Argentine aux JO 2004

En 2004, quelques jours à peine après sa défaite en finale de la Copa América avec les grands, Marcelo Bielsa file à Athènes pour disputer les Jeux olympiques avec l'Argentine. Il en repartira deux semaines plus tard avec une médaille d'or autour du cou et le dernier trophée de sa carrière d'entraîneur, mais surtout avec la validation de ses idées. Tout simplement car en Grèce, l'Argentine a tout écrasé. Récit d'un chef-d'œuvre.
Perdre. Perdre de nouveau. Perdre parce qu’on a pris des risques. Perdre parce qu’au fond, dans la vie, comme l’expliqua un jour Fernando Torres à So Foot, « tu perds plus de fois que tu ne gagnes ». Perdre pour apprendre. Perdre pour grandir. Perdre parce qu’à chaque jeu, il faut un gagnant et un perdant. Théoriquement, Marcelo Bielsa sait perdre. Il se décrit même sans détour comme un « spécialiste de l’échec ». Lors d’un discours tenu lors d’un congrès d’entrepreneurs au Chili, en 2009, il précisa alors : « La relation entre succès et échec a été fondamentale dans ma vie, mais le succès et le bonheur ne sont pas synonymes. Je suis un spécialiste de l’échec et je sais parfaitement que l’on perd beaucoup de partisans quand on arrête de gagner. Il y a des gens qui réussissent et ne sont pas heureux, et des gens heureux qui peuvent se dispenser du succès. Le succès est une exception. Les êtres humains triomphent de temps à autre. Mais habituellement, ils progressent, combattent, s’efforcent et gagnent de temps à autre. Seulement, de temps à autre. »
Quelques années plus tôt, alors qu’il était sélectionneur de l’Argentine et qu’il faisait face à des élèves du Colegio Sagrado Corazon de Rosario, où il fit ses études, Bielsa s’était déjà épanché sur le sujet. Voilà ce qu’il avait dit : « Les moments de ma vie où j’ai le plus progressé sont liés aux échecs, alors que les moments de ma vie où j’ai régressé sont liés aux succès. Quand tu gagnes, le message d’admiration est trop confus. Le succès déforme, nous fait nous relâcher, trompe, nous conduit à nous enamourer excessivement de nous-mêmes. L’échec est le contraire : il est formateur, nous rend solides, nous rapproche de nos convictions, nous rend cohérents. Bien entendu, je me dédie au sport de compétition pour gagner, et je travaille ce que je travaille car je veux gagner, mais si je ne distinguais pas ce qui est réellement formateur et ce qui est secondaire, je serais dans l’erreur. Dans n’importe quel domaine, on peut gagner ou perdre, mais l’important est la noblesse des recours utilisés, l’important est le cheminement, la dignité avec laquelle j’ai parcouru ce sentier dans la recherche de mon objectif. » L’important est le comment, la manière dont ses joueurs se comportent sur un terrain et c’est avant tout pour ça que l’on aime Bielsa : non pas parce qu’il gagne, mais parce qu’il veut le faire selon un football joyeux, proactif, vivant. C’est aussi ce qui lui a donné ce qu’il considère comme le plus grand succès de sa carrière : la « reconnaissance d’un droit à l’échec ». Théoriquement, en tout cas.

La mort et la morve
Après les mots, place aux maux. Intimement, Bielsa est en réalité un homme qui souffre et qui « meurt après chaque défaite ». « La semaine suivante est un enfer, expliquait-il en 1992. Si je perds, je ne peux pas jouer avec mes filles, ni aller manger avec mes amis. C’est comme si je ne méritais pas ces bonheurs quotidiens. Je me sens inapte pour le bonheur pendant sept jours. » Au cours de ses deux saisons passées à Guadalajara, certains joueurs l’entendaient ainsi pleurer. Après l’élimination de l’Argentine au premier tour du mondial 2002 à la suite d’un nul concédé face à la Suède, d’autres l’ont carrément vu se transformer en gosse dans un vestiaire de Miyagi, au Japon. Kily Gonzalez raconte la scène dans le livre Marcelo Bielsa – El Loco Unchained : « Voir ton entraîneur se taper la tête contre les casiers du vestiaire, sanglotant comme un enfant qui a un gros chagrin, le visage plein de morve, ça me fait encore mal aujourd’hui. » Malgré les larmes, l’AFA – l’Association du football argentin – a décidé de prolonger Bielsa, soutenu par une grande majorité de ses joueurs, après le tournoi. La raison a été ensuite donnée par le technicien : « Notre processus est sauvegardable, même si l’on condamne habituellement sans appel ceux qui ne conduisent pas au succès. Je crois que la défaite n’a pas emporté avec elle notre processus. Elle a emporté beaucoup de choses, je le sais, mais pas cela. » La preuve, l’Argentine déboule au Pérou lors de l’été 2004 et écrase la quasi-totalité de ses adversaires : l’Équateur, l’Uruguay, le Pérou, la Colombie… Seul le Mexique va réussir à la maîtriser lors des poules (0-1). En 2002, une banderole de supporters argentins affirmait que le temps donnerait raison à Marcelo Bielsa et celui qui est alors sélectionneur de l’Albiceleste se dit que son heure est là, entre ses doigts. Mais en finale, alors que l’Argentine mène 2-1 face au Brésil à la toute dernière seconde, Adriano surgit et égalise. Mystique selon Bielsa : « J’ai vu cinquante fois cette égalisation et j’en conclus qu’il y a des choses dans le football qui relèvent de Dieu. » D’Alessandro et Heinze ratent ensuite leurs tirs au but : retour en enfer.
Retour aux origines
Cette fois, pourtant, Marcelo Bielsa a vu ses hommes appliquer à la lettre ses principes et un modèle qu’il juge infaillible : un 3-3-3-1, dont l’animation est dépendante d’une organisation collective parfaite. C’est également avec ce système qu’il se présente à Athènes, deux semaines après sa défaite en finale de la Copa América, mais aussi avec plus ou moins les mêmes hommes (quatorze des dix-huit convoqués pour les Jeux olympiques étaient du voyage au Pérou). Comme les règles du CIO l’autorisent, Bielsa amène en Grèce trois joueurs de plus de 23 ans. Trois monstres : Roberto Ayala, Gabriel Heinze, fraîchement transféré à Manchester United, et Kily Gonzalez. Il a également glissé dans ses valises quelques vainqueurs du mondial U20 avec José Pékerman en 2001 (Lux, Coloccini, D’Alessandro, Rosales). Que représentent les JO aux yeux d’un homme habité par la grandeur du jeu ? Lors de son intervention face aux étudiants de Rosario, Bielsa a donné des éléments de réponse : « Je suis absolument convaincu que la renommée et l’argent sont des valeurs sans conséquence. J’estime que l’esprit amateur et l’amour de la tâche à accomplir sont les choses qui font du travail une tâche satisfaisante à accomplir. » En ça, difficile de faire plus esprit amateur que celui dans lequel l’équipe Argentine va être balancée durant un peu plus de quinze jours, en août 2004. À Athènes, c’est le Bielsa professeur d’éducation physique et le Bielsa formateur qui renaissent.

À son arrivée en Grèce, le technicien parle même d’un « luxe » pour les présents et évoque son envie d’assister à quelques épreuves, à commencer par le hockey sur gazon, le sport pratiqué par ses filles et dont l’Argentine est spécialiste (championne du monde chez les filles en 2002 et 2010, médaillée d’argent en 2000 et 2012 et de bronze en 2004 et 2008, N.D.L.R.). Quelques semaines après son échec au mondial 2002, Marcelo Bielsa avait même décidé d’échanger durant de longues heures avec Sergio Vigil, l’ancien sélectionneur des Leonas, pour recharger les batteries. À Athènes, il ne verra finalement aucun match de hockey sur gazon alors que ses joueurs, eux, vont être coupés du monde : pas d’ordinateur, pas de radio, pas d’air conditionné, rien. « Nous étions habitués aux hôtels, à nos propres salles de bain, à nos propres chambres, détaille Kily Gonzalez dans The Quality of Madness : A Life of Marcelo Bielsa. Là, à notre arrivée, nous avons trouvé deux blocs de trois étages, des petits lits, des petites tables de chevet et des armoires minuscules. À six heures du matin, on devait faire la queue pour nous brosser les dents… Je viens d’un monde modeste, comme beaucoup des mecs qui étaient présents, et ça nous a fait du bien. » Tellement de bien qu’à Athènes, l’Albiceleste va tout exploser sur son passage, inscrire dix-sept buts, n’en encaisser aucun et repartir avec la première médaille d’or olympique de l’histoire du pays en football. La seule ramenée de l’édition 2004 par l’Argentine avec celle décrochée par Ginobili & co au basket.
Pourquoi se démarquer ?
Pour analyser le dernier tournoi remporté par Bielsa, il convient d’abord de l’écouter parler de sa philosophie. Impossible de faire autrement. Magnéto : « Quand tu as le ballon, il faut se démarquer. Et pourquoi se démarquer ? Pour que la progression du ballon soit plus fluide. Les positions fixes, sans mouvement, rendent la formation de lignes davantage perceptible pour le rival. Mais attention, plus tu te démarques et plus tu crées de désordre pour couvrir le terrain. Et c’est la grande difficulté. Cela se résume simplement : plus tu te démarques et plus ton repli défensif devient complexe. Mais si tu ne te démarques pas suffisamment, tu ne donnes pas de fluidité à la circulation de balle. Tu sais ce qui se passe alors ? Les joueurs prennent peur. Quand ils sont pressés, ils ne se démarquent pas, car tous veulent être proches de leur position défensive. En rendant ton repli défensif plus complexe, tu mets en danger ton but, mais si tu ne prends pas de risques, tu perds rapidement le ballon et tu le donnes à l’adversaire, qui dispose alors du ballon pour attaquer. » Attaquer, c’est justement le cœur de la pensée de Bielsa, qui n’a jamais transigé : s’il joue de cette manière, c’est pour gagner et pour gagner, il faut attaquer. Le foot ne peut être envisagé d’une autre façon.
La première étape de l’aventure grecque de la bande, un match face à la Serbie-et-Monténégro, va en être la démonstration : cette version de l’Argentine est un ballet magnifiquement coordonné par des danseurs qui semblent communiquer télépathiquement. Aux yeux de Marcelo Bielsa, le football n’est avant tout que « mouvements et déplacements ». « Il n’existe pas une raison valable pour qu’un joueur soit à l’arrêt sur la pelouse », aime-t-il souvent répéter.
Ici, ça commence dès la première pièce : le gardien German Lux, à qui Bielsa ordonne systématiquement de relancer court vers l’un des trois centraux (Coloccini, Ayala, Heinze) ou vers la clé de son système, Javier Mascherano, un type qu’El Loco a fait débuter en sélection en juillet 2003 alors qu’il n’avait jamais joué la moindre rencontre en équipe première de sa vie. Lorsque ces quatre solutions sont coupées, comme lors de certaines séquences face à l’Italie en demi-finales, Lux n’hésite pas non plus, en dernier recours, à jouer long et à notamment trouver Carlos Tévez, dont les déplacements sont en permanence à la base des circuits offensifs argentins, au niveau du rond central.

Comme dans l’Ajax de Louis van Gaal, une équipe admirée par Bielsa, c’est les joueurs axiaux (les trois centraux et Mascherano) qui sont les « meneurs de jeu ». Le rôle de Mascherano est le plus important de tous : ses nombreux déplacements sans ballon permettent souvent d’ouvrir des espaces dans le cœur du jeu à Heinze ou Coloccini, deux joueurs techniquement à l’aise, qui n’ont aucun problème à résister au pressing adverse, et qui sont capables de porter le ballon jusqu’au rond central avant de déclencher la passe verticale vers un joueur offensif libre, qui est souvent Tévez, toujours trouvé entre les lignes. Autre circuit de sortie de balle lorsque l’axe est fermé : la passe vers l’un des pistons (Kily Gonzalez ou Lucho González). Ce dernier a ensuite le choix entre trois options : lancer en profondeur son partenaire de côté (Delgado à gauche pour Kily Gonzalez, Rosales à droite pour Lucho) ; combiner avec ce même partenaire, mais vers l’intérieur du jeu, ce qui est souvent le cas côté gauche où Kily Gonzalez vient souvent longer la ligne là où Delgado aime rentrer sur son pied droit ; trouver Mascherano dans l’axe qui va ensuite changer de côté (ce circuit est souvent répété côté droit, Rosales étant davantage un joueur de profondeur). Tous ces circuits vont être posés sur la table lors de la démolition de la Serbie-et-Monténégro (6-0) et le deuxième but, inscrit par Kily Gonzalez, est la démonstration parfaite de la science du mouvement de cette équipe.
Le roi Tévez
Ce qui nous ramène à la question initiale de Bielsa : « Pourquoi se démarquer ? » Pour rendre fou l’adversaire, ce qui est possible dès la sortie de balle, car une fois qu’elle débarque dans le camp adverse, l’Argentine se pointe avec plusieurs cartes : les une-deux, « passe et suit », les permutations, les projections, le dézonage… Tout ça pour assurer une fluidité permanente au jeu. Là encore, c’est un joueur axial qui mène la danse. Il a alors 20 ans, va marcher sur Athènes pendant deux semaines et s’appelle Carlos Tévez. Durant cette compétition, Marcelo Bielsa va utiliser le joueur de Boca Juniors comme un faux neuf, qui vient en permanence créer le surnombre au milieu aux côtés de Lucho et de D’Alessandro, qui est aussi capable de se déplacer sur un côté pour dribbler ou combiner : Tévez est libre, ouvre des espaces pour les autres et se retrouve quasi systématiquement à la base et à la conclusion des mouvements offensifs de l’Albiceleste.


Autre indispensable de la réussite offensive de l’Argentine : la création de triangles dans toutes les zones du terrain. Triangles pour sortir le ballon, triangles pour bouger une ligne adverse, triangles pour amener le plus vite possible le ballon sur les côtés, Bielsa demandant souvent à ses équipes de passer sur les ailes plutôt que de finir dans l’axe. Souvent qualifié d’entraîneur mécanique, la réussite de Marcelo Bielsa passe par la répétition des mouvements. Un jour, il théorisa la chose de façon terrifiante : « Aux entraînements, j’envoie 220 centres à un joueur, pour qu’il mécanise le mouvement. S’il s’abstient d’aller chercher un seul de ces 220 centres, je le tue. Je dois lui faire sentir que c’est comme s’il avait violé une femme. Parce que ce ballon qu’il a laissé passer nous a enlevé l’argent, le triomphe, la gloire, la vie… » Une autre fois, il dira à Tévez que « l’offre de la réception doit être verticale ». Difficile de savoir ce que cela veut dire. Ce qu’on sait, en revanche, c’est que pour répéter tous ces mouvements, il faut des joueurs intelligents, mais surtout capables de conserver le ballon en toutes circonstances. Lucho, D’Alessandro, Kily Gonzalez, Tévez et Mascherano sont des rois de la couverture de balle et sont capables de jouer de leurs corps pour toujours servir un coéquipier dans le bon tempo, au bon endroit. Grâce à toutes ces qualités, la Serbie-et-Monténégro et le Costa Rica, balayé (4-0) lors des quarts de finale, vont être transformés en victimes passives là où l’Argentine va principalement se contenter de l’essentiel face à la Tunisie (2-0) et l’Australie (1-0).

« J’ai commencé à me parler tout seul… »
Le match le plus marquant de la compétition, au-delà du premier, est certainement l’avant-dernier : la demi-finale face à l’Italie de Claudio Gentile. Avant cette rencontre, Bielsa va voir Mascherano et le prévient : si Pirlo, placé en 10 derrière Gilardino dans le 4-2-3-1 de Gentile, peut s’exprimer, l’Argentine prendra la porte. Résultat ? L’Italie ne va exister que six minutes, soit le temps d’un coup franc de Pirlo rapidement joué vers Bonera dont le centre ne sera repris par personne et d’une praline de Gilardino captée par Lux sur une séquence où l’Argentine n’était pas encore réglée défensivement. Cette rencontre est surtout intéressante pour voir à quel point l’Albiceleste de Bielsa était aussi une machine défensive. Et ce, pour plusieurs raisons. La première : avec Bielsa, la phase défensive concerne 100% des joueurs et Tévez aura notamment récupéré énormément de ballons en se repliant. La seconde : grâce à la hauteur de sa ligne défensive, Heinze et Coloccini croquant leurs proies dès la ligne médiane, et même parfois plus haut, l’Argentine contient majoritairement ses adversaires dans leur camp. Face à la Serbie-et-Monténégro, le sixième but est notamment intervenu grâce à une récupération haute de Heinze, également passeur décisif sur le coup.

Ici, l’idée de Bielsa est de récupérer le ballon vite et haut, afin d’empêcher l’adversaire de déplier la moindre contre-attaque. On peut aussi retrouver ces phases dans l’Ajax de Van Gaal. Cela s’organise ici assez simplement, soit par un marquage individuel, un cadrage et un harcèlement permanent.

Lors de la rencontre face à l’Italie, Bielsa s’est aussi adapté à son adversaire et a notamment demandé, en phase défensive, à Kily Gonzalez de se replier côté gauche pour s’occuper de l’ailier droit italien – Giampiero Pinzi – là où Coloccini gère Sculli, où Mascherano tient Pirlo dans sa poche et où Gilardino est cadenassé par Heinze. Comme toujours, défensivement, Marcelo Bielsa ne cherche pas à jouer le hors-jeu et avance avec un homme libre pour assurer la couverture. En 2004, il s’agit de Roberto Ayala.

Si l’Argentine est également repartie d’Athènes sans le moindre but encaissé, c’est d’abord grâce à sa domination dans les airs, même si Fabricio Coloccini a légèrement souffert en finale face au Paraguay, d’où son remplacement par Nicolas Medina à vingt minutes de la fin. C’est aussi grâce à sa maîtrise du tacle, les Argentins réussissant à plusieurs reprises à cadrer le porteur, parfois à plusieurs, à l’enfermer, puis à récupérer le ballon en restant en permanence debout. Javier Mascherano a principalement excellé dans ce domaine, notamment face à Andrea Pirlo en demi-finales, qui n’a pu exister que grâce à ses coups de pied arrêtés. Mais c’est surtout grâce à la suite donnée à ces phases : l’explosion dans les transitions et les attaques rapides, grâce auxquelles l’Argentine a inscrit la majorité de ses buts durant les Jeux olympiques, dont celui marqué par Tévez, meilleur joueur et meilleur buteur du tournoi, en finale après une sortie de balle de cinquante mètres menée par Coloccini, un décalage sur Rosales et un centre parfaitement coupé. Cette finale contre le Paraguay n’aura pas été le plus grand match du tournoi de l’Albiceleste pour deux raisons : l’heure inhabituelle de la rencontre – 10h – et l’agressivité des Paraguayens, progressivement dépassés par les mouvements axiaux incessants de Tévez et D’Alessandro, ce qui conduira à l’expulsion d’Emilio Martinez pour un coup de coude dans la tronche du second (Figueredo sera également expulsé pour avoir tenté de marquer de la main, N.D.L.R.).
Au bout, Marcelo Bielsa a surtout brisé la malédiction qui l’entourait depuis son arrivée sur le banc de la sélection nationale grâce à un chef-d’œuvre collectif, son chef-d’œuvre, le « processus » auquel il n’a jamais souhaité renoncer. Moins d’un mois plus tard, usé, il annoncera sa démission après une victoire au Pérou. Justification : « Je ne dispose plus de l’énergie que requiert ce poste. »
À quarante-neuf ans, Bielsa est alors peut-être au point le plus bas de sa vie et va ruminer pendant des semaines ses échecs, notamment l’élimination de l’Argentine au premier tour du mondial 2002. Pour expurger, il filera s’enfermer dans un couvent, pendant trois mois. « J’ai emmené avec moi les livres que je voulais lire. Pas de téléphone, ni de télé. J’ai beaucoup lu et je crois que personne ne lit autant à propos du football que moi. Je ne suis resté que trois mois car j’ai commencé à me parler et à me répondre tout seul. Je devenais vraiment fou… » Bielsa venait pourtant de s’offrir un droit au succès et à la postérité grâce à la réussite d’un modèle travaillé au millimètre. Mais l’enfer l’attendait de nouveau, encore et encore.
Par Maxime Brigand