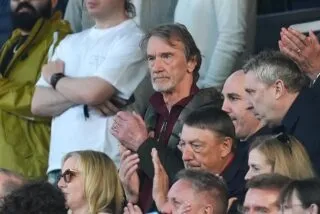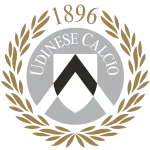- Italie
- Tactique
- Lazio 2000
Les leçons tactiques de la Lazio 2000

Il y a vingt ans, la Lazio remportait son premier titre de champion depuis 1974. À sa tête : Sven-Göran Eriksson, venu dépoussiérer une partie de la Serie A de certains vieux concepts, apôtre d'un jeu ultra-vertical et ami intime d'un 4-4-2 ultra flexible. Retour sur un mythe construit par une bande d'affamés.
Sven-Göran Eriksson reçoit chez lui. « Je voulais une maison au bord du lac Vänern », sourit-il, en ouverture, avant de poursuivre la présentation de son immense demeure suédoise, située à quelques kilomètres de la frontière norvégienne : « Selma Lagerlöf, la première femme à avoir reçu le prix Nobel de littérature, a écrit à propos de cet endroit, ce lac et ses environs… Elle n’a pas vécu ici, mais elle a rédigé le dernier chapitre du Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la Suède au premier étage de cette maison. J’ai d’ailleurs encore une lettre qu’elle a écrite à sa mère. J’aime ce lieu, je me s’y sens bien, et puis d’ici, je peux apercevoir le village où est né mon père, juste de l’autre côté du lac. » À plus de soixante-dix piges, le premier entraîneur people de l’histoire du foot est aujourd’hui un type rangé. À l’automne 2018, excité par un dernier challenge, Eriksson s’était laissé tenter par une aventure aux Philippines.
Verdict : trois matchs, trois défaites. Fin de l’histoire. Quelques semaines plus tôt, il s’était posé, le temps d’un entretien avec So Foot et, avant d’offrir un dernier café, avait accepté de dresser un bilan sec de sa drôle de carrière : « Finalement, ce métier m’a coûté mon mariage. C’est l’une des raisons pour lesquelles je suis divorcé, parce que mon ex-femme n’aimait pas déménager tous les deux ou trois ans. Elle était enseignante, elle voulait travailler et avoir une vie de famille normale. Sauf que le seul moment où les enfants n’étaient pas à l’école, c’était le week-end. Et le week-end, où était leur père ? Quelque part, avec son équipe… Je n’ai pas eu une vie normale, selon moi. J’aurais pu changer les choses, mais j’ai privilégié le foot plutôt que ma femme. Ce n’est pas facile à dire, mais c’est comme ça. Pour moi, il n’y a même pas de débat et l’idée d’abandonner… Impossible. » Sven-Göran Eriksson a plutôt préféré se tailler un CV aussi gros que la baraque où il coule sa retraite : dix-neuf clubs dirigés, dix-huit trophées soulevés. Mais s’il ne fallait en garder qu’un, Sven ? « Le Scudetto, avec la Lazio… »
Il Perdente Successo à la base du monstre
L’histoire raconte pourtant que le technicien suédois n’aurait jamais dû se retrouver sur le banc de la Lazio – il avait signé un pré-contrat avec Blackburn au printemps 1997, mais a finalement refusé de s’engager parce que le propriétaire du club, Jack Walker, a refusé de céder aux demandes salariales énormes de Roberto Mancini, qu’Eriksson voulait ramener avec lui en Angleterre – et qu’il n’aurait jamais rien dû y gagner, surtout. À cette époque, dans les têtes italiennes, Sven-Göran Eriksson est Il Perdente Successo, un type dont on reconnaît les qualités des équipes, mais incapable de soulever le trophée en fin de saison. À la Roma, où il a passé trois saisons complètes, il a terminé au mieux deuxième, lors de la saison 1985-1986. À la Fio ? Il n’a pas réussi à taper plus haut qu’une septième place. Et à la Samp, alors ? Malgré Pagliuca, malgré Lombardo, malgré Mancini, malgré Gullit, malgré Chiesa, malgré Seedorf, malgré Veron, malgré Mihajlović, Eriksson n’accrochera qu’un podium – magnifique au passage – au printemps 1994. Son explication : « Je n’ai pas eu de chance là-bas, parce qu’un mois avant de commencer l’entraînement, le propriétaire de la Sampdoria, Paolo Mantovani, m’a appelé pour me dire qu’il devait vendre Vialli à la Juventus. Il m’a dit : « Mister, je ne peux plus me battre avec la Juve, le Milan et l’Inter. » C’était la fin de la grande Samp. C’était toujours un bon club, mais plus un club du gratin… » À Gênes, Eriksson va malgré tout nouer une relation unique avec un homme : Roberto Mancini. En juillet 1992, c’est d’ailleurs Mancini en personne, en compagnie de Vialli, qui avait demandé à Mantovani d’installer Eriksson, alors dragué au même moment par le Bayern. Un déjeuner avait alors été organisé en ville et Roberto Mancini avait justifié son coup de cœur pour un coach qui venait alors de disputer une finale de Coupe des clubs champions avec le Benfica : Eriksson, c’était la nouveauté, une autre façon de voir le jeu, la fin du libero et du marquage individuel.

Et c’est aussi pour ça qu’à l’été 1997, après un peu plus de deux saisons avec Zeman sur le banc et trois échecs dans la course au titre, Sergio Cragnotti, le propriétaire de la Lazio, se tourne vers Eriksson : le boss laziale veut du neuf et se fiche de combien coûtent les hommes. Cragnotti signe et veut gagner, point. Sven-Göran Eriksson le sait et va rapidement poser ses souhaits sur la table. Selon lui, la Lazio n’a besoin que de trois nouveaux hommes pour remporter le championnat : Roberto Mancini, Siniša Mihajlović et Sebastien Veron, trois des anciens joueurs du coach suédois à la Sampdoria. Sergio Cragnotti hésite et va d’abord se contenter de filer à son nouvel entraîneur la pièce qu’il souhaite par-dessus tout : Mancini, qui vient alors renforcer un effectif déjà solide où l’on peut croiser plusieurs soldats du futur titre (Marchegiani, Negro, Nesta, Nedvěd) et où viennent s’ajouter de nouveaux pions essentiels (Almeyda, Pancaro et Bokšić). Eriksson va aussi se mettre en danger et rapidement demander à Cragnotti de vendre Beppe Signori, que SGE juge nocif pour l’équilibre de son vestiaire malgré son passé de triple meilleur buteur du championnat (en 1993, 1994 et 1996).
Les supporters gueulent, le nouveau coach avance et sait où il va : si la Lazio boucle le championnat à la septième place après avoir longtemps été à la lutte pour le titre, elle va également remporter la Coupe d’Italie et disputer une finale de Coupe de l’UEFA face à l’Inter au terme d’une deuxième partie de saison XXL. Assez pour satisfaire Sergio Cragnotti ? Pas totalement. Quelques années plus tard, le patron expliquera avoir pris contact avec Fabio Capello lors du printemps 1998 avant de finalement offrir à Eriksson son deuxième vœu : Siniša Mihajlović, que le technicien a replacé en défense centrale et qui possède alors « le meilleur pied gauche du monde ». D’autres hommes débarquent – Conceição, Couto, Salas, Stanković Vieri –, et la Lazio, qui caracole en tête au printemps, va alors se faire griller sur le fil par le Milan en championnat, à la suite d’un nul concédé lors de l’avant-dernière journée à Florence (1-1), tout en grattant la dernière C2 de l’histoire. Quelque chose se passe, Cragnotti le sait : le titre est à l’horizon.
Le chef laziale aurait pu balancer son coach par-dessus bord à cet instant, mais a préféré l’écouter, une dernière fois, tout en jonglant avec un problème de taille : Christian Vieri, son amour de l’argent et son besoin permanent de changer d’air. On parle ici d’un roi des surfaces, évidemment, mais aussi d’un bison qui n’aura pas fait plus d’une saison dans un club entre ses débuts au Torino et son départ à l’Inter, lors de l’été 1999, contre un chèque de cinquante millions d’euros. C’est ici que la paire Eriksson-Cragnotti va briller en insérant Diego Simeone dans le deal et en réutilisant l’argent pour offrir à la Lazio le troisième vœu de SGE – Juan Sebastien Véron, arraché à Parme – tout en recrutant également Simone Inzaghi, qui sort d’une saison à quinze pions avec Piacenza. La machine est prête à rouler sur son monde, et Eriksson tient alors entre ses doigts un char offensif multiple, qui peut exploser de partout. Les chiffres de la saison 1999-2000 le prouvent : au cours de la saison, quinze joueurs différents vont planter en championnat et seul Marcelo Salas va dépasser les dix buts (12), signe de l’homogénéité du monstre monté boulon par boulon par Sven-Göran Eriksson.

« Plus on a de possession, plus on donne du temps à l’adversaire… »
Un monstre qui, dès son premier match de la saison, au Louis-II, va décrocher la mâchoire d’un Sir Alex Ferguson qui, à l’issue de la défaite de son Manchester United lors de la Supercoupe d’Europe (0-1), va prévenir les futurs adversaires de la Lazio : « Cette équipe est la plus forte que j’ai jamais affrontée. Je pense qu’ils vont remporter la Serie A cette saison… » Cette rencontre est un repère essentiel pour bien comprendre le jeu de la Lazio d’Eriksson, un homme qui a toujours juré par le même système : le 4-4-2. Pourquoi ? Parce qu’à ses yeux, « la défense à quatre est une base vitale » et parce que le Suédois était convaincu que « si vous voulez créer une grande équipe, vous devez posséder votre propre identité ». Voilà pour le papier. Pour l’animation, maintenant, la Lazio de Sven-Göran Eriksson n’était pas une adepte de la possession à outrance et, un jour, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre le justifia à Diego Simeone : « Diego, tu sais, plus on a de possession, plus on donne du temps à l’adversaire pour se mettre à l’aise… » Sur un terrain, Eriksson souhaite que ses joueurs « réduisent l’espace et le temps » et cela va passer ici par un contrôle absolu de toutes les zones du terrain plus que par un pressing de tous les instants.
Dès ce match contre Manchester United, on peut voir que l’idée centrale de la Lazio de SGE est de contrôler le cœur du jeu tout en s’adaptant à l’événement : face aux gros adversaires, Eriksson va souvent déployer un 4-5-1, déclinable selon les moments de la rencontre en 4-3-1-2, en 4-2-3-1, en 4-2-2-2 ou en 4-4-2 en fonction des déplacements de Nedvěd, Mancini et Veron. Grâce à cette organisation, à Monaco, la Lazio va alors manipuler à sa guise le 4-3-3 de Ferguson.
À l’issue de la rencontre, Sven-Göran Eriksson va même affirmer ceci : « J’ai adoré ce match, notamment notre première période. L’idée que je me fais de ma Lazio est exactement celle-ci… » Tout simplement car malgré la blessure rapide de Simone Inzaghi, dont le nez a explosé après un coup de coude de Stam (décidément une pelouse maudite pour les frères Inzaghi, Pippo s’était fait démolir la lèvre face à Monaco lors de la C1 1997-1998), il est possible de sortir de cette Supercoupe d’Europe la quasi-intégralité des préceptes romains. À commencer par le recours presque systématique au jeu long, notamment favorisé par la qualité de relance de Mihajlović. L’idée est alors de toucher le plus rapidement possible le ou les offensifs, dans les pieds ou sur la tête d’un pivot, afin de multiplier les occasions.

Après une récupération axiale, Nesta décale Mihajlović qui allonge tout de suite vers Simone Inzaghi. Le buteur laziale remporte son duel avec Berg et trouve directement Nedvěd, qui évolue souvent dans une position de meneur de jeu. Dans la foulée, Nedvěd relance directement Inzaghi, hors jeu sur l’action.

Quelques minutes plus tard, autre circuit, mais même objectif : Negro combine avec Stanković côté droit et cherche directement Inzaghi en profondeur.

Nouvelle séquence : c’est cette fois au tour de Pancaro d’allonger vers Nedvěd, excellent dans la prise de profondeur et dont le déplacement va permettre à Mancini de se recentrer.

Après de multiples tentatives, le mouvement va faire mouche : Pancaro cherche cette fois Mancini en profondeur. Berg est lobé, Stam est trop loin pour intervenir et Mancini remet de la tête vers Salas, en retrait. Enchaînement magnifique derrière et ouverture du score.
À travers ces séquences, c’est aussi la capacité des joueurs de la Lazio à attaquer dans les interlignes – les espaces entre un central et un latéral – qui est mise en lumière. À plusieurs reprises, Inzaghi, Salas ou Boskic, par exemple aligné lors de la réception électrique du Milan (4-4) en octobre, n’hésitent pas à désaxer pour venir former un triangle sur le côté, souvent pour finir avec Conceição côté droit. Exemple marquant avec le premier but inscrit par Salas face aux Milanais, sur lequel le Chilien récupère le ballon, trouve Boskic dans la profondeur, qui fait sortir Costacurta avant de décaler Conceição et d’être à l’arrivée de la combinaison. Quelques minutes plus tôt, un mouvement similaire avait débouché sur une grosse frappe d’Alen Boskic, sauvée par Abbiati.

Hommes à tout faire
Autre axe central de cette Lazio : son milieu, considéré comme le meilleur d’Europe à l’époque, un secteur où Eriksson fait énormément tourner les pions (seul Veron compte plus de trente titularisations en championnat cette saison-là, N.D.L.R.). Si le système de base est le 4-4-2, Eriksson ne va jouer avec ses deux buteurs (Salas et Inzaghi) que lors du début de saison, préférant ensuite installer Bokšić ou Mancini derrière l’un des deux. Son objectif est alors de gagner en imprévisibilité et c’est ce que va lui permettre un 4-5-1 organisé d’une façon assez libre à trois exceptions près : devant sa défense à quatre, SGE souhaite en permanence un six strict, capable de jouer long et de s’intégrer à la défense lorsque la rencontre le demande (souvent Almeyda) ; un milieu droit – principalement Conceição (parfois Stanković comme lors de la Supercoupe d’Europe) – qui doit essentiellement enchaîner les sprints le long de la ligne avant de centrer ; et, un buteur mobile, qui décroche et peut faire avancer le bloc.
Pour les trois autres membres du milieu, les rôles sont interchangeables, mais la Lazio attaque toujours avec un milieu relayeur à droite d’Almeyda (Simeone), chargé de l’équilibre de l’équipe, un meneur de jeu pour soutenir le buteur et qui se replace à gauche d’Almeyda en phase défensive (Veron), puis un milieu gauche (Nedvěd ou Mancini) qui bouffe l’espace. En permanence, l’idée est d’être en supériorité numérique au milieu, d’enchaîner les combinaisons, d’être un soutien direct pour les remises d’un buteur qui décroche beaucoup, mais aussi de foutre le bordel dans les intervalles.
Si ça fonctionne ici, c’est avant tout grâce aux profils des mecs à disposition d’Eriksson, qui va passer la seconde partie de la saison à jouer avec un pur milieu défensif (Almeyda) et que des milieux offensifs. Lors du déplacement victorieux à Turin (0-1) en avril, il aligne ainsi le milieu à cinq têtes suivant : Conceição, Simeone, Almeyda, Veron, Nedvěd. Monstrueux car il n’y a là que des joueurs capables d’éliminer par le dribble, par un contrôle en première intention, de bouffer les espaces, de jouer long, d’allumer de loin, mais aussi de venir compenser le moindre décrochage. Comme Coco Suaudeau aimait le répéter à chaque prise de parole : l’important ici n’est pas l’organisation de l’équipe, c’est son animation et donc la coordination des mouvements. Et c’est là où cette Lazio excelle principalement. Pour accentuer les combinaisons et augmenter le contrôle de la largeur, il n’est aussi pas rare de voir le latéral gauche – par exemple Favalli contre Milan – monter d’un cran, ce qui transforme alors la Lazio en un 3-5-2 encore plus redoutable. Résultat : tous les joueurs romains sont des menaces directes pour l’adversaire (Inzaghi va inscrire 19 buts toutes compétitions confondues, dont neuf en C1, Salas 17, Mihajlović 13, Veron 10…) et la Lazio va terminer la saison avec la deuxième meilleure attaque de Serie A (64 buts marqués).

Science des déplacements et rares noyades
Dans la tête d’Eriksson, l’important est donc de passer le moins de temps possible dans son camp et de chercher en permanence les abords de la surface adverse. Cela passe évidemment par une excellence dans la sortie de balle. Dans cette phase de jeu, Marchegiani n’est quasiment jamais sollicité et le ballon est souvent ressorti sur les côtés ou par des longs ballons. Enjeu : étirer au maximum les distances entre les joueurs adverses et créer automatiquement un plus grand nombre d’espaces. Cela passe aussi par une organisation défensive impériale. Dans ce secteur, un homme règne en roi – Alessandro Nesta, excellent dans le un-contre-un et quasiment jamais au sol – et un souhait ressort : fermer le plus possible l’axe. Si la Lazio va terminer avec la deuxième meilleure défense du pays (33 buts encaissés), ce n’est pas une équipe qui presse très haut, se contentant souvent de sortir les crocs lorsque l’adversaire arrive au niveau du rond central et de contrôler la progression adverse. Lors du match contre Manchester United, la gestion de l’espace est assurée grâce au positionnement défensif de Mancini, qui aide à former un 4-5-1 clair.

Sur d’autres rencontres, en phase défensive, on voit surtout qu’Eriksson s’assure un 4-1-4-1 permanent avec Almeyda devant les quatre défenseurs, une organisation qui permet, dès la récupération du ballon, à la Lazio de cogner vite et fort en contre. Le problème est que ce schéma demande un repli très discipliné des joueurs romains : sur ces phases-là, le bloc laziale a été à plusieurs reprises secoué au cours de la saison, notamment lors du premier derby de la saison (une défaite 4-1) ou face aux déplacements de Shevchenko, auteur d’un triplé lors du fameux 4-4, principalement à cause du manque de vitesse des latéraux, parfois incapables de compenser lorsque Nesta est effacé.
L’autre idée défensive d’Eriksson, au-delà du marquage en zone, est de densifier le côté ballon. Ainsi, à plusieurs reprises, la Lazio va enfermer un adversaire par des prises à deux via le dézonage de certains éléments, au risque de laisser le côté opposé complètement libre. Heureusement, la science des déplacements et la parfaite gestion des espaces des joueurs de Sven-Göran Eriksson ont souvent permis à la Lazio de s’en sortir, si ce n’est lors de rares noyades, notamment à Valence (5-2) lors du quart de finale aller de la Ligue des champions.
« Le destin a restitué ce qu’il nous a ôté la saison précédente »
18h04, le 14 mai 2000. Après un mois de janvier compliqué (deux nuls, une défaite à Venise) et avoir compté neuf points de retard sur la Juve à huit journées de la fin, la Lazio est sacrée championne d’Italie au terme d’un final de cinglé, marqué par quatre défaites de la Vieille Dame lors du grand huit final. Le dernier tour de piste est un alignement des planètes : sous le soleil de Rome, la Lazio roule facilement sur la Reggina (3-0) alors que la Juventus, elle, est battue à Pérouse sous un déluge impitoyable et par une frappe d’Alessandro Calori (0-1). Un an plus tôt, Eriksson avait vu le Milan s’imposer à Pérouse (1-2). « La vie est étrange, le destin nous a restitué ce qu’il nous avait ôté l’année précédente », confiera plus tard Roberto Mancini lors d’un entretien donné au Corriere dello Sport. Sven-Göran Eriksson, lui, vit le plus beau jour de sa vie, mais ne s’autorise pas à faire craquer le bouton de sa chemise.
Un journaliste l’interpelle : « Sven, c’est votre premier Scudetto… » Réponse : « Oui, mais j’espère que ce n’est pas le dernier. » Il Perdente Successo sourit, s’apprête à remporter la quatrième Coupe d’Italie de sa carrière quelques jours plus tard et devra attendre quelques jours pour voir la couleur du trophée, ce dernier étant à Pérouse.
Ancelotti, coach de la Juve à l’époque, affirme avoir été « battu par l’orage ». Eriksson rigole : « Si nous avions acheté Veron, Mancini et Mihajlović dès le départ, nous aurions peut-être remporté le titre à trois reprises. » La vérité est surtout que la Lazio a touché, cette saison-là, un sommet de brio collectif, de puissance et de maîtrise, sans grande révolution tactique – Bielsa dira à Simeone que la Lazio ne jouait « à rien » –, mais grâce au fait que tous les joueurs ont accepté de laisser Eriksson entrer dans leur tête. La suite était la conquête de l’Europe. Sven-Göran prendra finalement la porte six mois plus tard. Son héritage sera ailleurs : Roberto Mancini, Simone Inzaghi, Diego Simeone, Siniša Mihajlović ont tous enfilé un costume. Eriksson aurait-il mieux fait de sauver son mariage ? « Je ne pense pas, parce que je n’aurais jamais eu autant de succès si j’avais été plombier… »

Les matchs à revoir absolument :
– Manchester United-Lazio (0-1) – Supercoupe d’Europe – 27 août 1999.
– Lazio-Milan (4-4) – Italie – 3 octobre 1999.– Roma-Lazio (4-1) – Italie – 21 novembre 1999.
– Lazio-OM (5-1) – C1 – 14 mars 2000.– Chelsea-Lazio (1-2) – C1 – 22 mars 2000.
– Lazio-Roma (2-1) – Italie – 25 mars 2000.– Juventus-Lazio (0-1) – Italie – 1er avril 2000.
– Valence-Lazio (5-2) – C1 – 5 avril 2000.
Par Maxime Brigand