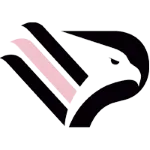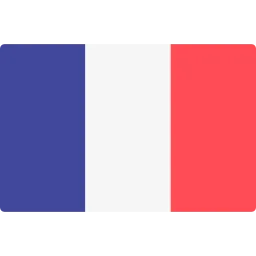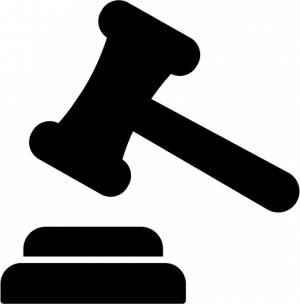- Top 50
- Châteauroux
Les 50 joueurs qui ont écrit l’histoire de Châteauroux (1er)
Ils ont écrit la belle histoire de la Berrichonne, ont connu la galère, un bout de D1, une épopée en Coupe de France, un aller-retour en C3, mais aussi celle d'une ville. Aujourd'hui, place au numéro un : Sébastien Roudet.

#1 - Sébastien Roudet
Comment tu pourrais me parler de ton enfance à Aubusson ?
Comme d’une enfance très joyeuse, avec un frère et une sœur. J’habitais dans les HLM de la ville, mon école était à cent mètres. J’ai grandi dans une famille où pas mal de personnes jouaient au foot, que ce soit mes oncles, mon père… Si tu veux, j’ai très tôt baigné dans le football. Le dimanche, j’accompagnais mon père à ses matchs, c’est comme ça que tout a commencé.
Tu voyais le foot comme un métier quand tu étais enfant ?
Pas du tout. L’objectif, pour moi, c’était de jouer avec les autres et donc au départ avec les enfants de ses coéquipiers. Quand j’allais avec lui au stade, je ne regardais pas trop le match, j’étais surtout sur le terrain d’à côté pour jouer, moi aussi.
Au moment où on a commencé à parler de toi dans les clubs de première division, ton père ne comprenait pas comment un joueur de foot pouvait coûter 35 millions de francs. Il avait notamment dit : « C’est la valeur de mon usine, comment un homme peut-il valoir cette somme ? » Tu as compris sa position ?
Au départ, il n’était pas du tout habitué au monde professionnel. Il jouait au foot en amateur, il découvrait l’univers pro et oui, ça a pu le choquer à un moment donné qu’un joueur de football puisse coûter autant que son usine. Mon père était ouvrier. C’est des sujets dont on a discuté ensemble et, si j’ai gardé des repères par rapport à l’argent, c’est en partie grâce à lui. C’est grâce aux valeurs que ma famille m’a inculqué. À cette époque, en plus, je n’étais pas autant médiatisé que maintenant, il n’y avait pas autant d’argent, c’était les années 90. Jouer au foot, c’était pour autre chose, c’était pour jouer dans des stades pleins, pour les supporters. J’avais un côté rêveur, l’argent, je n’y pensais même pas.
Tu avais un rêve ?
Sincèrement, non. Après, j’ai toujours eu ce côté compétiteur. Depuis tout petit, j’ai une haine profonde de la défaite et j’étais capable de me mettre dans des états inimaginables à cause de ça. J’avais horreur de ça. Donc, quand j’ai commencé le foot, c’était forcément présent.
Tu as quitté ta famille à l’âge de quatorze ans pour rejoindre le Sports Études de Romain Rolland, à Châteauroux. Tu avais conscience de passer éventuellement à côté d’une adolescence comme les autres ?
Les débuts ont été difficiles. C’est la première fois que je partais de chez moi même si je rentrais tous les week-ends. J’avais été faire les tests pour intégrer le Sports Études grâce à mon coach de l’époque, à l’ES Guérétoise, Dominique Merot. Moi, j’étais bien à Guéret, je jouais en honneur, j’étais surclassé, mais je ne pensais pas à rejoindre une structure pour le foot. C’est lui qui m’a forcé à le faire. J’y suis allé sans me projeter, mais je crois que j’ai terminé meilleur des tests de sélection. Je ne me rendais compte de rien.
Et Châteauroux, la ville, ça représentait quoi pour toi ?
J’avais jamais entendu ce nom. Je vivais en Creuse, je ne sortais pas trop d’Aubusson et, finalement, je connaissais surtout le nom des grandes villes. Bon, je savais qu’il y avait un club de deuxième division là-bas donc, quand tu viens de la Creuse, tu as forcément les yeux écarquillés devant ça. Et à Châteauroux, tout était beaucoup plus grand que chez moi, je passais d’un village de 5000 habitants à presque 60 000 personnes autour de moi, donc j’y ai forcément découvert pas mal de choses. Jusqu’ici, je ne jouais que sur des petits stades de campagne et là, tu avais un vrai stade de foot. C’est là-bas que je suis devenu adulte.
Avec qui tu t’es retrouvé au centre ?
Florent Malouda, Stéph’ Dalmat, Rodolphe Roche, Johann Paul, Vincent Di Bartolomeo… On logeait au CFA, le Centre de Formation des Apprentis. Tu avais les cuistos au premier étage, les coiffeurs au second et donc nous, au troisième. Il n’y avait que des mecs qui venaient plus ou moins de ma région donc c’était plus facile pour l’adaptation.
Vous êtes souvent présentés comme la première génération formée à la Berrichonne. Vous l’avez senti à l’époque ?
Si tu veux, le premier mec qui est vraiment sorti, c’est Dalmat quand la Berri était en D1. On allait le voir les samedis soirs, il faisait des gros matchs. Stéph’, c’était un phénomène, je pense même que c’est le meilleur joueur que le club a eu dans son histoire. On le voyait s’éclater sur le terrain et c’était forcément devenu un exemple, comme quand Flo (Malouda, ndlr) a commencé à jouer avec l’équipe première. Au centre, on était une quinzaine avec Roger Fleuri, c’était restreint donc ça a fabriqué une sorte d’émulsion, c’est normal.
Quand tu allais au stade, un mec te faisait rêver en particulier ?
Jason Mayélé, sans hésiter, c’était un régal. Il avait des qualités techniques, il avait un déhanché, il allait vite… Ferdi Coly, le capitaine, c’était aussi quelque chose, c’était le roc, et il y avait aussi Dudu devant. Avec la réserve, on s’entraînait souvent à côté d’eux donc on en prenait souvent plein les yeux surtout que le club était en train de monter en D1.
Tout à l’heure, tu parlais de Roger Fleuri, quelqu’un qui a beaucoup compté dans ta carrière.
Lui, c’était les anciennes méthodes, comme une sorte de professeur. Il était rude, mais efficace. Je sais qu’il a toujours été derrière moi et, si j’ai pu faire carrière, c’est en grande partie grâce à lui. C’est le premier qui m’a donné ma chance alors que quand je suis arrivé à Châteauroux, j’étais l’un des plus jeunes de ma génération. Sa force, c’est qu’il nous gérait de la même manière que les plus vieux. Moi, il m’a aussi accompagné car il savait que c’était difficile de ne pas avoir mes parents sur place. Il m’a pas mal soutenu, notamment lors de ma deuxième année où c’était plus compliqué pour moi. Je venais de passer au centre de formation, il ne restait que Vincent Bernardet de ma génération, donc c’était pas évident. C’était un confident, mais aussi un tuteur car il m’a aussi aidé à m’intégrer lors de cette période. On discutait souvent dans son bureau, on était très proches et il discutait aussi souvent avec mon père.
Ton père avait peur de ce milieu ?
Comme il ne connaissait pas ce monde-là, que je suis l’aîné de la famille, oui, il avait forcément un peu peur. C’est quelque chose qui leur a fait drôle, même s’ils ne me l’ont pas dit.
Tu nous expliquais il y a quelques semaines que quand tu étais chez les jeunes, vous ciriez les chaussures des anciens aussi. Tu t’en rappelles ?
Oui, mais pour nous, c’était normal ! On avait le vestiaire des chaussures en commun avec le groupe pro donc il fallait laver leurs chaussures. On allait les récupérer dans leur casier. C’était aussi ça la méthode Fleuri. Je ne regrette pas parce que ça m’a appris beaucoup de choses.
Comme ta rencontre avec Joël Bats.
Humainement, c’est une très très belle personne. C’est lui qui m’a lancé dans le monde professionnel en novembre 98. Il me faisait jouer attaquant à ce moment-là. Je marchais pas mal avec la réserve à cette période donc il avait décidé de me faire confiance. Il m’a appris d’abord pas mal de choses sur le jeu, sur comment m’orienter par rapport à un défenseur par exemple ou comment progresser sur mes appels. C’est des détails techniques, mais qui m’ont énormément servi pour la suite. On ne s’est pas connus très longtemps, mais il me faisait pas mal bosser en individuel après les séances. On travaillait devant le but, à deux, avec un gardien et j’ai grandi dans mon appréhension des phases offensives grâce à ces moments-là.
Vous partagiez aussi pas mal de valeurs en commun, non ?
Oui, il est très nature, comme moi. C’est un chasseur aussi. Joël, c’est aussi une personne discrète, comme moi. C’est ce qui nous a rapproché je pense. Même si, finalement, ça s’est pas très bien terminé pour lui au club à cause des résultats et du fait qu’il était incompris des dirigeants je pense.
Quand as-tu commencé la chasse ?
Au départ, j’accompagnais mon père et mes oncles. J’ai vraiment commencé à y aller sérieusement quand j’étais à Lens, c’est là que j’ai eu mon permis de chasse. Mais bon, il faut trouver le temps. J’adore ça, je me retrouve dans la nature, c’est des moments de répit où je peux m’oxygéner, découvrir des choses, des animaux…
Après Bats, tu as découvert Thierry Froger, quelqu’un au caractère complètement opposé.
C’est lui qui m’a fait le plus confiance à mes débuts. Il m’a replacé dans le couloir gauche alors qu’à la base j’étais attaquant. J’ai enchaîné les matchs comme ça, j’étais quasiment tout le temps titulaire avec lui, dans un 4-4-2 qui me convenait parfaitement. Froger, c’est le gros point de départ de ma carrière finalement. Il avait ses manières, son caractère, on adhère ou on adhère pas, mais quand on est jeune, on adhère tout de suite. On ne se pose même pas la question.
Avec Zvunka, c’était pareil ?
Victor Zvunka, c’était différent. Il a, à mon avis, un amour sincère pour ce club, qui est réciproque d’ailleurs. Pour moi, c’est LE coach de Châteauroux. Il a marqué les gens parce qu’il a emmené le club en D1 mais aussi en finale de la Coupe de France en 2004. La Berri n’avait jamais connu ça et lui, c’est un passionné. Il avait une voix, une prestance et une rare sincérité.
Quand tu marques en demi-finale de cette épopée contre Dijon, qu’est-ce que tu ressens ?
C’est sans aucun doute l’un des meilleurs moments de ma carrière. D’accord, je ne connaissais pas encore les émotions de la Ligue 1 mais là, marquer le premier but d’une demi-finale de Coupe de France, c’était fort, intense. Ce qui me marque, c’est surtout les images de Gaston-Petit plein, cette atmosphère particulière. Après le but, j’étais parti sur le côté, j’ai fait l’avion tout le long de la ligne. Je fais du foot pour ça, pour ce genre de sensations.
C’était quoi le secret de ce groupe ?
On était une vraie bande de potes quoi. Cette année là, on était mal partis en championnat et on ne s’était relevés que sur la fin, mais le coach Zvunka voulait surtout qu’on prenne du plaisir. Même quand on perdait, on avait proposé du jeu, ça ressemblait à quelque chose sur le terrain. En tant que milieu de terrain, c’est que du bonheur. Et Victor, c’était le chef de l’armée, il y avait de la discipline, mais on le suivait.
Tu te rappelles la préparation de la finale contre le PSG ?
On était partis en mise au vert au château de Chantilly grâce à Michel Denisot. Puis, la veille du match, on s’était entraînés au stade de France. Ça, c’est vraiment un moment où tu en prends plein les yeux, surtout que le groupe était assez jeune. On était les petits mecs de Ligue 2, de Châteauroux, qui débarquait au stade de France et en plus face au PSG. Forcément, ça reste. Mais le jour J, on se fait planter sur un coup de pied arrêté, mais je reste persuadé qu’on pouvait mieux faire.
Qu’est-ce qu’il a manqué ?
On découvrait donc forcément, se retrouver avec autant de supporters venus de Châteauroux derrière nous, dans un tel stade, où l’on va rencontrer le président de la République, c’est pas commun. On était peut-être un peu intimidés au départ et on a mis un peu de temps à se lâcher, mais, finalement, on a fait jeu égal avec ce PSG. On a eu des occasions, j’en ai eu une belle, David Vandenbossche aussi… Et Pauleta, lui, il ne lui en faut pas cinquante. Mais quand on a vingt ans, le stade de France, c’est pas facile.
Et la rencontre avec Chirac ?
C’est marquant ! On avait aussi croisé Nicolas Sarkozy à côté des vestiaires avec Patrick Trotignon, donc forcément, c’est des moments qu’on ne peut pas oublier. Jacques Chirac nous avait félicités après le match, c’était sympa, mais le gros truc, c’était peut-être surtout le midi du match. Bernard Laporte était venu nous voir pour nous briefer sur l’approche de l’événement, nous parler de son expérience avec l’équipe de France de rugby, c’était sympa. Il voulait nous donner des clés pour gérer la foule et la pression.
Finalement, tu quittes le club après cette défaite. Ça a été dur ?
(Il souffle) J’aurais aimé partir sur une victoire en Coupe de France, je suis quelqu’un qui aime bien partir une fois les choses bien faites. J’avais pas mal de sollicitations, j’étais en fin de contrat et j’ai donc choisi Nice. Oui, ça m’a fait bizarre de partir de Châteauroux, j’y étais depuis mes quatorze ans. Je suis parti, j’en avais vingt-trois. C’est un truc qui marque, je suis devenu un homme dans cette ville, dans ce club.
Tu étais depuis plusieurs saisons vu par les dirigeants comme un « actif » financier. Comment on vit avec cette étiquette ?
Moi, si tu veux, je ne me préoccupais pas trop de l’extrasportif. Je laissais ça à mon agent et mes parents qui surveillaient ça de près. Au tout début, quand j’avais fait ma meilleure saison à dix-neuf ans, j’avais pratiquement tous les meilleurs clubs de Ligue 1 derrière moi avec des propositions concrètes. Jamais mon agent ne m’a conseillé de partir à tel ou tel endroit. Il m’a laissé faire mon propre choix. Je voulais rester encore une ou deux saisons supplémentaires en Ligue 2 pour continuer à me préparer à la Ligue 1 et, derrière, je fais une moins bonne saison. Et, d’un coup, je perds les contacts que j’avais eu et tout ça n’est revenu qu’avec la finale de Coupe de France.
Tu n’as jamais voulu partir à l’étranger ?
J’ai toujours été intéressé par l’Angleterre même si, vu à quel point ce championnat est physique, je n’y aurai probablement pas fini tous les matchs (rires). C’était surtout pour l’ambiance que j’aurais aimé connaître ce football là.
Quand tu es revenu au club à l’été 2014, tu as reconnu la Berrichonne que tu avais quittée ?
Pas tellement en fait… C’était les mêmes personnes qui s’en occupaient, mais l’effectif avait changé, le groupe était plus jeune… En réalité, c’est surtout les mentalités qui m’ont dérangé pour être honnête. Je savais que le club connaissait une période de transition, voulait repartir sur de nouvelles bases, que j’avais en partie été recruté pour amener mon expérience, mais malheureusement, on a sombré cette saison-là. Je ne regrette pas d’être revenu, mais j’aurais aimé que ça se passe autrement. J’avais signé trois ans, je voulais finir ma carrière à la Berrichonne, mais on voit que dans le foot, il ne faut rien prévoir. Je ne reconnaissais plus mon club sur ce qu’il était devenu et ça me faisait plus de peine qu’autre chose. La saison précédente, où l’affaire Luzenac avait permis à la Berri de rester en Ligue 2, aurait du servir de leçon, mais ça n’a pas été le cas. C’est comme ça, mais c’est dommage. Je suis donc parti et j’ai laissé mes deux dernières années de contrat au club. Je ne voulais pas que ça se finisse comme ça.
Propos recueillis par Maxime Brigand