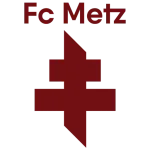- Belgique
- Anderlecht
« Le football les a réunis, mais c’est la bagarre qui a forgé les amitiés »

Pendant deux ans, les journalistes Barthélémy Gaillard et Louis Dabir ont pu infiltrer le Brussels Casual Service, le célèbre groupe des hooligans d’Anderlecht. Entre trafic de cocaïne, bitures homériques et bagarres dans les bois, ils racontent ici leur immersion dans cette contre-société cimentée par la violence et le rejet de l’ordre établi.
D’ordinaire, le monde du hooliganisme est un microcosme assez fermé. Comment avez-vous eu la possibilité de rencontrer les membres du Brussels Casual Service ?Louis Dabir : On cherchait depuis longtemps à s’infiltrer dans ce milieu. Il y a quelques années, on a pu échanger avec des mecs des Boulogne Boys, mais c’était compliqué, on a pris des portes. Finalement, une opportunité est apparue en Belgique grâce à un photographe, Hadrien Duré, qui nous a introduits. De fil en aiguille, on a rencontré Stéphane, un des deux leaders du groupe, pour un premier article qui a été publié sur le site de Vice.Barthélémy Gaillard : Les gars du BCS ont bien aimé l’article, car on ne les a pas présentés comme des barbares ou des abrutis dénués de tout sens commun. C’est comme ça qu’on a gagné leur confiance. Petit à petit, les portes se sont ouvertes, ils ont accepté d’aller plus loin dans les confidences et on a fini par rencontrer une trentaine de membres.
LD : On a parfois été surpris de voir à quel point certains avaient envie de se confier sur leurs exploits passés. On ne s’y attendait pas. La majorité des membres ont désormais cinquante piges, ils sont tous fichés par les keufs, tous interdits de stade. Bref, ils n’ont plus grand-chose à perdre… Ce livre, c’est un moyen pour eux de faire parler du groupe, de se rappeler leur âge d’or. On est vraiment dans une logique testamentaire.
Vous avez passé des week-ends entiers à Bruxelles et à Anvers pour recueillir leurs témoignages. Comment se passaient les rencontres ? BG : Ils se retrouvent dans un bar d’Anderlecht qui fait office de QG. Ce qui est frappant lors de ces réunions, c’est l’insouciance qui les anime. On dirait une bande de potes du collège… Sauf qu’eux, ils n’ont jamais arrêté les conneries. Aujourd’hui, ils sont sur le déclin, mais ils continuent de se battre de temps en temps, prennent des grosses traces, boivent comme des trous et se tapent des barres en racontant leurs souvenirs, du genre : « Eh, tu te souviens de la fois où t’as tapé un mec à Copenhague avec une saucisse ? » LD : Franchement, ce sont des machines. Je ne sais pas comment ils font. J’ai 25 ans de rugby derrière moi, des bières j’en ai bu, mais leur hygiène de vie, c’est autre chose. Ils passent leur week-end à faire la fête, se couchent à l’aube et réattaquent à 9h du matin à la bière. À cause d’eux, j’ai dû faire des trucs que je n’aurais jamais pensé faire, comme aller chercher un coca au bar et dire que c’était du whisky coca…

On sait depuis longtemps que les hooligans ont un faible pour l’alcool. En revanche, ce que l’on apprend à la lecture de votre livre, c’est que les frontières avec le banditisme sont poreuses. Stéphane, l’un des deux leaders du groupe, a par exemple aidé un ancien membre à s’évader de prison…BG : Aussi surprenant que cela puisse paraître, la présence de délinquants est vraiment constitutive de l’identité du groupe. LD : C’est un phénomène assez rare en Europe de l’Ouest. Dans chaque groupe de hooligans, tu as deux ou trois mecs qui font du business pour dépanner les copains avec une barrette, mais dans le cas du BCS, on n’est pas sur une logique d’arrondir ses fins de mois, on est vraiment sur un taf à plein temps. Par exemple, Diabolik, le mec de la Lazio qui s’est fait tuer récemment d’une balle dans la tête, était un énorme dealer. Mais son groupe, les Irréductibles, n’est pas pour autant constitué de délinquants.
BG : Comment l’expliquer ? L’appétence pour la violence naît dans les années 1980, à un moment où la délinquance explose en Belgique. Les journaux de l’époque parlent d’un « problème jeune » avec des bandes qui se réunissent un petit peu partout dans la ville, stimulées par la house music et les drogues de synthèse. Bientôt, chaque quartier a sa spécialité, du racket au vol de bagnoles, en passant par les braquages des commerces de proximité. Entre les différentes bandes se développe bientôt une rivalité territoriale et un sentiment d’appartenance qui seront plus tard exportés au stade. LD : Les membres du BCS ont tous scellé des amitiés fortes dans la rue. Avant même d’entrer dans le monde des tribunes, ils ont été initiés à la délinquance par les grands frères du quartier… Par exemple, plusieurs hooligans ordinaires de la Roue, un quartier de Bruxelles, nous ont expliqué avoir été formé par Patrick, le « Mozart des Bingos » … C’était un gars qui arpentait chaque matin les petits cafés des bords de route avec ses potes : il faisait semblant de jouer au bingo tout en manipulant l’aimant avec une corde à piano. De quoi gagner à tous les coups. Grâce à cette combine, Stéphane s’est fait environ 5000 euros par mois pendant onze ans… BG : Petit à petit, c’est l’escalade dans la délinquance. C’est principalement dû à un effet d’entraînement et de surenchère au sein du groupe, jusqu’à l’instauration d’une vraie culture gangster. On la voit notamment avec Claude Silverans, qui a un temps été l’un des lieutenants de Patrick Haemers, le « Jacques Mesrine belge » . Pendant deux ans, il allait se taper au stade avec les gars du O’side, l’ancêtre du BCS. À niveau égal, il y en a qui sont montés haut et d’autres qui ont stagné, ça dépend des parcours. Mais ce qu’il faut bien comprendre, c’est que beaucoup ont des réflexes et des attitudes de crapules avant même d’être hooligans.
Comment s’opère le passage de la rue aux tribunes ? BG : Le début des eighties, c’est la période où Anderlecht est à son apogée sportive, avec notamment la victoire en 1983 en Coupe de l’UEFA. Les mecs de chaque quartier, les skins, les anars, commencent à se retrouver au stade pour supporter l’équipe de leur ville. Ils y importent leur rivalités territoriales, commencent à se taper, mais ils se rendent vite compte qu’ils ont des ennemis en commun, à savoir les supporters adverses. LD : Il faut comprendre qu’à cette époque, les supporters d’Anderlecht ne sont pas pris au sérieux en Belgique, ils se font souvent casser la gueule et racketter, tout le monde se fout un peu de leur gueule. BG : Le moment fondateur, c’est la prise de la tribune O, derrière les buts, où les supporters adverses s’installaient d’ordinaire. Du jour au lendemain, les jeunes des quartiers d’Anderlecht décident de s’unir et chargent dans le tas pour prendre la tribune. C’est la naissance du O’Side. C’est pas un truc spectaculaire en soi, mais cela envoie un message : « Le kop derrière les buts, maintenant, c’est chez nous. » C’est à ce moment que les Anderlechtois redeviennent maîtres de leur stade. LD : C’est la pratique du taking of an end, qui est à la base de la culture hooligan. L’idée, c’est d’aller prendre un lieu et de dire : « Cassez-vous, on est chez nous ! » Il y a vraiment cette logique d’aller sur le terrain de l’autre, de défendre son fief. Un des anciens du BCS, nommé Roland, a émigré à Londres dans les années 1980, car il avait été fasciné par les fans de Southampton en visite en Belgique. C’est lui qui a ramené toute cette sous-culture anglaise auprès de ses potes et qui les a formés. Encore aujourd’hui, il fait office d’encyclopédie du hooliganisme au sein du BCS.
En parlant d’encyclopédie, les hooligans ne sont pas les bourrins qu’on peut imaginer. Ils viennent de milieux sociaux assez diversifiés. Par exemple, Xavier, l’un des deux leaders du groupe, a fait des études poussées. LD : C’était un très bon élève. Il a été journaliste sportif, puis a obtenu un poste dans une grande entreprise en Belgique. C’est un mec fascinant, car la dernière fois qu’on est allés le voir en Allemagne, il écoutait de l’opéra en lisant un livre sur les peintres impressionnistes. Avant chaque baston à l’étranger, il se fait une petite sortie culturelle, il va au musée… C’est un personnage déroutant… BG : Il aurait pu percer dans le journalisme, mais il a très vite été limité par sa passion pour la violence. Quand il était journaliste sportif, il s’est retrouvé à se taper sur la pelouse d’Anderlecht, alors que ses collègues étaient en tribunes ! Une dualité difficilement tenable sur le long terme. Du coup, il est devenu détective privé. LD : C’est un redoutable fighter, mais il passe le plus clair de son temps à entretenir des liens dans toute l’Europe avec les autres groupes. C’est un mec qui a une aura dans le monde du hooliganisme, et pas seulement à Bruxelles. Il est prêt à faire 800 bornes pour voir ses potes de Leeds, et sur le chemin du retour il va au Luxembourg voir un Progrès Niederkorn-Glasgow pour rencontrer le leader des Rangers… Bref, c’est le VRP du BCS.
En matière de parcours tortueux, l’exemple le plus parlant est celui de Gonzalez… LD : Son histoire est emblématique du groupe. Une véritable success story. Le type est costaud. En parallèle de ses activités au stade, il commence à être portier, puis videur de boîte de nuit. Le fait qu’il soit pote avec des hooligans rassure ses patrons : si jamais il se fait péter la gueule, tu sais qu’il va ramener 50 potes pour régler la situation. Bref, c’est une assurance dans le monde de la nuit. Sans que cela soit délibéré, ses relations vont lui permettre de commencer à gérer un bar, puis deux, puis trois… Jusqu’à devenir le roi des bars à hôtesses de Bruxelles. BG : Aujourd’hui, il a tellement réussi professionnellement qu’il ne lui reste plus que des affaires légales. En ce moment, il gère des immeubles à Marbella. Son parcours montre bien comment l’amitié entre différents membres du BCS les amène à s’entraider professionnellement, à tous les niveaux. Dans la vie comme dans les tribunes, l’union fait la force.LD : Le seul contre-exemple dans le groupe, c’est Zoulou. C’est un mec qui a toujours compartimenté sa vie de famille, sa vie de hooligan et sa vie de trafiquant de drogue international.
Racontez-nous ses exploits…LD : C’est un Belge d’origine marocaine, néerlandophone, qui est né à Hasselt d’un père mineur. Quelqu’un de très doux, de très sympa, alors qu’en réalité, il fait partie des deux ou trois fightersles plus cruels d’Anderlecht. À l’adolescence, il commence à vendre de la drogue au quartier. Il fait ça parce que c’est à la mode, mais il se rend vite compte qu’il se fait un max de thunes. De fil en aiguille, il passe à la cocaïne, aux ecstas, puis il intègre la Mocro Maffia, le réseau de la pègre marocaine dans le Benelux, et finit par gérer d’énormes flux en provenance d’Amérique latine… BG : Pour la faire courte, il s’est fait choper par la police après avoir importé 3-4 tonnes de cocaïne via une fausse société-écran d’import-export de bananes congelées dans le port d’Anvers. Il est aujourd’hui en cavale. Il a été condamné à 15 ans de prison et il a disparu. On n’en sait pas plus. Quand on l’a interviewé, il était chez lui avec un bracelet électronique, mais cela ne l’empêchait pas de faire du business avec l’Amérique du Sud…LD : Dans le groupe, c’est le seul qui n’a pas accédé à la criminalité grâce au hooliganisme. Pour lui, le BCS, c’est simplement une fenêtre de liberté. Dans son métier, il a du mal à se faire des potes. (Rires.) Il a trouvé ça dans le hooliganisme. Faire corps avec les mecs du BCS, cela lui donne le sentiment de partager.

Quels sont les plus grands faits d’armes du BCS ? BG : Entre deux pintes, on a entendu une avalanche de récits et de combats, parfois difficiles à recontextualiser… Il faut savoir que les hooligans adorent raconter leurs anecdotes en exagérant un peu, c’est souvent drôle. Chaque baston participe de la grande histoire du groupe. Cette histoire commune est plus importante qu’il n’y paraît puisqu’elle leur permet d’entretenir leur prestige et d’attirer de nouvelles recrues.LD : Ils nous ont beaucoup parlé d’un voyage à Trnava, en Slovaquie, lors d’un match de Ligue Europa. Les supporters slovaques se sont enfuis quand ils les ont chargés en plein centre-ville. Ils ont aussi eu des bastons homériques contre les Bad Blue Boys du Dinamo Zagreb, dont plusieurs membres ont participé à la guerre civile. Sinon, Alain, un des meilleurs fightersdu groupe, a brisé la jambe d’un des leaders des Headhunters de Chelsea en 2005. C’est son trophée personnel.
En matière de performance, il y a aussi eu les émeutes de 2008 à Anderlecht, ponctuées par des affrontements très violents entre les hooligans du BCS et la jeunesse belge d’origine maghrébine… LD : Ils se sont retrouvés à 400 hooligans d’un côté, 400 jeunes de l’autre. Au total, il y a eu trois jours de baston. C’était extrêmement tendu, il y avait toutes les télévisions du pays, des hélicos qui survolaient la zone… Les affrontements ont pu être évités de justesse grâce à la police qui a fait barrage à chaque fois, mais on était pratiquement sur une zone de guerre. BG : Ce qui a tout déclenché, c’est que le gamin d’un hooligan a été racketté par une bande d’adolescents de quinze ans devant le métro, avec leur bar juste à côté. C’est comme ça que c’est parti. On reste dans la logique territoriale, clanique. Venez pas nous emmerder chez nous, devant notre bar, dans notre fief.
Il y a aussi un fond de racisme ? LD : Les médias belges ont présenté ça comme des émeutes raciales, mais d’après nos différents entretiens avec les hooligans et les travailleurs sociaux, on est vraiment sur des logiques de territoire. Les gars du BCS n’aiment pas les Marocains, c’est un fait, mais ce n’est pas lié à la couleur de peau. Ce sont des rivalités territoriales. Leur discours, c’est de dire que si ça avait été des Chinois ou des Belges en face, ça aurait été la même chose. Peut-on parler de racisme ? Je n’en ai pas l’impression, mais certains peuvent avoir d’autres lectures.BG : Cela fait un peu Nadine Morano qui dit « J’ai un ami noir », mais au sein même du BCS, tu as des Albanais, des Marocains, des Algériens… Il y a aussi Alain qui est d’origine congolaise. Bref, différentes origines qui sont toutes cimentées par leur amour de la violence, leur appât du gain et leur haine de l’ordre établi. LD : Attention, on ne dit pas que le racisme n’existe pas, certains membres sont clairement limite sur le white power, on dit juste que c’est un peu plus complexe que ça. Sur un groupe qui peut monopoliser 400 personnes pour les grandes occasions, les leaders ne vont pas vérifier si untel ou untel est raciste. Non, l’important pour eux, c’est la capacité à combattre. Que tu sois blanc, noir ou asiatique, la seule chose qui compte, c’est d’avancer les poings fermés.
Il y a tout un folklore médiéval dans la conquête de territoire. À la lecture de votre livre, on a presque l’impression d’être confrontés à des chevaliers en croisade… BG : C’est difficile à croire, mais les hooligans tirent de leur activité un prestige aristocratique. Ils aiment se considérer comme la crème de la crème des tribunes. À leurs yeux, les autres supporters des tribunes sont des gens aliénés… À la différence du mec qui va au stade et qui crie « allez les mauves » tous les six mois, les hooligans estiment ne pas être dans une attitude passive et consumériste. Ils sont prêts à se faire péter la tronche pour défendre leurs couleurs dans le championnat parallèle qu’est le hooliganisme. À leurs yeux, cela leur confère un prestige que les autres supporters n’ont pas. LD : Ce qu’ils aiment profondément, c’est se confronter ensemble à l’adversité. Ils y trouvent une forme de fraternité qui n’existe plus dans les sociétés modernes. Il y a tout un code d’honneur dont ils se rengorgent… Le ciment du groupe, c’est le combat. Quand tu saignes, que tu te fais mal, que tu transpires en première ligne avec un mec, quand tu sais qu’il ne va pas s’échapper quand ça devient dur, cela crée des liens indéfectibles. Le football les a réunis, mais c’est la bagarre qui a forgé les amitiés… BG : Cette logique élitiste, on la retrouve au sein du groupe. La hiérarchie est claire : plus tu es fort, plus tu figures dans les premiers rangs.
Malgré leur fierté, la société porte sur leurs activités un regard très sévère. Comment vivent-ils ce décalage ?BG : Ils se sentent stigmatisés. Ce sont des gens profondément violents, mais ils l’assument. Leur argument, qu’on retrouve à chaque fois, c’est de répéter qu’ils sont consentants. Les mecs en face sont chauds, ils sont là pour ça. Ils ne sont pas en train de taper une petite vieille ou un supporter lambda.LD : Ils prennent souvent l’exemple du MMA. Ils ne comprennent pas pourquoi ces mecs ont le droit de se mettre sur la tronche dans une industrie qui brasse des millions d’euros et pourquoi eux, on les empêche de se retrouver sur un terrain vague. Ils vivent très mal la répression. Elle est pourtant compréhensible : tu ne vas pas au stade pour voir des chaises qui volent et des mecs qui se battent avec des tessons de bouteilles… BG : Le groupe en lui-même n’a pas de fonction politique, ils ne sont pas militants, mais la violence étatique revient souvent dans leur discours : « L’État nous vole notre argent, nous confisque notre liberté. » Ce sont des gars qui ne croient pas du tout en la politique. Mais il y a unité autour de certains thèmes, comme par exemple celui de la liberté individuelle. LD : Ce sont des gens qui ont un côté très libertaire. Ils estiment que ce qu’ils font n’est pas de l’ordre d’une violence illégitime ou immorale. Il existe à leurs yeux d’autres formes de violence beaucoup plus révoltantes dans nos sociétés modernes, comme l’islam radical ou la fiscalité. Dans leur tête, on laisse bien les couples échangistes faire ce qu’ils veulent, on laisse les drogués se shooter, alors pourquoi pas eux ?
Tout simplement parce que depuis le drame du Heysel, en 1985, les hooligans sont devenus la hantise des autorités sportives.LD : Le Heysel, c’est vraiment le point de départ. C’est le moment où les autorités ont pris conscience du problème hooligan et de la vétusté des stades. Avant, ces derniers pouvaient faire pratiquement tout ce qu’ils voulaient et s’en sortir avec une simple garde à vue. Dès le milieu des années 1990, on assiste à la mise en place d’un appareil législatif répressif, avec des amendes et des peines de prison avec sursis. BG : Le véritable tournant, c’est l’Euro 2000, que la Belgique a co-organisé avec les Pays-Bas. C’était censé être la grande kermesse du hooliganisme. Il y a eu des débordements, mais grâce à la loi football, qui a été promulguée en décembre 1998, le pire a été évité. Cette dernière permet un contrôle plus fouillé des environs du stade sur un rayon de 10 km. Il y a aussi eu la mise en place des « spotters », une police spécialisée. À partir de ce moment, les hooligans n’ont plus été aussi libres de leurs mouvements. LD : Aujourd’hui, la plupart des membres du BCS sont interdits de stade. On assiste donc à l’avènement d’une nouvelle génération qui a grandi avec cette réglementation forte. Ils ne peuvent plus faire comme les anciens, alors ils s’adaptent. Si tu les chasses des cinq grands championnats, ils se retrouvent en quatrième division. Et si tu les empêches de venir au stade, ils se donnent rendez-vous dans les bois. BG : À ce titre, on a pu assister à une baston entre la nouvelle vague du BCS et les hooligans de l’Olympique lyonnais. C’était du 10 contre 10, avec des gants, dans la forêt. Cela n’a même pas duré une minute, alors qu’ils avaient passé la semaine à se monter le bourrichon en mode : « On va les défoncer. » LD : Les mecs, ils mettent la vaseline, les protège-dents, les gants et ils s’échauffent comme avant un match de boxe… Ils s’encouragent comme dans un vestiaire de rugby : « Allez les gars, ensemble, on reste groupés »… J’ai ressenti un certain malaise en voyant ça. Ce n’est pas vraiment dangereux, cela se rapproche du sport de combat, mais on est en droit de se demander où est le foot dans tout ça.
Comment est-ce que les membres historiques vivent ce renouveau ? BG : Les figures historiques du BCS sont dépassées par cette nouvelle culture. Ils ne la comprennent pas forcément, ils n’y adhèrent pas, ressentent une forme de nostalgie. On pourrait presque parler d’une querelle entre les anciens et des modernes. Néanmoins, les anciens du BCS sont quand même contents qu’une nouvelle génération apparaisse et prenne le relais. LD : Le fond du problème, c’est qu’il y avait beaucoup plus de spontanéité dans le hooliganisme qu’ils ont connu. En mode, on est au bar et si les mecs sont là, on est là. À la limite, on les cherche un peu autour du stade à la fin, mais on n’est pas sur un rendez-vous calé à l’avance. Ils déplorent cette perte de liberté. Un peu comme les anciens du O’Side qui ont délaissé le hooliganisme à force de se sentir fliqués.BG : Le seul de l’ancienne génération à avoir pris le tournant du free fight, c’est Luc. Il a 46 ans, c’est un nounours de 110 kilos avec une tête de père de famille tout ce qu’il y a de plus gentil et honnête. Contrairement aux autres, il a une vie réglée, une femme, des enfants, le même emploi depuis vingt ans dans une entreprise d’imprimantes… Pour lui, le hooliganisme, c’est avant tout une pratique sportive. Chaque week-end, il prend son Kangoo, roule 500 kilomètres pour se taper avec des petits jeunes dans une forêt un peu glauque d’Allemagne de l’Est, puis il rentre chez lui le samedi soir avec le nez pété et sa femme qui l’engueule : « Mais qu’est-ce que t’as encore branlé, Luc ? »… C’est assez touchant. Ces gars sont consumés par la violence. Ils sont prêts à engager des efforts démesurés pour s’affronter. Ils ont l’impression de se mettre en danger, de laisser parler une forme d’animalité qui révèle quelque chose de profond.
Comment voyez-vous le futur du BCS ? À terme, le hooliganisme est-il condamné à disparaître ? BG : Même si elle devient de plus en plus confidentielle, je n’imagine pas la pratique disparaître. Il n’y a qu’à voir les pays d’Europe de l’Est qui ont repris le flambeau. On est sur un degré de violence supérieur, avec un entraînement paramilitaire, des stages de boxe thaï… On l’a bien vu lors de l’Euro 2016 à Marseille, ils ne jouent pas dans la même catégorie. LD : Les membres du BCS se sentent sur la fin, c’est indéniable. Pendant les entretiens, j’ai parfois eu l’impression que certains étaient en train de lâcher l’affaire… Stéphane nous confiait qu’ils pensaient tous arrêter à cinquante ans, mais ils disaient déjà la même chose il y a dix ans. Ils repoussent toujours l’heure d’arrêter. Pour eux, c’est un mode de vie. BG : En décembre dernier, alors qu’ils nous parlaient de retraite depuis six mois, ils sont tombés sur un groupe de supporters liégeois et ils les ont éclatés. Selon les échos qu’on a eus, cela faisait au moins dix ans qu’ils n’avaient pas connu une telle baston. Apparemment, c’était exceptionnel, parce que ça a duré plus de dix minutes, ce qui est extrêmement rare. Le bilan est de huit blessés, dont trois policiers, ainsi que plusieurs voitures endommagées… Bref, une nouvelle grande page de l’histoire du BCS. LD : Du coup, on attend de voir avant de se prononcer. (Rires.) La violence, c’est comme une drogue, c’est dur de décrocher. À chaque fois, ils promettent à leur femme de ne plus jamais faire de hooliganisme, et au bout de six mois, ils explosent en vol. C’est comme les anciens alcoolos, tant qu’ils sont abstinents tout est ok, mais il suffit d’une larme et c’est terminé. Ce sont des gars qui peuvent replonger à tout moment par amour de la violence pure.
Gangs of Brussels de Barthélémy Gaillard et Louis Dabir (Le Cherche-Midi, 18€)
Tottenham attaque le propriétaire de l’OGC NicePropos recueillis par Christophe Gleizes