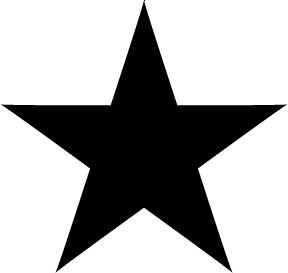- Coupe de la Ligue
- 16es
- Nantes-Angers
Le Dizet : « Le jeu à la nantaise, c’était du bonheur »

Après quatorze années passées à Nantes dans la peau du joueur et de l’entraîneur, Serge Le Dizet revient une fois de plus à la Beaujoire avec Angers. L’occasion pour le coach adjoint de Stéphane Moulin de parler de sa carrière... et de sa Bretagne. Interview.
 Nantes – Angers
Nantes – Angers  21h00 – Canal + Sport
21h00 – Canal + SportQuestion existentielle : Nantes, c’est breton ou pas ?Quand j’étais à Nantes, je disais toujours sous forme de boutade que les Nantais ne prenaient que les bons côtés de la Bretagne. Ils ne sont bretons que quand ça les arrange ! Disons que les Rennais sont tous bretons, en toutes circonstances. Les Nantais, ça dépend…
La Bretagne, vous y êtes né, vous y avez passé votre carrière de footballeur… Elle représente quoi, cette région ?Effectivement, je suis né dans le Finistère. Pour moi, ce sont les racines, c’est la mer, c’est la terre… C’est une belle région qui a une vraie vie intérieure. Ma famille a toujours vécu en Bretagne.
Donc vous parlez breton ?Non. J’ai cinquante-deux ans, mais je ne fait pas partie de cette génération qui parle breton comme mes parents.
Je ne comprends pas cette langue, hormis les gros mots. Je ne suis pas du genre à accrocher le drapeau dans ma voiture. En revanche, je revendique le fait d’être breton et j’assume cette identité. À Angers, on se fait d’ailleurs souvent chambrer avec Romain Thomas par rapport au temps, à la pluie…
Vous avez joué de longues années au Stade rennais. Pourquoi ça s’est terminé d’un coup, comme ça, en 1992 ?J’avais vingt-huit ans, et j’avais beaucoup connu la Ligue 2 avec Rennes. Seulement deux années de Ligue 1. La première année dans l’élite, on devait descendre, mais on a été repêchés. On avait enchaîné une deuxième année en première division, encore relégué. Pourtant, je sentais que j’avais le niveau L1. Je m’y plaisais, en plus. J’en avais assez de faire l’ascenseur. À l’époque, c’était la petite blague : « Qu’est-ce qui est rouge et blanc, qui monte et qui descend ? » Donc cette année-là, j’ai pensé un peu à moi. Je ne savais pas si le club serait capable de remonter derrière. D’ailleurs, ils ont mis trois ou quatre ans à le faire. J’étais bien, j’avais trois ans de contrat, Charles Biétry souhaitait absolument me garder… Mais je me suis dit : « Ton ambition, elle est où ? »
Vous signez alors à Nantes…J’ai eu plusieurs sollicitations, dont Sochaux. Nantes, c’était un petit risque à l’époque, ils avaient des problèmes financiers et n’étaient pas sûrs de pouvoir repartir en L1. J’ai longtemps hésité avec Sochaux. Le recruteur des Canaris m’avaient appelé plusieurs fois pour me dire : « Viens à Nantes, tu ne connais pas, mais tu vas encadrer de très bons jeunes, comme Claude Makelele, Nicolas Ouédec… On a un bon groupe en devenir. » Du coup, il m’a convaincu. Un an après, Sochaux descend et nous, on est européen. Comme quoi, une carrière se joue à peu de choses.
Vous retenez quoi de votre expérience de joueur là-bas ?J’ai eu la chance de vivre beaucoup de choses extraordinaires. Je dirais que le quotidien était magique.
La notion « prendre du plaisir » à l’entraînement, ce n’était pas une vaine expression. Tous les jours, on s’éclatait avec Jean-Claude Suaudeau, puis Raynald Denoueix. Avec le football collectif en point d’orgue. On parle souvent du jeu à la nantaise, mais je pense qu’il faut le vivre pour comprendre le bonheur qu’il nous procurait. Le plus grand moment, ce fut peut-être le titre de champion en 1995. On est quand même resté trente-quatre matchs invaincus. Puis jouer la Coupe d’Europe, et notamment une demi-finale de Ligue des champions, c’est fantastique. Même si j’ai été suspendu pour le match retour.
Ça, c’est pas de bol parce que vous n’avez reçu aucun carton rouge dans votre carrière !Ouais, zéro.
Comment vous expliquez ce jeu si propre et offensif à une époque où on demandait avant tout à un défenseur de bien défendre ?Je crois que je faisais simplement partie d’une équipe portée vers l’avant. Un des mots essentiels qu’on nous rabâchait, c’était l’anticipation. Moi, j’étais quelqu’un qui anticipait énormément le jeu de l’adversaire. Mon credo, c’était un peu ce que disait Jean-Claude Suaudeau : avoir un temps d’avance dans la réflexion, et donc avoir un temps d’avance dans la réalisation. C’était valable en défense comme en attaque. On avait une telle connaissance du partenaire… On savait ce qu’il allait faire dans n’importe quelle situation. Comme on était bons techniquement et physiquement, on allait plus vite que l’adversaire. Quand je voyais Patrice Loko demander le ballon à gauche, bah je lui mettais à droite par exemple. Parce que je savais que lorsqu’il partait à gauche, il la voulait à droite. Ce sont des choses qui se répètent, qui se travaillent. Pour moi, le jeu à la nantaise, c’était avant tout de l’intelligence collective.
Après cette belle période, vous devenez entraîneur. Vous arrivez très vite au poste de numéro un. Et ça ne s’est pas très bien terminé…Quand vous êtes entraîneur d’un club en Ligue 1, ça se termine rarement bien. Trois fois sur quatre, ça se finit par un départ et souvent un licenciement.
Paul Le Guen disait qu’il avait eu le privilège de partir de Lyon après trois titres de champion… Putain de privilège ! Dans le football, c’est extraordinaire. Pour revenir à mon cas, je me rends compte avec le recul qu’on m’avait donné une voiture déréglée de Formule 1, alors que je venais d’avoir mon permis. Si vous ne vous cassez pas la gueule au premier tour de piste, ce sera au quatrième ou au cinquième. Je savais que ça allait être difficile, mais on disait que le train ne passait qu’une fois… On s’est maintenu la première année, on termine quatorzième la seconde… Mais il y avait tellement de problèmes extrasportifs… Forcément, avec mon expérience actuelle, il y a des choses que je ne referais pas à l’identique. C’est évident.
Ce qui a mis fin à l’aventure, c’est aussi que vous étiez en désaccord avec la nouvelle politique du club, non ?J’aurais sûrement dû faire autrement de ce côté-là aussi. Au lieu de clamer haut et fort mes convictions, il aurait peut-être fallu garder mon énergie pour aller à l’essentiel, c’est-à-dire le terrain. Je me suis gouré de combat, quoi. Mais si ça a pu servir à long terme au club, tant mieux…
Vous gardez un lien privilégié avec ce club ?Je n’ai plus de proches au sein du FCNA. Mais je lui serai toujours reconnaissant de ce qu’il a pu m’apporter. Comment oublier les quatorze ans que j’ai passés en tant que joueur, entraîneur et responsable du centre de formation (Le Dizet a notamment sorti Jérémy Toulalan et Dimitri Payet, ndlr) ?
Une fois la porte nantaise fermée, vous êtes allés faire un tour à Dubaï. Pourquoi ce choix ?Psychologiquement, ce n’était pas évident d’en finir avec Nantes.
En plus, j’étais en plein divorce. C’était particulièrement difficile pour moi. J’ai eu cette opportunité, qui m’a permis de quitter cet environnement, de faire le vide. Fabrice Bryand, l’ancien médecin de Nantes, m’avait dit : « C’est ça ou les antidépresseurs ! » Ce fut éphémère, mais ça m’a fait du bien. Ça m’a reconstruit un peu. Je suis ensuite revenu dans le foot amateur afin de garder du temps pour mes enfants. Et aujourd’hui, je suis là, à Angers, adjoint de Stéphane Moulin, un poste qui me correspond bien.
Justement, le statut de numéro un, on a l’impression qu’il ne vous fait pas envie. Il vous fait peur ? À Nantes, j’ai obtenu mes diplômes d’entraîneur très tôt. Et très rapidement, on m’a considéré comme le nouveau Suaudeau ou le nouveau Denoueix. J’ai donc très vite été placé sur le devant de la scène pour devenir leur successeur. Moi, je me suis laissé bercer par tout ça. À force de lire ce genre de choses… Et vu comme ça s’est finalement passé, je n’ai pas forcément besoin de me retrouver dans la même position. Je suis très bien en adjoint.
Top 100 : Footballeurs fictifs (de 70 à 61)Propos recueillis par Florian Cadu