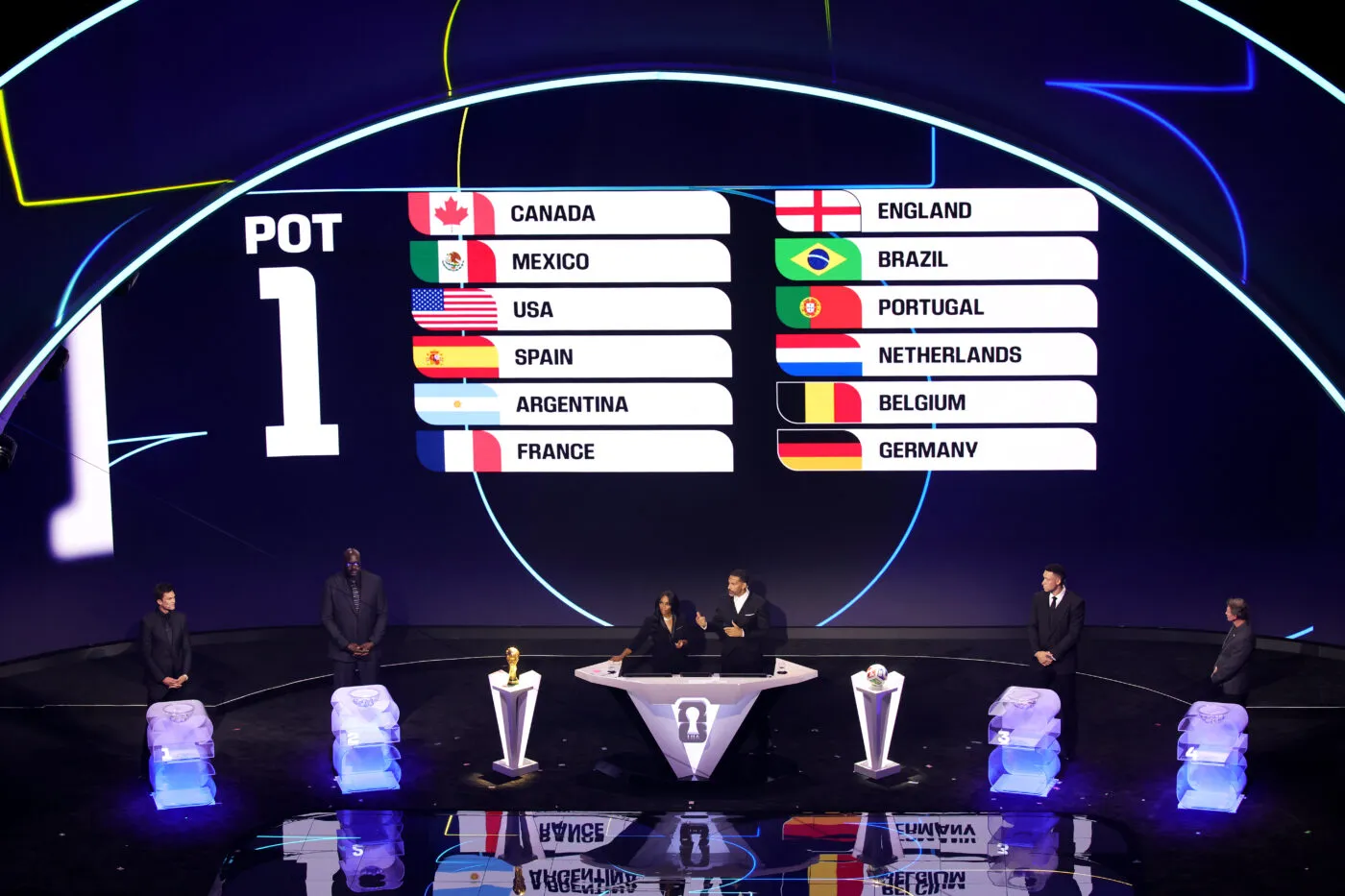Après quinze ans de carrière professionnelle, à quoi se résume la vie de Laurent Robert dorénavant ?
La vie de Laurent Robert maintenant ? Je suis père de famille, toujours avec la même femme et j’ai trois enfants. J’ai besoin de cet équilibre-là. J’ai eu la chance de vivre tous ces moments et de voyager avec ma famille. De terminer avec, aussi. Laurent Robert, c’est désormais une personne comme une autre. Ce que j’ai toujours été au fond. Beaucoup de gens pensent qu’on est différents parce qu’on a été joueur de football professionnel mais non, pas du tout. Je suis heureux d’avoir arrêté. Car c’est usant et il faut être vraiment passionné. Et j’ai été passionné durant toutes ces années. Il y a eu une carrière, mais elle est derrière moi désormais… Il y a une vie après. Par passion, je me suis mis au golf parce que je connaissais certaines personnes qui le pratiquaient. Ça change du foot. (rires).
Voilà cinq ans que tu as pris ta retraite. As-tu vécu cette fameuse « petite mort » que connaissent tous les footballeurs ?
Pas du tout. Comme je viens de te dire, j’étais vraiment très content d’arrêter. J’étais prêt dans ma tête. Ma femme a eu cette petite crainte-là. Mais non, j’étais vraiment prêt. Je m’étais déjà lancé dans pas mal de choses en parallèle. J’ai tourné la page facilement. Les médias, la presse, me contactent toujours, notamment en ce qui concerne le Paris Saint-Germain. C’est pareil en Angleterre où la presse anglaise me sollicite.
Ta carrière commence à Montpellier mais tu aurais très bien pu rejoindre le centre de formation de l’AJ Auxerre. Pourquoi avoir opté pour ce choix ?
Quand je quitte la Réunion pour la Métropole, mon premier club, c’était Brest Armorique. Avec la sélection de la Réunion, on venait juste de remporter la Coupe nationale des cadets. Je devais avoir 15 ans à cette époque-là. Il y avait pas mal de clubs, de centres de formation et de recruteurs présents. J’avais choisi Brest parce que c’était l’un des meilleurs centres de formation de France. C’était, aussi, l’une des grosses cylindrées des années 90-95. J’y suis arrivé en 1991. Mais le club a eu des problèmes financiers et a dû déposer le bilan. Puis vient ensuite l’épisode Auxerre. Je me retrouve là-bas parce que mon père avait donné l’accord à Guy Roux. J’avais juste à y aller mais j’avais pas mal de clubs qui me voulaient également. Arrivé sur place, j’appelle mon père et je lui dis que je ne peux pas rester là car il fait trop froid ! On est partis courir dans la fameuse forêt que tout le monde connaît si bien et je disais à mon père que ce n’était pas possible. Il y avait un Réunionnais qui jouait à Montpellier, Claude Barrabé. Ça a donc été bien plus simple pour moi de quitter Auxerre pour Montpellier. J’ai un grand frère qui est là, qui va m’aider si ça ne va pas. Et j’ai bien choisi.
Te souviens-tu de ton premier but ?
Je crois que c’est contre Martigues (en 1994, ndlr). Et c’était déjà un coup franc (rires). Je suis remplaçant, je rentre et le premier que je touche, je marque. Et on gagne 1 à 0.
Tu as connu le président Louis Nicollin, un sacré personnage. Cette gouaille, cette passion, ce phrasé légendaire, c’était déjà le cas à l’époque ?
Il a toujours été comme ça. Il faut le connaître. Paris, c’est une mentalité. Et dans le sud, c’en est une autre. Quelquefois, quand on l’entend parler, certains se disent : « Mais qu’est-ce qu’ils racontent ? Pourquoi il parle comme ça ? » Mais, pour nous, dans le sud, c’est rien. C’est presque normal. Donc quand il sort ses phrases, j’en rigole. Tout le monde parle comme ça dans le sud. Il a beaucoup d’affection pour tous les jeunes qui sortent de la Paillade. On connaît le personnage. Je l’ai toujours considéré comme un père. À chaque fois que j’ai eu besoin de lui, il a répondu présent. C’est une personne qui aime son club. C’est son club. Il a beaucoup investi dedans et il continue d’investir toujours autant. Grâce à lui – et grâce à moi aussi, évidemment – j’ai pu m’en sortir. J’ai passé toutes les étapes dans le centre de formation : aspirant, stagiaire puis professionnel. C’est vrai que j’ai été très bien conseillé. J’ai eu des super coachs au centre de formation, dont un qui n’est plus là aujourd’hui, Mama Ouattra. J’ai beaucoup appris auprès de lui. Cela a été beaucoup de plaisir. On me reparle encore beaucoup de Montpellier. Je vis dorénavant à Montpellier.
Est-ce vrai qu’il te réclame toujours des maillots ?
Non, je ne joue plus, j’ai plus de maillots ! (rires). Mais il a eu tous mes maillots.
Okocha, Ronaldinho et Anelka et moi, c’est vrai que ça aurait fait mal
Au cours de ton passage là-bas, il y a cette fameuse rencontre au scénario ahurissant contre l’Olympique de Marseille (5-4), le 22 août 1998
C’est un match qui a fait parler et on continue encore d’en parler. J’étais jeune à cette époque. On mène 4-0 à la mi-temps, j’ai marqué, on avait le match en main. Moi, je l’ai très mal vécue cette rencontre. Quand j’étais rentré dans le vestiaire à la fin, j’avais tout pété. Même avec mon jeune âge, j’étais vraiment très énervé. Loulou aussi (rires). C’est ça le foot. Même à 4-0, tu n’es pas à l’abri d’un retour. On joue à l’extérieur, ils ont eu la chance de réduire le score rapidement. On s’est mis à douter. Les joueurs expérimentés qui étaient avec nous ce jour-là se sont aussi montrés fébriles. Ils ne nous ont pas beaucoup aidés et voilà… Tant que l’arbitre n’avait pas sifflé le coup de sifflet final, il ne fallait pas s’arrêter de jouer. On apprend et j’ai beaucoup appris de cette bonne raclée.
Vient ensuite le Paris Saint-Germain. Tu n’y as passé que deux saisons mais on sent encore que c’est un club qui a compté pour toi, non ?
C’est vrai. Je quitte Montpellier parce que je souhaitais franchir un palier et c’était aussi une belle affaire pour eux puisque, c’était un transfert de près de 50 millions de francs à l’époque. Bravo à Nicollin, hein (rires). Paris, ce n’était pas dit, parce que j’avais d’autres clubs qui étaient intéressés, notamment Marseille, Lens et Monaco. Pourquoi Paris ? Parce que c’était la capitale. Je me disais que si j’avais vraiment envie de me lancer et d’être médiatisé, c’était le club parfait. Puis le discours de Laurent Perpère, le président, et Jean-Luc Lamarche, directeur sportif, m’a séduit. Ils voulaient construire l’avenir et aller en Champions League dans les deux-trois années qui arrivaient. C’est pourquoi j’ai fait ce choix. Je signe à Paris et deux mois après, je suis appelé en équipe de France…
Raconte-nous ce match historique contre Rosenborg BK (7-2) en C1 où tu es à l’origine de 6 des 7 buts.
Je fais un gros gros match au cours duquel je marque un but. Je me suis mis une telle pression sur ce match. On était déjà qualifiés pour le deuxième tour de la Ligue des champions parce qu’à l’époque, il y avait le deuxième tour. Le soir qui précédait la rencontre, je n’ai même pas réussi à dormir à l’hôtel. Chez eux, on avait perdu ou fait match nul, une connerie comme ça. À l’aller, j’avais un mec devant moi que je pouvais manger. Pour le match retour, je me disais qu’il allait falloir que je le fracasse. Et ça s’est bien passé. J’avais la pression, mais une fois le coup de sifflet donné, je me suis lâché. Tout ce que je faisais, ça marchait. Ça a vraiment été un match exceptionnel.
Après un début de saison 2000-2001 prometteur, les résultats ne suivent plus. Souvent, tu as mis en cause la gestion de Luis Fernandez, qui avait l’habitude de t’appeler « petit » …
Avec moi, cela s’est passé comme ça mais avec d’autres joueurs également. Après moi, il y a eu Benarbia, Anelka, Ronaldinho, Heinze… Tous les grands, tous les joueurs qui avaient une notoriété supérieure à lui, il n’aimait pas ça. Il a été un grand joueur, il n’y a rien à dire là-dessus. Maintenant, j’en rigole aussi avec lui. Mais c’est vrai qu’à l’époque, c’était très compliqué de travailler avec lui. À un moment de ma carrière, il m’a sorti carrément de l’équipe. J’étais seul, je jouais en CFA avec Antoine Kombouaré. J’étais meilleur buteur du championnat quand même avec 12 buts. Le mec arrive et il te sort. Les raisons, c’était que je ne voulais pas travailler ou je faisais ma star. Ce sont toujours les réponses d’un entraîneur qui ne peut pas te saquer. Ou il allait dire au président que je ne voulais pas jouer, que je me la pétais. C’est facile de parler ainsi. T’arrives, tu veux monter ton équipe. Peut-être que ma tête ne lui plaisait pas. Ça n’a pas bien démarré mais il a vu après que, comme il n’avait pas de résultats, il était obligé de me reprendre. Je finis quand même la saison à 15 buts et meilleur buteur du club. Et il ne voulait plus me laisser partir ensuite mais mon choix était fait. J’avais quatre ans de contrat. J’étais aimé, adulé, je me sentais bien, on avait une grosse équipe. Sauf que le club avait, à un moment donné, besoin d’argent. Ça a été un bon deal, ils m’ont vendu 120 millions de francs pour Newcastle.
À cause de ces relations conflictuelles, le PSG a donc raté un éventuel quatuor offensif composé de toi, Okocha, Ronaldinho et Anelka ?
Eh oui… Je jouais en neuf et demi avec Nico la deuxième année. On s’entendait tellement bien sur le terrain… C’est pourquoi je marquais autant de buts. Avec Heinze et Pochettino derrière, on avait une équipe de malades. C’est vrai que ça aurait fait mal. La faute à Luis…
Aujourd’hui, le club de capitale a pris une nouvelle dimension. Quel regard portes-tu sur sa trajectoire ?
C’est magnifique pour le football français et les spectateurs. Il y a encore trois-quatre ans, on voyait toutes les stars qui sont là aujourd’hui à la télé dans les autres championnats européens. Ils sont chez nous désormais. Non, c’est super top. Des mecs de l’envergure de Zlatan, Thiago Silva ou Falcao veulent venir en France. On a un bon championnat. Je suis vraiment content que les Qataris aient repris le PSG. Cette saison, le titre de champion national, c’est fait. En Ligue des champions, ils veulent faire mieux que l’année dernière, ce qui veut dire au moins les demi-finales. Quand j’entends tous les discours de Laurent Blanc, il a la tête sur les épaules. C’est un gars qui a de la bouteille, qui a été champion du monde et qui sait ce que c’est le haut niveau. Il sait quand faire reposer ses joueurs et a un adjoint exceptionnel, Jean-Louis Gasset, que j’ai connu au PSG et à Montpellier.
Et trouves-tu aussi que le public s’est embourgeoisé, toi qui as connu l’ambiance incandescente du Parc des Princes avec Boulogne et Auteuil…
À l’époque, il y avait des fumigènes, c’était vraiment le feu au Parc. Je ne sais pas trop quoi te répondre là-dessus. Je vois qu’il n’y a plus de bagarres et que c’est plus sain. L’ambiance va peut-être revenir. Mais profitons aussi de ces moments-là parce qu’il y a eu tellement de moments dramatiques. Venir au foot pour se frapper, non, ce n’était plus possible. Mieux vaut rester chez soi. En Angleterre, c’était bien pire avant et il y a de l’ambiance maintenant. Ça met un peu de temps mais je pense que ça va revenir.
Santiago Muñez n’aurait même pas joué en PH
Tu t’envoles ensuite pour l’Angleterre et Newcastle où tu resteras cinq saisons. Ça reste la plus belle période de ta carrière ?
C’était un superbe passage. Ce passage à Newcastle, de pouvoir jouer avec des Shearer et d’être entraîné par un tel monsieur comme Bobby Robson… Qu’est-ce que tu veux de plus ? Je suis encore pote avec Patrick (Kluivert), des mecs comme Bellamy, Dyer, Bowyer. On avait vraiment une équipe de malades. On était dans le Big Four, on a même failli gagner le championnat lors de ma deuxième saison où on termine derrière juste Arsenal. C’était énorme, quoi.
Comment était la vie à Newcastle ?
Je me plaisais vraiment. Newcastle, petite ville mais les gens sont tellement respectueux, pas comme chez nous en France… Ce n’est pas qu’à Newcastle, c’est dans toute l’Angleterre en général. Les gens font vraiment preuve de respect envers les joueurs. Les personnes étaient justes heureuses de nous voir, elles ne voulaient pas des autographes ou prendre des photos. Ou alors, quand c’était le cas, elles le souhaitaient, elles demandaient toujours avec politesse. Mais, ici, non, jamais. Chez nous, le public français, c’est un dû. « Tu me signes ça, tu me fais ça, on prend une photo » . Mais quand est-ce que tu me dis « s’il te plaît » , « bonjour » , « merci » , « au revoir » ? On a vraiment une mentalité assez bizarre.
Évoluer sous les ordres de Bryan Robson et côtoyer Alan Shearer, le meilleur buteur dans l’histoire de la Premier League (260 buts), ça reste une immense fierté pour toi ?
Oui, évidemment. Fier car j’ai beaucoup appris en travaillant à leurs côtés. On avait une belle équipe à la fois jeune et expérimentée, ça tournait bien, tout le monde se fondait dans le collectif. Individuellement, Shearer dans les dix-huit mètres, c’était pfiouu… Tu pouvais être bien placé, il ne passait pas le ballon. C’était un vrai buteur. Moi, j’étais là pour le gaver de ballons. Chacun faisait son travail. Lors de ma deuxième saison, je termine meilleur passeur devant Beckham, voilà, tranquille (rires).
Et ce but façon coup du scorpion contre Fulham que tu inscris…
On en a tellement parlé. La presse me rappelle souvent ce match-là. Avant le match, j’étais à la maison et je jouais à la Playstation avec mon fils. Pas au foot parce que ça, je ne savais pas y jouer… Mais à Tekken, des trucs comme ça. Après ce but, mon fils m’a dit : « Putain papa, t’as fait la même figure que dans Tekken, un truc inimaginable ! » C’est un geste où, sur le moment, tu sens, tu le fais d’instinct. Tu ne peux pas l’expliquer. Mais je me souviens très bien de l’action. Je décale sur le côté, Solano qui rentre et je recoupe au premier poteau parce que j’étais presque carbo à ce moment-là. Mais je me suis dit : « Allez, continue l’action car il n’y avait personne » . Et voilà, tu fais ce geste… Une sorte de retourné du gauche de l’extérieur. Puis, ce n’était pas n’importe qui dans les buts, c’était Van der Sar.
Encore aujourd’hui, tu restes l’un des Frenchies les plus appréciés à Newcastle avec David Ginola. À l’époque, les supporters magpies reprenaient à l’unisson : « Robert, mon seul Robert, tu me rends heureux quand le ciel est gris. Tu marques tant de beaux buts, plus beaux encore que ceux de Paul Scholes. Ne tenez pas mon Robert loin de moi, la la… »
C’est ça, l’Angleterre. Il y avait cette chanson puis d’autres aussi. À chaque fois que les supporters de St James’ Park les entonnaient, j’avais des frissons. Sur le terrain, j’avais vraiment des frissons, c’était impressionnant. Ça ne peut que te donner de la motivation et mouiller le maillot pour eux. Ça montre également que t’es un étranger, que t’es apprécié et qu’on t’accepte. Car ce n’est pas facile lorsque tu es étranger.
Au cours de ton passage dans le Tyneside, tu as également participé au film Goal en 2005. Il paraît même que tu as inspiré le fameux coup franc tiré par l’acteur principal…
Mais c’est mon coup franc ! Tu le vois dans le film. Les jambes du mec, ce sont mes jambes. Le but qu’il marque contre Liverpool, la veille, je venais de le marquer. Le lendemain, on refait les scènes au stade où on court sur lui pour célébrer le but. Quand il pose le ballon avant de tirer, on voit que c’est moi qui vais tirer le coup franc. Il est droitier, je suis gaucher et tu vois le ballon qui termine dans la lucarne opposée (rires).
Il valait quoi sur le terrain ce célèbre Santiago Muñez ?
Il essayait, il était à fond dans son rôle. Mais il n’aurait même pas joué en PH le type… (rires). Il s’amusait avec les vétérans le dimanche matin, mais même eux en avaient assez. Le blond (Gavin Harris joué par Alessandro Nivola, ndlr), c’était pire. Oh putain… Lui, c’était un phénomène. À l’avant-première à Paris, qu’est-ce qu’on a rigolé. Ça reste une belle expérience en tout cas.
Propos recueillis par Romain Duchâteau
ps : suite de l’interview de Laurent Robert demain, avec au programme, sa frappe lourde et sa prédisposition aux coups francs, l’équipe de France et enfin le lobby France 98…
On vous spoile Young-Boys-Lille