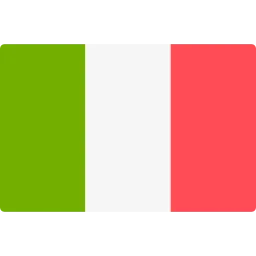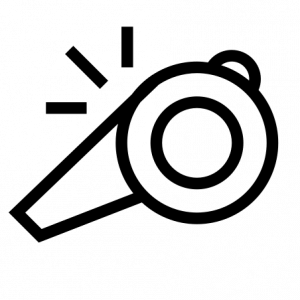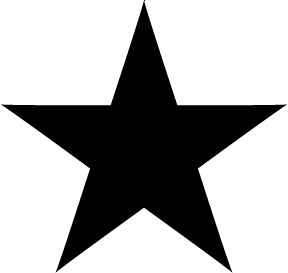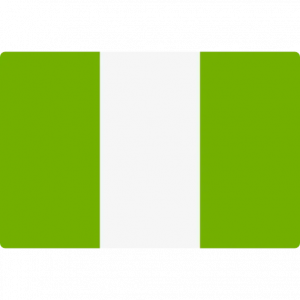- France
- Calais
- Interview
Ladislas Lozano : « Le football français n’a pas voulu de moi »

À défaut de le faire sur le banc du club de foot, c'est en mairie de Calais que siège désormais Ladislas Lozano. Élu le 15 mars dernier dans sa ville de cœur, où il est revenu en début d'année, l'entraîneur historique du CRUFC a profité de son retour en terres calaisiennes pour ouvrir la boîte à souvenirs. L'occasion d'évoquer la formidable épopée de ses troupes en Coupe de France, vingt ans après, mais aussi la dictature franquiste, l'exil familial dans le 9-1, Jacques Chirac et le Qatar. Rien que ça.
Il y un an, vous déclariez être prêt à revenir à Calais. Vous parliez alors du club de foot, pas du conseil municipal…J’étais effectivement disponible pour reprendre du service. Les six années passées au club m’ont affecté, mais aussi la mentalité des locaux, leur façon de se bagarrer, dépasser leurs limites, rejeter l’adversité. Calais forge les caractères, et j’ai été très heureux d’y vivre. J’étais donc d’accord pour y terminer, même bénévolement, ma carrière. Ce souhait ne se réalisera pas. Je suis désormais disponible et libre pour d’autres engagements. Le football reste ma passion, avec l’architecture, l’urbanisme, la réflexion autour de la construction de bâtiments. J’ai d’autant plus été à l’aise d’accepter d’intégrer la liste de Natacha Bouchart (1) que c’est cette deuxième voie qui l’intéressait, et que ça me permettait de revenir à Calais.
Comment s’est présentée cette opportunité ?
Il y quelques mois, j’ai relu les lettres, courriers et fax reçus en 2000 au club, pour certains restés sans réponse, ce dont je suis navré. J’ai proposé à Madame Bouchart d’en faire une expo. Elle a été emballée. Après ces échanges, à ma grande surprise, elle m’a rappelé. Je la connaissais déjà : quand elle est devenue maire, j’étais salarié de la ville. On avait des convergences de vue sur un tas de choses. Dans ses propos et sa façon de faire, elle a beaucoup de points communs avec Claude Thiriot (ancien manager du CRUFC), qui me l’a présentée quand je suis arrivé à Calais et qu’elle se lançait en politique. Je me rends compte aujourd’hui que l’impression était bonne, car elle transfère un fantastique humanisme. Elle est engagée pour le bien-être de son prochain, et son prochain, c’est le Calaisien.
Son prochain, c’est aussi le migrant…(Il coupe.) Il est préférable que ce soit elle qui se positionne sur le sujet. Il ne m’appartient pas d’y répondre, car j’arrive seulement, et je n’ai pas toutes les informations.

Les époques étaient différentes, mais vous avez vous-même dû fuir l’Espagne. J’ai compris, adulte, ce que ça avait dû être pour mes parents de devoir, pour des questions d’idées, quitter leur terre natale avec cinq enfants. Ça a été terriblement difficile et j’ai une vénération pour eux par rapport à ça. Mon grand-père paternel est mort en prison, privé de nourriture, un oncle est mort fusillé, et un autre a été fusillé et laissé pour mort, mais a heureusement survécu.
Mon père travaillait avec ses cinq frères et sœurs dans la société de primeur de mon grand-père en Castille, à Alarcón. Ils étaient « la » famille du village : là où personne n’avait de voiture, mon grand-père possédait deux camions. C’est aussi pour ça qu’il y a eu cette répression. En tant que républicain, mon père a dû travailler pendant plus de dix ans dans l’anonymat complet dans les mines de Barcelone avant de pouvoir passer en France pour simplement continuer à vivre avec sa famille et la faire vivre. Il était responsable des explosifs. À Viry-Châtillon (où Ladislas Lozano est arrivé à quatre ans, N.D.L.R.), le maire, Henri Longuet (2), l’a pris dans son entreprise d’extraction de cailloux. C’était très dur physiquement. Émile, mon frère aîné, était ingénieur dans une entreprise qui fabriquait des endoscopes. Il l’y a fait entrer, l’a formé à plus de cinquante ans au métier de tourneur-fraiseur. À la fin, c’est lui qui étalonnait les endoscopes avant qu’ils sortent de production. Tout cela m’a appris l’entraide dans la difficulté, dans la famille ou en dehors. Mon père étant très absent en raison du boulot, et je ne lui en tiens pas rigueur, c’est le fils aîné qui s’occupait de l’éducation. J’ai autant été élevé par mon frère et ma sœur aînés que par mes parents. La transmission est très importante chez nous. Je l’ai retraduit à ma façon dans ma vie professionnelle et personnelle.
Quel souvenir gardez-vous de votre enfance en région parisienne ?Celui d’un enfant qui vivait dans un endroit propice à l’épanouissement, ouvert à des étrangers qui ne demandaient qu’à s’intégrer. Mes parents étaient clairs : on vient ici pour se fondre dans la mentalité, l’esprit, l’éducation française. J’ai dit pendant l’épopée que je me sentais français de raison. Je suis devenu français et j’en suis très heureux, mais au niveau du cœur et du sang, je suis et resterai espagnol.
Pourtant, vous n’avez pas enseigné l’espagnol à vos enfants.
Ce n’était pas délibéré. Chez moi, on ne parlait pas français. Mais quand il a fallu éduquer nos enfants, j’étais fort occupé, et mon épouse ne maîtrisait pas bien la langue de Cervantes. Mais ma fille Karine, qui est mariée avec Cédric Jandau (artisan de l’épopée du CRUFC en 2000, N.D.L.R.), a fait des études de langues et parle mieux espagnol que son père aujourd’hui ! Parce qu’elle a appris la grammaire, pas moi. À l’examen du DEPF, la prof me l’a fait remarquer après l’épreuve de langue : « Vous avalez un peu les mots, comme à la campagne. Si vous avez un entretien d’embauche, essayez d’y faire attention. » J’aurais été flatté, heureux et fier de travailler en Espagne, mais on ne m’a pas proposé le schéma qui pouvait me convenir.
Mais vous avez joué deux ans en Espagne, sous la dictature franquiste. C’était comment ? J’ai été très bien accueilli et ne l’ai pas ressenti. Il faut dire que j’étais là pour jouer au foot, pas pour exprimer mes opinions politiques. On ne m’a donc jamais ennuyé, et ça a été une bonne expérience. J’ai eu la chance de côtoyer de futurs grands noms, comme Santillana (3). C’est une grande fierté.
Avant cela, vous auriez pu porter le maillot de l’équipe de France. En 1969, j’ai remporté la coupe nationale des cadets avec ma sélection régionale. Jacky Braun, notre entraîneur, a alors été nommé sélectionneur de l’équipe de France Junior, et m’a appelé pour un stage de préparation au championnat d’Europe en Écosse en 1970. J’avais 17 ans. J’avais envie, mais c’était trop tôt pour ma famille, donc j’ai prétexté une absence due à mes études. Pour l’anecdote, c’est Alain Giresse qui a été appelé à ma place, même si on n’avait pas le même poste. J’aurais pu être naturalisé en trois mois. On me l’a d’ailleurs à nouveau proposé deux ans plus tard. Me sentant étranger dans mon propre pays, et ne me voyant pas partir deux ans à Gijón, loin de ma famille et de l’Atlantique, pour faire mon service militaire, j’ai quitté Santander et l’Espagne pour le club de Paris-Joinville. Mon entraîneur m’a proposé la naturalisation pour pouvoir intégrer le bataillon de Joinville et l’équipe de France militaire, mais la majorité était placée à 21 ans, et j’étais encore dépendant de la décision de mes parents.
Vous suivez toujours le foot avec la même passion ? Étant encore dans le milieu, c’était une obligation de rester informé. Je n’ai pas coupé le cordon, mais je suis en retrait aujourd’hui sur les compositions d’équipes, les façons de faire des uns et des autres.
J’ai pris du recul pour m’occuper de ma famille, mais il m’arrive encore de vibrer devant un match. Surtout au stade : quand il y a un match à la télé, souvent, je zappe pour voir l’évolution du score, alors qu’il y a quelques années, c’était la guerre avec Madame pour choisir la chaîne. (Rires.) J’ai eu la chance d’aller plusieurs fois au Stadium pour voir le Téfécé (sic), mais ils ont à chaque fois perdu. Le dernier match, c’était contre l’OL : Toulouse menait 2-1 et a fini par perdre 3-2 (le 2 novembre 2019). Mais je prends aussi beaucoup de plaisir devant des matchs amateur, comme ceux des 17 ans Nationaux de Muret (club de l’agglomération toulousaine où sont notamment passés Éric Carrière et Cédric Fauré), dont s’occupe mon beau-fils. Le foot, j’y vais désormais sans me prendre la tête, sans pression. S’il y a des buts, que l’arbitre n’influe pas sur le résultat et qu’il y a un état d’esprit de conquête, de la vaillance et du respect, je suis comblé.
Si vous deviez rejouer la finale de 2000, vous l’aborderiez de la même manière ? Ce n’est pas une excuse, mais s’il y a une chose que je ne pouvais pas maîtriser et que je changerais, c’est l’espace-temps entre la demi-finale, le 12 avril, et la finale, le 7 mai. C’était horriblement long.

Les calendriers ont toujours été faits comme ça, non ? Jean-Claude Cloët, mon adjoint à Reims (2002-2004), a joué une finale de Coupe de France avec Nancy, contre Nice en 1978. 1-0, but de Platini. C’était un dimanche. Et la demi-finale quatre jours avant, parce que dès le lendemain de la finale Platini s’envolait pour l’Argentine avec l’équipe de France. Les joueurs n’ont pas gambergé.
Ils avaient une fraîcheur que nous n’avions plus. Ce laps de temps était invivable, en matière de sollicitations médiatiques. J’avais ma voiture avec le petit gyrophare de responsable des équipements sportifs. Quand j’allais au stade Julien-Denis dans la journée, j’entrais dans l’arène comme un torero. Il y avait des paraboles et des journalistes partout, alors que j’allais juste faire mon boulot. Je suis convaincu que cet engouement durable, les trois quarts de mes collègues de L1 ne l’avaient jamais connu. Et nous, on nous l’a imposé ! On était inexpérimentés, naïfs. Ça nous a peut-être aidés aussi, parce que si on avait pris conscience de l’énormité de la chose, on aurait été tétanisés ! Pour éviter ça, j’ai demandé, sur le trajet vers Clairefontaine, qu’on nous ouvre le stade de France. Mais bon, vous entrez dans une pièce, on vous dit : « Ça c’est le vestiaire de l’équipe de France, là c’est le siège de Zidane… » Les joueurs étaient dans les étoiles.
Ils l’étaient encore le jour de la finale ?L’entraînement du vendredi était très mauvais !
Aucune application, aucune écoute. L’un avait la chambre de Platini, l’autre celle de Deschamps, il y avait des policiers tout partout… En quittant Clairefontaine pour aller séjourner au château Ricard (4), j’ai menacé mes joueurs : « Le premier qui parle à un journaliste ne joue pas la finale. » L’équipe était perturbée, donc le samedi, nous sommes allés faire un autre entraînement au stade de France, alors que je ne voulais pas qu’on dépense d’énergie. En arrivant à la finale, sur la concentration, le fonctionnement physiologique, athlétique, c’est un fait : on était en descente.
À Clairefontaine, vous vous seriez isolé dans les bois quelques heures pour fuir la pression médiatique. Ce n’est pas tout à fait ça. Après la demi-finale, j’ai eu un coup de fatigue terrible. À Calais, le trajet entre la mairie et le casino prend deux minutes en voiture. Là, on a mis une heure et demie en bus. Il était 2h du matin, il y avait un monde fou, c’était invraisemblable.
J’ai senti en moi la fébrilité monter, mes jambes flageoler, j’étais en sueur, et ce qui a alerté mes adjoints, c’est que j’étais incapable de lever le bras droit. Il fallait me sortir de là. On m’a rentré dans le casino, où je suis resté une demi-heure allongé en attendant les pompiers. Je me suis reposé trois jours à l’hôpital à Calais, où je n’ai pratiquement fait que dormir. Puis je suis allé au château Ricard à l’initiative de Claude Thiriot. J’y ai été accueilli les bras ouverts. Le directeur était aux petits soins. J’ai passé une semaine inoubliable. Durant ce séjour, effectivement, je me suis esseulé à quelques occasions pour réfléchir à tout ça et prendre de la hauteur.
C’est quand vous étiez à l’hôpital à Calais que vous avez reçu un coup de fil de Jacques Chirac ?Oui ! L’infirmière avait les mains qui tremblaient quand elle m’a apporté le téléphone. Il m’a souhaité un bon rétablissement, nous a félicités, et m’a dit « Vous donnez une image très valorisante de la jeunesse française. On est avec vous. » C’est fantastique. Je l’ai remercié sur la pelouse du stade de France lors des présentations, et deux ans après, quand pendant la campagne présidentielle il est venu à Radio Alfa, dont le propriétaire est Armand Lopes, mon président à l’US Créteil (en 2002). J’ai demandé à être sur la liste des invités pour le saluer, car entre-temps, il m’avait dédicacé une photo prise dans les vestiaires après la finale. Je l’avais transmise à Madame Chirac après un match avec le Variétés Clubs de France à Évreux. C’est une sacrée anecdote : je lui donne la photo vers minuit, je rentre à Calais et le lendemain matin, à dix heures, la photo est dans ma boîte aux lettres à Calais, signée ! Je l’ai su après, il me l’avait fait parvenir par ce qu’on appelle la valise diplomatique. C’est incroyable.
Comment se sont passées les retrouvailles ? Il m’a immédiatement reconnu : « Oh, Monsieur Lozano, comment ça va ? Et Monsieur Thiriot, il s’est remis de ses émotions ? » Je me suis dit : « Merde ! » Les politiciens, ils préparent leurs interviews, réunions et rencontres, mais là c’était de l’imprévu complet ! Ça m’a scotché.
Et dans le vestiaire, il était comment ? Hyper impressionnant, parce qu’au-delà de sa fonction, c’est quelqu’un d’imposant. Sa main devait faire deux fois la mienne ! Ses gardes du corps tiraient sur sa veste pour lui dire : « Il faut y aller. ». Il se retourne et leur dit : « Mais vous arrêtez, oui ? Je suis bien, moi, avec les petits ! » Il a dit publiquement qu’il y avait deux vainqueurs. C’était très valorisant.

Comment était l’ambiance après le match ? Plutôt bonne, au vu des images du Lido.Au Lido, c’était autre chose, mais dans le vestiaire, finalement, il y avait un soulagement, pas de déception. La déception, c’est sur le terrain.
Derrière, c’était fini. Imaginez quand même la FFF devant désigner son représentant en Coupe de l’UEFA. Certains, comme Michel Platini, disaient : « On ne va quand même pas envoyer Calais ! » Mais le destin a voulu que ça se termine comme ça, que les deux capitaines lèvent la coupe ensemble, c’est une image qui veut dire beaucoup et résume bien l’ensemble. Beaucoup pensaient : « Enfin, ils vont se prendre une volée », mais ce n’est pas arrivé. Mais je le répète : on n’avait pas toutes nos forces à ce moment-là.
Au-delà du contexte particulier, vous n’avez aucun regret sur le choix des hommes ou le discours dans le vestiaire ? Mes joueurs, j’ai toujours cru en eux. Je connaissais leur potentiel et s’ils étaient prêts le jour J, je savais qu’en face ils auraient du mal. Même une Ligue 1. Certains l’ont perçu comme de la prétention, et trouvaient que ce n’était pas le bon discours. Pfff ! En tout cas, c’était le bon vis-à-vis de mes joueurs. Que ça ne plaise pas à d’autres personnes, ce n’était pas mon problème. D’ailleurs, on était quand même plutôt dans le vrai : la saison d’après, en 32es de finale, on joue Sedan, leader de L1. Et pas leader au mois d’août après deux matchs, hein ! Eh bien, contre le leader de L1, on fait 1-1 à la mi-temps (1-3 score final). Mon équipe avait du potentiel. S’il s’exprimait, il y avait de quoi faire, et ça, j’en étais persuadé.
Pourtant, peu de vos joueurs ont retrouvé ou rejoint le haut niveau ensuite. Tout le monde pensait que l’équipe allait exploser, mais j’avais dit qu’il y aurait très peu de départs. À la reprise, personne n’était parti. Seul Manu Vasseur est parti le 31 décembre (à Leyton Orient, en D4 anglaise) en démissionnant alors qu’on jouait le 5 janvier contre Sedan. C’était une trahison. Je lui en ai voulu : on ne fait pas ça comme ça. Il n’y a que Mickaël Gérard qui a été réellement approché par un club écossais, et Cédric Schille (le gardien) par Strasbourg et Metz, mais le professionnalisme, il n’y a que moi qui l’ai connu après.
Vos joueurs l’avaient quand même approché pendant leur formation.
Et c’est soi-disant grâce à ça que le CRUFC est allé en finale de la coupe. Je m’inscris en faux ! Sur les seize joueurs sur la feuille de match contre Nantes (il les énumère, dans l’ordre des numéros), seuls sept sont passés par des centres de formation, et deux y ont passé deux ans. Ils n’ont même pas joué avec l’équipe 2 d’un club pro. Non : ce sont des garçons qui rêvaient de professionnalisme, à qui on a fait miroiter des contrats, et qu’on a laissé sur le côté sans arguments, sans armes pour pouvoir rebondir dans le milieu amateur et s’y faire une place. Très peu ont été opérationnels tout de suite. Je me considérais autant comme une assistante sociale qu’un entraîneur. Pour qu’un joueur soit bien dans ses jambes, il faut déjà qu’il soit bien dans sa tête : pour ça, il fallait un ou deux ans. Mais un club amateur n’a pas forcément les moyens de payer ces garçons dans le laps de temps où il sait qu’ils ne vont pas être performants. Mais c’est ce qu’on a dû faire, avec tous. Tous !
Il y aussi vos compétences de technicien, qu’on a eu parfois du mal à vous reconnaître dans le milieu. Jean-Pierre Caillot, votre président à Reims (2003-2005), disait par exemple que vous étiez un entraîneur de coupe. C’est son avis, mais je ne suis pas d’accord. Jean-Pierre m’a dit avoir surtout pensé à moi pour ce qu’on a fait l’année après la coupe, en CFA, attendus au coin du bois par toutes les équipes. On a fait 38 finales de coupe. À Saint-Omer, à Boulogne, à Dunkerque, à Raon-l’Étape où on s’est fait insulter de toutes parts, en région parisienne, ils ne jouaient pas contre Calais : ils jouaient contre (il hausse le ton) « le finaliste de la Coupe de France » ! Cette compétence, on peut épiloguer dessus. Mais j’ai réellement été contacté par André Jegouzo (président de Lorient de 2001 à 2003) et Patrick Proisy (président de Strasbourg de 1997 à 2003), qui n’a pas assumé et a démenti alors que je serais presque capable de vous dire ce qu’il a mangé lors de notre repas à Paris avec Jacques Vendroux. J’ai eu des opportunités, ça ne s’est pas concrétisé, et quelque part, c’était aussi bien. Je suis sûr qu’au premier accroc, la première difficulté – je l’ai d’ailleurs un peu ressenti à Reims –, j’en aurais pris plein la tête, par rapport aux supporters, au fait que je n’avais pas d’expérience, ce que m’a d’ailleurs dit Monsieur Jegouzo, qui était favorable à ma venue à Lorient, mais où je ne faisais pas l’unanimité. C’était trop dangereux de mettre une L1 dans les mains de Ladislas Lozano.

C’est un regret ? Oui, le foot français n’a pas voulu de moi, mais j’estime quand même avoir prouvé. À Reims, le titre de champion de National (en 2004) était le premier depuis près de 40 ans. J’ai sauvé Créteil en six matchs, à Casablanca je suis parti en étant leader du championnat, au Qatar j’ai gagné la Coupe Jasim (en 2002) et la Coupe de l’Émir (en 2006), qui est plus honorifique que le championnat. J’ai fait des choses, j’ai eu des résultats, mais on ne veut pas en prendre compte, qu’est-ce que je peux faire, moi ? Dans la région de Toulouse, j’ai fait savoir pendant cinq ans que j’étais libre, disponible, même pour un club amateur. Ça n’in-té-resse per-sonne ! Je ne vais pas me battre ou me mettre à genoux.
C’était quoi, la méthode Ladislas Lozano ?Ce n’est pas vraiment à moi de le dire. Claude Thiriot disait que j’avais une main de fer dans un gant de velours.
Mais je me trouve plutôt tendre à l’intérieur et dur à l’extérieur. Il m’a aussi dit un jour : « Tu es dur, mais juste. » Ça vaut tous les compliments, car j’ai horreur de l’injustice. Je suis cadenassé à chaque fois pour savoir qui je vais choisir, faire démarrer, à qui on va proposer un contrat… J’ai toujours peur de me tromper, je suis dans le questionnement sans arrêt. Je questionne d’ailleurs beaucoup l’autre, y compris les joueurs. Par rapport à mon éducation, ma mentalité, j’ai essayé d’être le plus pertinent, percutant, le plus adapté possible, le meilleur conseil possible. Les gens qui me connaissent ont dit que j’étais un meneur d’hommes. Une chose est sûre : je suis beaucoup plus à l’aise avec les adultes. J’ai d’ailleurs refusé quelques fois de m’occuper des jeunes, mais aussi d’une équipe de L1 féminine. Chacun à sa place.
Ce questionnement permanent, ça vous vient de la religion ? Certainement, oui. J’ai beaucoup de retenue à parler de ça, parce que je comprends que ça n’intéresse pas forcément tout le monde. On est quand même ici pour parler de Calais qui a été tenu pendant 37 ans par le Parti communiste, et ce n’est pas moi qui vais vous expliquer que religion et communisme ne font pas bon ménage. En tant que salarié ou entraîneur, encore plus dans le milieu pro qu’amateur, je me suis toujours retenu de donner quelque avis que ce soit. J’ai travaillé avec des élus communistes, socialistes et de droite, et je n’ai jamais fait état de mon avis politique ou ma religion.
Au Qatar, il vous arrivait de prier avec les joueurs.
J’ai dû m’adapter au rythme des habitants qui sont à 99,9% musulmans et pratiquants. L’une des cinq prières quotidiennes tombe parfois pendant l’entraînement : on fait un ou deux modules en début de séance, on coupe, et là vous avez dix-huit joueurs sur vingt-deux qui vont prier pendant dix bonnes minutes dans la petite mosquée du stade. Au lieu d’attendre qu’ils reviennent pour reprendre, un jour, j’y suis allé avec eux, je me suis mis derrière, ils ont fait leur prière et j’ai fait la mienne à ma manière, respectueusement. Ils ont dû être étonnés, mais ont été très respectueux eux aussi. Ensuite, c’est devenu récurrent.
Est-ce que ça a été une expérience aussi intéressante d’un point de vue sportif que culturel ? Oui. C’est très formateur. Il faut sans cesse s’adapter, à la température, aux mentalités, aux différences de valeur entre les équipes, mais aussi au sein des équipes. J’avais des internationaux comme Émile Mpenza et Jacek Bąk (ex-Lyon et Lens), et des titulaires qui n’auraient joué ni à Calais, ni en DH à Fleury-Mérogis, où j’étais en 2009-2010. Il faut s’adapter, à ça ! Dans les séances, les consignes, les attentes, la façon de dire à un international européen qu’il faut qu’il soit indulgent… il faut avoir le bon discours.

On a d’autant plus de mal, en vous entendant, à s’imaginer qu’une Coupe du monde aura bientôt lieu là-bas. Mais ce sera une grande Coupe du monde. Parce qu’ils vont tout faire et font tout pour. Les Qataris sont des gens de défi. Ce pays met des millions d’euros dans la jeunesse, le sport et la formation. Il n’y aura jamais la population suffisante pour alimenter les clubs, mais ils s’ouvrent à l’étranger, et ont des objectifs complètement réalisables. Donc ça va être une grande Coupe du monde, j’en suis persuadé.
Y compris pour le Qatar ?
Non, ils vont avoir beaucoup de mal, même s’ils jouent chez eux. Si les équipes qualifiées doivent partir deux mois au lieu d’un pour habituer les organismes, les fédérations organiseront les calendriers en amont. Et puis, les grandes équipes vont rester grandes. Le Qatar se défendra avec beaucoup d’abnégation, mais l’écart est trop important. Mais le football évolue, en matière de qualité et de formation. De grands centres ont été créés, comme l’académie Aspire. Les joueurs travaillent, et les entraîneurs sont de plus en plus compétents. Beaucoup de techniciens viennent de l’étranger pour former les entraîneurs et les joueurs, de plus en plus jeunes. Donc leur valeur va augmenter rapidement.
Vous aviez les mains libres, là-bas ? Je n’ai pas de mal à dire que je ne décidais pas du recrutement, qui relève d’une petite guéguerre entre les cheikhs. C’est : « T’as vu, moi, j’ai fait venir Xavi. » Mais on m’a toujours fait confiance, et on ne m’a jamais mis de bâton dans les roues ni obligé à faire jouer un joueur. Ils vous laissent travailler.

En 2006, alors que vous étiez au Qatar, il était question d’un retour à Calais.
Oui, lors de la dernière année de présidence d’André Roches (1995-2006). J’avais un accord formel avec lui pour revenir en fin de saison comme manager général, et n’avais d’ailleurs pas sollicité de nouveau contrat au Qatar. Ça ne s’est pas fait, parce qu’à l’époque, il y avait déjà toutes ces rivalités qui ont abouti après coup à la disparition du CRUFC (en 2017), qui a été un grand choc pour moi. J’ai déjà vécu avec beaucoup de douleur et de tristesse les disparitions de Claude Thiriot (en 2011) et André Roches (en 2019), dont j’étais très proche, et pour couronner le tout, on élimine le CRUFC… C’est une partie de moi qui n’est plus là.
L’équipe féminine est la figure de proue du nouveau club calaisien (le Grand Calais Pascal Football Club). Le renouveau du football à Calais peut-il passer par le football féminin ? Pour être honnête, je n’ai jamais été un grand fan du foot féminin, je fais partie de la génération à qui on nous l’a un peu imposé. Si c’est par cette équipe (leader de R1 et en course pour la montée en D2) que le haut niveau peut revenir à Calais, tant mieux. Mais la mentalité dure au mal d’ici est quand même un peu plus matérialisée dans le foot masculin. Les féminines ont un rôle à jouer, mais je pense que la notoriété de Calais au niveau national viendra d’une équipe masculine. Je suis persuadé qu’un jour, il y aura de nouveau une grande équipe ici. Le Calaisis en a besoin et le mérite.
Comment le Paris FC est devenu le meilleur club de la capitale ?Propos recueillis par Simon Butel
(1) La liste de Natacha Bouchart, maire depuis 2008, a été élue dès le premier tour des élections municipales avec 50,32% des voix.
(2) Père de Gérard Longuet, ministre des Postes et Télécommunications puis de l'Industrie sous François Mitterrand, et ministre de la Défense sous Nicolas Sarkozy.
(3) Un temps recordman du nombre de matchs disputés avec le Real Madrid (643) et finaliste de l’Euro 1984 face à la France.
(4) Propriété du groupe Pernod-Ricard située à Clairefontaine, et où a longtemps séjourné le XV de France.