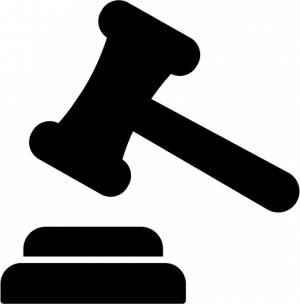- Anniversaire de France/Allemagne1982
Karlheinz Förster : « J’ai corrigé l’erreur de Schumacher »

Il avait beau avoir une gueule de poupon, Karlheinz Förster était dur sur l'homme. Celui que Bernard Tapie est allé chercher à Stuttgart pour renforcer son OM fut l'un des protagonistes de cette fameuse « Nuit de Séville ». Il s'est même retrouvé comme garde du corps du meilleur joueur français de l'époque, Michel Platini. C'est peu dire que Förster était un sacré client.
Quels souvenirs avez-vous de cette rencontre?Ce match fait partie de ce que l’on appelle « les plus belles rencontres du XXe siècle » . Un match d’une grande intensité, avec une prolongation, des tirs au but… Je me rappelle que nous avons joué différemment par rapport aux matchs précédents. Mon frère Bernd prenait Dominique Rocheteau au marquage, et moi, je devais me mettre sur la droite, pour prendre Didier Six. C’est le coach Jupp Derwall qui en avait décidé ainsi, parce qu’il trouvait que Six était le plus fort attaquant côté français.
Vous n’étiez donc plus central?Effectivement. Une absurdité, selon moi, mais vous savez, les entraîneurs pensent parfois de manière extrêmement compliquée… En seconde mi-temps, par exemple, Jupp Derwall a encore changé de stratégie : je me suis retrouvé en 6, je devais m’occuper de Michel Platini. En fait, durant ce match, j’ai pas du tout joué à mon poste. C’était difficile, surtout que la France avait une super équipe à l’époque. Il y avait Platini, bien sûr, mais aussi Giresse et Tigana, des mecs que j’ai connus par la suite à Marseille…
Le carré magique, quoi ! (premier du nom, avec Bernard Genghini, ndlr)Exactement. Pour moi, cette équipe était plus forte que celle de 1984, celle qui a remporté l’Euro.
Et sur le terrain, c’était comment?Je me rappelle une partie disputée sous une chaleur étouffante à Séville. Si je me rappelle bien, nous avons ouvert la marque par Littbarski, puis 1-1 par Platini, je crois… C’est ça?
Exact. Sur pénalty.Puis il y a eu la prolongation, et nous avons pris les deux buts de Trésor et Giresse. Nous perdions alors 3-1.
Il reste alors un peu plus de vingt minutes de jeu en prolongation, c’est une demi-finale de Coupe du monde, il fait horriblement chaud. Qu’est-ce que vous vous dites entre coéquipiers, qu’est-ce que vous dit l’entraîneur ?Déjà, il faut savoir que l’entraîneur n’était pas si « important » . Sur le terrain, les joueurs prenaient beaucoup plus de responsabilités qu’aujourd’hui. De même, les joueurs se parlaient beaucoup plus sur le terrain et opéraient des petites ou grandes modifications sans consulter l’entraîneur à chaque fois. À 3-1, le match est perdu, normalement. Seulement, l’équipe ne voulait pas abandonner. On se disait que si on réduisait la marque, cela pourrait être notre chance. Elle était là, la motivation. Et c’est ce qui s’est passé. Rummenigge venait d’entrer, lui qui était blessé durant tout le tournoi, et il a mis le but du 3-2, avant que Klaus Fischer n’égalise. Bon, après, il y a eu les tirs au but, c’est toujours un truc où il y a un peu de chance, mais le plus important, c’est que nous seuls, les joueurs, avions décidé de ne pas abandonner. Nous ne voulions absolument pas perdre. L’entraîneur n’a rien fait de spécial pour nous motiver, il a juste fait l’équipe, avec une formation qui n’était pas la bonne en première mi-temps (rires) ! Bon, après, malheureusement, on l’a payé en finale. Cette prolongation nous avait achevés.
Mais qui était le leader de cette équipe, quel est le joueur qui a dit: « Allez, les gars, il faut y croire » ?À vrai dire, personne en particulier. Car il n’y avait que des mecs qui étaient déjà des leaders dans leur club. Schumacher, Uli Stielike au Real Madrid, Hans-Peter Briegel, mon frère et moi, Manfred Kaltz à Hambourg, Paul Breitner, Rummenigge, Hrubesch… Tous, tous se sentaient concernés, aucun d’entre eux ne voulait lâcher l’affaire. Bien sûr, après, il faut un peu de chance, mais la chance, ça se provoque.
En fait, quand vous vous gueuliez dessus, vous vous compreniez tous, ce n’était pas comme si l’un donnait des ordres aux autres, vu que vous étiez entre leaders…C’est ça. Quelque part, ça n’a plus trop rien à voir avec le football moderne, où tout est harmonisé. De plus, il y a tellement plus d’égoïsme aujourd’hui… Je ne dis pas qu’on ne l’était pas à l’époque, mais au moins, on voulait vraiment gagner. Et c’est ce qui s’est passé contre la France. Bon, après, on est tombés face à l’Italie, c’était difficile pour nous. D’autant plus qu’on est montés à Madrid après la rencontre, nous ne sommes arrivés qu’à cinq heures du matin, nous étions morts. Nous n’avons eu que deux jours de récupération, l’Italie avait un gros avantage sur nous. Heureusement, ce n’est plus comme ça aujourd’hui, c’est mieux géré. Parce que c’était injuste pour nous, mais ça aurait pu aussi l’être pour la France.
Suite à l’agression de Harald Schumacher sur Patrick Battiston, un sentiment anti-allemand s’est à nouveau développé en France, près de quarante ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que, quelque part, vous pouvez comprendre ce sentiment ?Oui, je le peux. Il faut être honnête : cette action aurait dû être sanctionnée par un pénalty ainsi qu’un carton rouge pour Schumacher. C’est du moins mon sentiment, je n’étais pas très loin de l’action, j’ai vu comment ça s’est passé. Toutefois, je n’irai pas jusqu’à dire que Schumacher l’a fait totalement exprès. Il y a faute, c’est clair, mais l’arbitre en a décidé autrement. Schumacher aurait sûrement dû voir rouge.
Vous voulez dire que Schumacher a réagi dans l’urgence, que ça s’est mal passé, et que l’arbitre s’est trompé ?Exactement. L’intervention de Schumacher est malheureuse, et je pense que l’arbitre aurait dû avoir un autre jugement.
Et vous vous êtes rendu compte de ça sur le moment ou bien après la rencontre ?Je m’en suis véritablement rendu compte quand j’ai revu les images à la télévision. Durant le match, quand on est concentré sur l’adversaire et qu’une telle chose se produit, on ne le remarque pas de suite.
Quatre ans après ce match, vous débarquez à l’Olympique de Marseille. Est-ce que ça a été un peu difficile pour vous au début, compte tenu de cette histoire (entre autres) ?Absolument pas. J’ai eu quelques problèmes au début, mais c’était parce que j’étais blessé. J’ai fait quelques matchs et je me suis retrouvé sur le flanc durant trois-quatre mois. Ceci étant, je n’ai jamais eu aucun problème à Marseille. Peut-être était-ce dû à ma façon d’être, j’étais gentil, poli, toujours prêt à donner le meilleur de moi-même, et ça plaisait aux gens. Je trouvais ça juste que les gens me jugent par rapport à mes performances et non pour ce que j’étais.
Pourquoi avez-vous choisi la France ?En fait, ça s’est fait très vite. Deux jours avant que je ne parte pour le Mondial 86 au Mexique, j’ai rencontré Bernard Tapie par l’intermédiaire d’un agent, et il est venu à Stuttgart. Il me voulait. Le problème, c’est qu’il me restait trois ans de contrat. J’ai alors appelé mon président pour lui dire que je voulais partir. Cela faisait onze ans que j’étais à Stuttgart. Je me plaisais là-bas, j’adorais jouer pour le VfB, mais j’estimais qu’il était temps que je fasse un pas en avant. J’ai donc rejoint Marseille pour 3,5 millions de Deutsche Mark, et je peux vous dire que je ne le regrette pas (rires).
Vous connaissiez le pays, auparavant ?Non, pas vraiment. Comme je vous ai dit, ça s’est fait très vite. Bernard Tapie est arrivé à la tête de l’OM et cherchait des joueurs. Hidalgo lui avait dit que « Förster était le meilleur à son poste » , mais qu’il ne m’aurait jamais. Alors Tapie lui a répondu : « On va bien voir. » Et je me suis retrouvé là-bas. Mais je ne connaissais pas du tout, j’avais joué quelques matchs amicaux avec Stuttgart contre Strasbourg, mais c’est tout. Je ne savais pas vraiment où j’allais atterrir.
Quatre ans après, l’huile d’olive, le poisson, tout ça était devenu normal pour vous…Oui (rires).
Vous revenez souvent en France ?Oui, j’ai une maison du côté de Narbonne. J’y suis en ce moment, pour les vacances. C’est un peu loin de Marseille, c’est vrai. Je m’y rends trois-quatre fois par an. Il m’arrive souvent de me rappeler les quatre années que j’ai passées à l’OM, c’était formidable. Je me souviens, lors de certains matchs à l’extérieur, les gens m’applaudissaient quand je faisais une jolie intervention. Et ce n’étaient pas forcément nos fans! Je n’avais jamais vécu ça en Allemagne. J’étais étonnamment surpris.
En fait, en quatre ans, vous avez plus travaillé pour l’amitié franco-allemande qu’un couple Kohl-Mitterrand ou Merkel-Sarkozy…Oui, c’est ça (rires). Bon, je ne veux pas me rendre plus important que ça, mais je pense que ce que j’ai fait en France a beaucoup contribué à rendre une image positive à l’Allemagne. J’en suis convaincu. On peut toucher beaucoup de gens par le biais du foot. Je pense que j’ai bien représenté l’Allemagne.
En fait, vous avez passé quatre ans à corriger l’erreur terrible commise par Schumacher. Vous avez réhabilité l’image du football allemand chez nous.C’est exactement ça. Et je suis content de voir que les gens ne m’ont pas oublié. Quand je vais à Marseille aujourd’hui, les gens viennent me voir et me remercient d’avoir joué chez eux et de leur avoir fait plaisir.
En fait, vous êtes quelqu’un de bien, même si on vous surnommait « Der Treter mit dem Engelgesicht » (ce qui se traduirait approximativement par : « La gueule d’ange qui donne des coups de pied » , ndlr). Vous jouiez dur, mais vous étiez correct.Oui (rires). Un journaliste avait écrit ça à l’époque, ça ne me plaisait pas trop, parce que je ne savais pas comment il fallait que je le prenne. Moi, je me suis toujours battu pour mon équipe. Et j’ai joué dur, certes, mais jamais pour faire mal. C’est, à mon avis, ce qu’il a manqué à notre équipe nationale cet été à l’Euro. Nous sommes devenus trop gentils, trop braves en défense ou au milieu de terrain. C’est pour cela que ça fait six ans que nous perdons soit en demies, soit en finale, parce que l’adversaire nous est aujourd’hui supérieur, là où nous autres, autrefois, nous étions supérieurs. Il nous manque aussi une certaine dureté qui est cruciale dans ce genre de rencontres, et ça s’est vu contre l’Espagne et contre l’Italie.
Vous faites quoi aujourd’hui ?Je suis agent de joueurs, je travaille avec Jürgen Milewski (passé par Saint-Étienne en 85-86, ndlr) et Jens Jeremies. Je m’occupe des intérêts de joueurs comme Sebastian Rudy, Martin Harnik, Aaron Hunt ou encore Daniel Didavi qui s’est malheureusement blessé.
Vous n’avez jamais imaginé devenir entraîneur ?Non, ce n’est pas pour moi. Après quinze ans de carrière en tant que joueur, je ne me voyais pas devoir m’occuper de tout et avoir une vie de famille en même temps. Imaginez, je vais dans un club, je bouge de chez moi, je me fais licencier, je repars, on me contacte, je m’en vais à nouveau… Non, ce n’est définitivement pas pour moi. Par contre, si vous me disiez de remettre les crampons et de jouer pendant quinze ans à nouveau, je dirais oui sans aucune hésitation.
Propos recueillis par Ali FarhatTwitter: @derpariser
Par