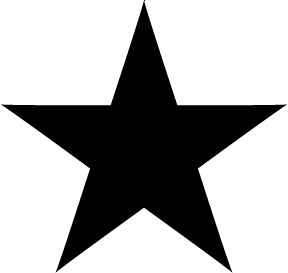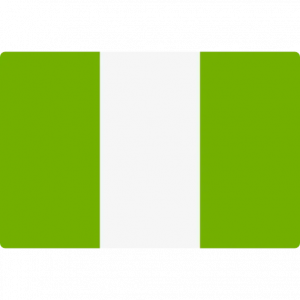- Argentine
Juan Sebastián Verón : « En Angleterre, après les matchs, il y avait des frites dans le vestiaire »

C’est chez lui, au centre d’entraînement de son club de toujours, l’Estudiantes de La Plata, que Juan Sebastián Verón reçoit. Le crâne impeccablement rasé, boucle à l’oreille. En bottines et blouson de cuir, la Brujita refait sa carrière. Le tout en s’abreuvant régulièrement de maté.
Estudiantes, ça représente quoi pour toi ?C’est une passion et une histoire familiale, mon père jouait ici dans les années 1960. J’ai suivi sa trace, cette tradition. Pour nous, les Argentins, les clubs sont plus que des associations sportives, ce sont des institutions. Le week-end, quand tu veux aller à la piscine, tu vas à celle du club. L’été, tu le passes au club. À toutes les vacances, tu es au club. C’est vraiment quelque chose de social. Il y a un lien très fort entre le club et ses membres, ce sont les institutions de chaque quartier, de chaque ville. Pour nous le club, c’est bien plus que venir, jouer au football et rentrer chez toi. C’est quelque chose qui fait partie intégrante de ta vie. Le lien avec ce club est très profond, puisque j’y ai passé mon enfance.
Gagner la Libertadores avec Estudiantes, ça a été un moment particulier ?Oui, avec le temps, tu fais passer les objectifs sportifs avant les rêves que tu avais étant gamin, tu réalises que c’est possible. Quand j’étais gamin, mon unique rêve était de jouer un jour pour Estudiantes.
Ensuite, tu te rends compte que tu as des objectifs sportifs comme il y a des plans de carrière, des objectifs de vie qui ne sont pas uniquement des rêves, mais que tu peux en faire une réalité. Quand j’ai commencé à jouer, à connaître l’histoire de ce club, ce que mon père y avait réalisé… J’ai toujours su dès mon départ que je reviendrais. Je ne me suis jamais imaginé vivre en Europe longtemps. Je me voyais revenir. J’y avais peu joué. En réalité, à peine un an et demi. Je crois que le joueur qui est né dans un club et qui y a passé du temps a envie d’y finir sa carrière. À mon retour d’Europe, j’ai décidé de revenir à Estudiantes. Et la victoire en Copa Libertadores, c’est probablement le meilleur moment de ma vie de footballeur.
Être président d’Estudiantes, c’est la suite logique de cela ? C’est une manière de rendre au club ce qu’il m’a donné et aussi de partager mon expérience du football européen. J’ai aussi une vraie volonté de faire évoluer le fonctionnement du club en m’inspirant de ce qui est fait en Europe. C’est très difficile qu’en Argentine, un club soit une société anonyme ou appartienne à quelqu’un. Mais il y a des questions d’organisation de fonctionnement des clubs européens, qui possiblement peuvent être imitées ici. Les clubs appartiennent aux socios, et le conseil d’administration est intégré par des gens normaux qui ne sont pas professionnels, qui ont un travail à côté. En raison de la tradition argentine, je pense qu’il est impossible de changer cela, mais il faut professionnaliser l’organisation des clubs. Il y a certaines résistances évidemment.
Tu n’as jamais voulu être coach comme de nombreux joueurs de ta génération ?Oui parmi mes coéquipiers, il y a Pochettino, Simeone, Gallardo. Moi non, je crois que le football a besoin de changements, de transformations plus structurelles au niveau de l’organisation même des clubs. Ce qui me plaît, c’est de transformer quelque chose, non pas depuis le banc de touche, mais en tant que dirigeant.
La tunique albiceleste, c’est quelque chose de très spécial dans ta carrière ? Avoir pu jouer trois mondiaux avec l’Argentine, c’était, disons, une grande fierté, mais aussi une grande responsabilité. Une joie particulière, on ne peut rien demander de plus. Bien sûr, il y a aussi une pression très forte. La sélection n’a rien gagné depuis les années 1990, ce ne sont que des années de frustration, nous n’avons rien pu gagner, alors que nous avons eu des générations de joueurs de très grande qualité qui ont très souvent gagné avec leurs clubs. Je crois que nous avons ce sentiment éternel, cette sensation que le travail n’a pas été fini, d’avoir une dette, un compte à régler. Évidemment que nous aurions adoré pouvoir gagner quelque chose, mais parfois, les choses ne se déroulent pas comme tu l’espères. Il nous a toujours manqué ce petit quelque chose. En 1998, le but de Bergkamp nous assassine, et sur l’action précédente, Batistuta avait frappé sur le poteau. C’est un poteau rentrant qui finalement ne rentre pas.
Il y a aussi ce Mondial 2002…Le Mondial 2002, nous étions les grands favoris avec la France. Ce sont des moments difficiles. Le football est difficile à expliquer, il y a tellement de variables à prendre en compte, les moments de chaque joueur, la préparation. Et parfois aussi, les matchs en eux-mêmes, les actions, c’est impossible à expliquer en réalité. Parfois, on cherche des raisons. La vérité, c’est que le football, ça n’est pas des mathématiques.
En 2002, votre coach était Marcelo Bielsa. Un type important pour toi ?Oui, Marcelo a eu une énorme influence sur énormément de joueurs de cette sélection devenus entraîneurs. Pochettino, Berizzo, Sensini, Heinze, Gallardo, ils ont tous pris un peu de lui. Ils ont puisé énormément dans son travail. Avec lui, on travaillait dur, très dur.
Il croit en quelque chose, il le mène jusqu’au bout et il te convainc de ses idées. Après, libre à chacun de croire que c’est une bonne manière de travailler ou pas, si tu es d’accord ou non. Moi, comme footballeur, de tous les entraîneurs que j’ai eus, j’ai pris quelque chose. Mais comme je n’ai jamais voulu être coach, je ne prêtais pas beaucoup d’attention à certaines questions qu’il soulevait. Parfois, il préparait presque les joueurs à être plus coachs que joueurs. Il n’entraînait pas seulement, il éduquait. Cela se voit. Il y a un peu de folie en lui, c’est quelqu’un de très instruit, de très cultivé, tu peux parler d’autres choses avec lui. Il a une personnalité particulière. Ça n’était pas l’entraîneur pote, il avait ses convictions là-dessus, qu’un entraîneur ne doit jamais être copain avec ses joueurs, mais je les entends.
En 2002, après le match contre l’Angleterre, on t’a accusé d’être un traître à la patrie. Tu l’as pris comment ?Après le match contre l’Angleterre, comme je jouais à Manchester. Ils ont dit que j’avais fait exprès de mal jouer, ils cherchaient un bouc émissaire. Je trouve certaines choses si stupides, si fausses que je n’arrive pas à y croire. Mais l’Argentin est très sensible à ce genre de choses, à ce que dit la presse. C’est sans doute dû à cette frustration et au fait qu’il fallait trouver un coupable. Ils tirent des conclusions fausses. Ce qu’il se dit ou se pense, je n’y prête pas attention, sinon je ne ferais rien du tout et je serais trop influencé par l’extérieur.
Hormis Bielsa, Bilardo a aussi était important pour toi ?Bilardo en soi, c’est quelque chose de spécial. Estudiantes est très identifié à Carlos. Il y a un rapport très spécial. En matière de style de jeu, d’influence et aussi parce que Carlos est d’ici. Cela fait de moi un bilardiste convaincu, très influencé par lui, par son style de jeu. C’est un homme que j’aime, qui est comme mon père. C’est un type très particulier. Pour le club, pour moi, c’est un homme qu’on aime. Avec ses folies.
Tu es parti d’Argentine à 21 ans, c’était difficile pour toi ?À l’époque, il n’y avait pas tous ces réseaux sociaux, tous ces moyens de rester en contact.
C’est très difficile. Tu arrives dans un nouveau pays, un football hyper compétitif. La différence était énorme à tous les niveaux, le football était bien meilleur qu’en Argentine. J’ai eu une période d’adaptation, j’ai eu la chance d’arriver dans un club comme la Samp, avec des coéquipiers formidables qui ont su m’intégrer. J’ai joué avec Oumar Dieng, Pierre Laigle, Christian Karembeu avec qui on est restés très amis, Boghossian. J’étais dans la même chambre qu’Oumar Dieng à mon arrivée. Il y avait un coach qui a su m’inclure. Ça a été essentiel. Et petit à petit, j’ai trouvé la clé. D’une certaine manière, c’était plus difficile d’arriver en Europe à l’époque. Mais la réussite au football dépend aussi du temps qu’on te laisse pour t’adapter. À cette époque, le championnat italien était le meilleur du monde, tu te battais contre les meilleures équipes du monde. Quand je suis arrivé, on jouait contre la Juve, l’AC Milan. À la Samp, puis à Parme et la Lazio, j’ai eu la chance de jouer dans des équipes incroyables, vraiment incroyables. Je sentais que nous étions dans des grandes équipes.

Et l’Argentine a beaucoup changé depuis l’époque où tu étais un jeune joueur. L’Argentine ne va pas bien, c’est sûr. Socialement, l’Argentine a beaucoup changé. L’éducation et la politique éducative sont moins bonnes, la sécurité s’est énormément détériorée. Le football a plus de responsabilités aujourd’hui. Les clubs argentins doivent former des hommes plus que des footballeurs. Il faut utiliser le football à cet effet.
Tu penses que le football a un rôle important à jouer ?Aujourd’hui, c’est quelque chose d’extrêmement puissant en Argentine. Les gamins voient dans le football une solution économique pour leurs familles. Souvent, les familles elles-mêmes voient le statut et le style de vie qu’ont certains joueurs de football, comme Messi, à 30 ans. Mais ils ne voient pas les sacrifices, le processus qui a mené à cela, ce à quoi ils ont dû renoncer, les difficultés. Ils ne voient pas que pour être un joueur d’élite, il y a beaucoup de sacrifices, mais aussi beaucoup de souffrance. Tu es loin de chez toi, tu renonces à ta jeunesse, à tes amis. Il faut avoir envie. Tout le monde n’est pas préparé, et tout le monde ne veut pas faire les efforts, beaucoup restent au bord de la route. En revanche, celui qui est moins fort, a moins de qualités footballistiques, mais plus de mental ira plus loin. Il ne faut pas abandonner à la première difficulté. Les difficultés, il y en a des centaines. Être footballeur professionnel, ça t’oblige à grandir tout d’un coup, soudainement, à prendre des décisions qu’une personne de 40 ans n’aurait pas à prendre. À gérer un environnement compliqué, à avoir la dalle. Passer des heures dans un bus pour aller à l’entraînement. Et il faut faire cela tous les jours, tout le monde n’est pas préparé à ça.
Dans une interview, tu parlais notamment de l’importance des psys pour aider les joueurs.Oui, pour moi, c’est quelque chose d’important, mais ça n’est pas le seul facteur qui va tout résoudre. Dans l’environnement d’un club de foot, il ne faut pas être dépendant du psychologue. Je ne suis jamais allé chez un psy. Je n’ai pas toutes les réponses. Il faut essayer de résoudre les problèmes qui arrivent aujourd’hui. Il y a 20 ou 30 ans, les familles étaient nucléaires. Aujourd’hui, les gamins vivent une réalité différente, ils ont plus de chances d’avoir une famille séparée. Le père peut être en taule, le frère dealer… Cela influe forcément sur le joueur, c’est banal de le dire. Il faut, pour ces types-là, un appui psychologique. À mon époque, c’était presque des cas uniques, mais cela a énormément changé. C’est presque plus commun d’avoir des familles disloquées qu’unies.
Tu as pu jouer avec Maradona et Messi. Comment perçois-tu les deux ? Quand Messi est arrivé en sélection, on savait qu’il allait être différent, et on ne s’est pas trompés. Et Maradona était différent, il a marqué notre jeunesse. C’est l’idole ultime de notre génération. L’Argentine a eu cette chance d’avoir deux des meilleurs joueurs de l’histoire en si peu de temps. Nous avons laissé Maradona, et 10 ans plus tard apparaît Messi. C’est un miracle quelque part.

En Argentine, Messi est parfois accusé de ne pas tout donner pour la sélection.Avant le Mondial 2010, on critiquait Messi parce qu’on disait en Argentine que Messi ne chantait pas les paroles de l’hymne argentin parce qu’il ne connaissait pas les paroles.
Alors pour le vanner, on lui envoyait les paroles de l’hymne. Mais ce sont des choses absurdes qu’on utilise parfois pour critiquer les joueurs. Ce qui est arrivé à Messi ou ce qui m’est arrivé avant n’a pas trop de sens, cela part de questions où l’on commence à mélanger la politique avec le sport, et c’est absurde. L’Argentine a toujours été très dure avec Messi, cela s’est un peu atténué, mais dans tous les cas, c’est dommage. Les gens ne savent pas si un autre joueur de même niveau va éclore. Ils devraient profiter de Messi. Il y a cette comparaison permanente avec Maradona, cet existimo qui existe en Argentine, cette exigence quasi factice de gagner un Mondial. On a gâché de l’énergie à lui chercher des poux au lieu de profiter de lui.
Tu as réussi en Italie, mais en Angleterre, c’était plus compliqué.L’Angleterre, c’était spécial depuis toujours pour moi. Mon oncle jouait à Sheffield. Et Manchester, c’est particulier, mon père a marqué à Old Trafford en finale de la Coupe intercontinentale. La vie a fait que j’ai eu l’occasion de jouer à l’endroit où Estudiantes est devenu champion du monde en 1968. Avec le temps, tu réalises que c’est fou, tu l’analyses. Pendant ta carrière, tu y penses, mais la carrière de footballeur ne te donne pas l’occasion de prendre du recul. Je vivais intensément, mais dans le moment. Avec le temps, tu réalises la portée du symbole. L’histoire est forte. C’est très intéressant, c’est quasiment mystique, et Estudiantes est mythique.
Et en Angleterre, tu découvres une autre dimension ?Le foot anglais était incroyablement différent. Dans la préparation, l’alimentation, c’était moins professionnel. Il n’y avait pas de mises au vert. Après les matchs, il y avait des frites dans le vestiaire. En Italie, on faisait vraiment gaffe. Pourtant, en Angleterre, physiquement, à l’époque, les mecs étaient au point, c’est incroyable, il y a sans doute une question génétique, je pense. Parce que je ne comprenais pas que le rythme soit si physique et si rapide avec cette alimentation. Ça m’a énormément surpris. Manger des frites après des matchs, ça m’a surpris.
Cela a changé depuis ? J’imagine ! En Argentine, en tout cas, cela a changé depuis quelques années. La médecine et la diététique ont énormément changé la carrière du footballeur. Aujourd’hui, les jeunes ont un nutritionniste et un régime propre et individualisé. Même quand je suis revenu, cela n’existait toujours pas.
En Italie, à ton époque, ces aspects étaient déjà pris en compte ?En Italie, je suis arrivé avec du ventre, j’ai commencé à voir un nutritionniste. C’était déjà très professionnel. J’ai changé en tant que joueur au-delà de mon jeu, de l’essence de mon jeu. C’est au niveau professionnel que j’ai changé. Je buvais du Coca, j’ai arrêté d’en boire.
L’Angleterre t’a plu malgré tout ?Quand je suis arrivé en Angleterre, j’ai trouvé cela extraordinaire. Pour moi, en tant que footballeur, l’Angleterre est le pays où il fait le meilleur vivre. La vie de footballeur est super là-bas, tu as de la pression, mais cela se limite au terrain. En dehors du stade, du terrain, tu vis une vie tranquille, personne ne t’embête, ne te regarde. En Angleterre, c’est super.
Et Manchester United ?Pour moi, Manchester United est le plus grand club du monde. Certains disent que c’est le Real ou le Barça, mais Manchester est immense comme club, société, institution, c’est vraiment autre chose. Avec une identité très forte et un truc encore plus mystique depuis sa dernière génération dorée : Neville, Scholes, Beckham, Giggs et Alex Ferguson.

Pourquoi n’as-tu pas pu complètement percé là-bas ?À Manchester, j’ai eu des hauts et des bas. En Italie, ma carrière a été plus linéaire. Mais à Manchester, tout a été fait pour que je réussisse : le club, le public, les gens, mes partenaires étaient formidables. C’est peut-être plus cette culture du football anglais en venant d’Italie. Je suis arrivé dans un système différent. Je me suis formé comme joueur dans un cadre strict. Et je suis sorti de ce cadre pour un autre plus détendu, où tu joues tout le temps, mais tu t’entraînes moins, où les pré-saisons sont bien moins intenses physiquement. Je crois que d’une certaine manière, cela a été préjudiciable pour moi. Je ne dirais pas que j’étais trop relax, mais je n’ai pas totalement réussi à m’adapter à cette manière de faire. Et j’étais le genre de joueur qui avait besoin d’être à 100 % physiquement, pour être bon sur le terrain. Le rythme de jeu était plus intense, plus fou. En Angleterre, tu joues pour gagner, les matchs sont ouverts. En Italie, quand tu allais jouer à l’extérieur, les équipes t’attendaient, c’étaient des matchs très tactiques. Ça n’allait pas d’un but à l’autre. Alors qu’en Angleterre, c’est toujours le cas. Si tu n’es pas parfaitement préparé, tu en payes les pots cassés.
Estudiantes sacré champion d’Argentine grâce à un ancien joueur de Ligue 1Propos recueillis par Arthur Jeanne, à La Plata