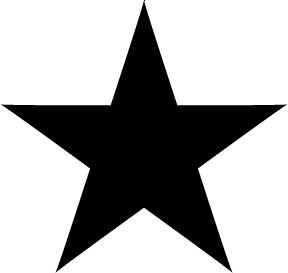- France
- OM
Jorge Sampaoli : « J’espionnais Marcelo Bielsa »

Disciple de Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, vainqueur de la première Copa América de l’histoire du Chili en 2015, n’a rien à envier à son modèle, que ce soit dans sa façon de vivre ou de penser le football.
Article paru dans le magazine SO FOOT #139 en septembre 2016.
La première fois que vous faites parler de vous, c’est en 1996, à cause d’un arbre.J’entraînais Alumni de Casilda, en division régionale. J’ai été expulsé du terrain parce que je sortais de la zone qui m’était assignée devant le banc. Il n’y avait pas de tribunes, du coup j’ai grimpé à un arbre d’où je donnais des consignes aux joueurs. L’arbitre ne pouvait rien dire, car ce n’était pas une zone réglementée. (Rires.) La photo a fait le tour des journaux de la région de Rosario, elle a lancé ma carrière!
Ça en dit long sur votre folie…Ça en dit pas mal sur la folie et la passion que j’ai pour mes équipes. Je suis constamment en train de faire des ajustements, de donner des consignes. Je me comporte plus comme un entraîneur de basket que de football. Je prends pleinement part au jeu, peut-être trop, mais je n’attends pas la mi-temps ou un temps mort pour donner des consignes.
C’est pour ça que vous ne tenez pas en place le long de la ligne de touche ?Je suis hyperactif. Sur la touche, je suis incapable de rester en place et j’ai besoin de marcher, de faire des allers-retours pour réfléchir. Ça fait venir les idées plus facilement. Je ne peux pas penser en étant assis, j’ai des fourmis dans les jambes.
Vous avez déclaré que vous ne profitiez pas du football.Je souffre le football en ce moment, à cause de l’hystérie engendrée par le court terme, l’instabilité constante engendrée par les médias, la pression et l’impossibilité de construire des projets à long terme. Il faut être fou pour profiter avec toute cette pression. Avant, on donnait du temps pour construire un projet, ça n’est plus le cas. Regardez Arsène Wenger : qui aurait pu imaginer avec tout ce qu’il a construit pour Arsenal que les supporters allaient faire des banderoles pour exiger son départ ? La folie engendrée par la peur de perdre fait qu’aujourd’hui les entraîneurs ont une durée de vie très courte et pas d’emprise sur un projet sportif. Et s’il n’y a pas de projet, cela n’a aucune chance de fonctionner et il y a très peu d’équipes qui offrent un spectacle intéressant.
Regarder des matchs ne vous procure même pas de plaisir ?Je profite plus en regardant un film, en allant à un concert de rock ou en écoutant un discours du général Peron. Bien sûr, je suis le foot, je regarde tous les championnats, mais ça n’est pas pour le plaisir, c’est pour le travail. Je peux me régaler devant le Bayern Munich, le Barça et son trident offensif, la Roma de ces derniers temps ou le PSG, mais j’apprécie le fonctionnement collectif ou la stratégie de très peu d’équipes. Je vois des matchs, mais je ne vois pas de football. J’ai un sentiment de frustration. Il y a un gros écart entre ce que je vois et ce que je voudrais voir.
Du coup, où allez-vous chercher de la satisfaction ?Je regarde beaucoup de basket, de tennis. J’adore le rugby aussi, car cela se joue avec le cœur, avec l’amateurisme, pas pour l’argent. Voir jouer les Pumas, c’est extrêmement émouvant, quand on les voit pleurer, c’est de la sincérité, de l’émotion à l’état pur. Ce sont des valeurs qui se perdent dans le football. Avec l’argent, les joueurs n’ont plus ce sentiment d’appartenance avec la ville pour laquelle ils jouent. Il faut récupérer ce sentiment.
Vous avez quand même ressenti du bonheur en remportant la Copa América 2015, non ?Non, plus de la tranquillité, le sentiment du devoir accompli, d’avoir fait du très bon boulot. Le fait de savoir qu’on a gagné en étant invaincu. Plus qu’une célébration, ça a été un soulagement, comme si mon corps et mon esprit étaient enfin détendus. Je voulais juste retrouver ma famille, mes amis. Après la victoire, je suis rentré directement chez moi. Mais dans le foot, tout va très vite, le succès n’est pas éternel. Il y a toujours de nouveaux projets, et je serai jugé pour mon palmarès ou mon passé. Bien sûr, il y a de la fierté, d’avoir fait tomber l’Espagne, d’être la cinquième meilleure sélection du monde ou d’avoir remporté la Copa América. Mon étape chilienne a été très importante aussi bien pour moi que pour le pays. Mais je savais que c’était aussi la fin d’un processus et qu’un autre allait commencer.
![]()
Vous n’avez pas fêté la Copa au palais présidentiel avec les joueurs.C’était un choix, car nous venions de battre l’Argentine, un pays où j’ai toute ma famille, mes amis. Mon pays. Et par rapport à mes proches qui avaient souffert devant le match, c’était impoli de fêter le titre avec la présidente chilienne.
Vous avez connu la dictature militaire argentine (1976-1983). C’était comment ?C’était un moment très difficile. À la faculté, je faisais partie d’un mouvement révolutionnaire : les jeunesses péronistes. On se réunissait clandestinement, on faisait de l’activisme, du tractage. On exigeait la fin de la dictature. On était persécutés par le régime, il y avait des disparus et on combattait la dictature par des manifestations. On assistait à des concerts de rock clandestins qui nous permettaient d’exprimer la rage et la rébellion qu’on avait en nous. Et en 1983, nous avons réussi à obtenir un gouvernement démocratique.
Vous avez eu des ennuis à ce moment-là ?J’avais la chance d’avoir un père policier. Sans lui, j’aurais sans doute été un disparu de plus. Mon père m’a sorti mille fois de situations compliquées, de problèmes avec le régime. Il me prévenait toujours des choses qui pouvaient se passer, si on avait une réunion prévue à tel endroit, il me disait : « N’y va pas, le régime a prévu de venir vous y arrêter. »
Que représente le général Peron (1895-1974, NDLR) ?Pour moi, c’est un leader qui a réussi à mobiliser des millions de personnes derrière ses idées. C’est incroyable, tout ce que disait le général émouvait chacun au plus profond de soi. C’est quelqu’un qui voulait toujours plus de justice sociale, sans doute le plus grand homme de l’histoire du pays.
Vous avez toujours cet esprit de rébellion ?Oui toujours, j’ai horreur de l’injustice, j’essaie de m’engager pour des causes que je trouve justes. J’avais déclaré par exemple que je soutenais le mouvement des étudiants chiliens, car l’éducation devrait être gratuite pour tout le monde. J’essaie d’apprendre des mouvements activistes, comment transmettre des valeurs, ce qui est aujourd’hui difficile.
Écoutez-vous toujours beaucoup de rock barrial (rock argentin issu des barrios, les quartiers en français) ? Oui, j’écoute tout le temps des groupes comme Callejeros, Los Piojos, Bersuit Vergarabat. Tous ces groupes ont su conquérir les masses en venant du barrio, avec leurs messages engagés et leur lutte constante contre l’injustice. Je suivais Charly Garcia et Leon Gieco aux quatre coins du pays pour le voir. Le rock argentin a énormément marqué ma manière d’être et de penser.
Pourtant, vous commencez votre carrière comme fonctionnaire à la banque. C’est beaucoup moins rock’n’roll…Je travaillais à la banque dans ma ville, à Casilda. À la fin de ma journée, je sautais dans ma caisse et j’allais entraîner des petites équipes à Rosario, puis je retournais à Casilda, 120 kilomètres dans la journée.
Vous n’imaginez alors pas devenir pro. Vous avez pensé à renoncer au football ?Je n’ai jamais pensé renoncer au football, j’ai pensé renoncer à la vie plus qu’au football. (Rires.) J’étais prêt à sacrifier n’importe quoi, mais pas le football. Mon rêve a toujours été d’entraîner. À huit ans, j’enregistrais mes consignes à des joueurs imaginaires avant la finale d’un mondial. C’est mon but ultime : si un jour je peux jouer la finale d’un mondial avec l’Argentine, alors ce sera ce dont j’ai toujours rêvé !
Vous avez une trajectoire peu banale pour un entraîneur.Le chemin a été très dur, très sinueux. Et j’ai réussi à émouvoir les gens avec mes équipes, à leur faire ressentir quelque chose. C’est essentiel. C’est très important d’avoir acquis cette reconnaissance mondiale en partant de rien, être l’un des trois meilleurs entraîneurs du monde en entraînant le Chili, pour moi, c’est historique.
Ça vous rend heureux, ça, non ?Je suis satisfait que les gens reconnaissent et apprécient la manière de jouer du Chili. Plus que le fait d’avoir obtenu quelque chose, la reconnaissance de comment nous l’avons obtenu. En dominant, en étant supérieurs au rival. Tout ce jeu créé par le Chili, avec des joueurs qui pour la moitié n’étaient pas titulaires en club (Vargas, Isla, Jara), avec une équipe qui n’avait jamais imposé son style, c’est très émouvant. Pouvoir améliorer ce qu’avait fait Marcelo Bielsa était notre premier objectif. Et on a réussi.
Vous venez de nulle part, vous avez entraîné votre première équipe pro en 2002 : ça a fait de vous un coach à part ?Oui, car je n’ai jamais été joueur de football. J’ai eu un processus d’apprentissage très long qui m’a permis de développer mes idées et d’affronter n’importe quel joueur, en lui imposant ce que je sentais, même si c’est plus difficile de convaincre un joueur de haut niveau qui a son propre ego au-dessus du drapeau, car tu n’as pas la légitimité d’un ancien pro ou d’une ancienne star. Il faut réussir à lui rappeler qu’un jour, il a été amateur, et le ramener à cette condition. Je suis autodidacte. Mon université a été la rue. J’ai appris de milliers de situations que j’ai provoquées, que j’ai vécues et qui m’ont permis de me développer comme éducateur.
Qu’avez-vous appris dans la rue ?À connaître les gens. Connaître un joueur, l’appréhender humainement. Considérer les footballeurs dans leur ensemble, c’est une erreur. Avant d’être tacticien, il faut être sociologue. Il faut animer le groupe, le convaincre d’une idée commune en connaissant les personnalités de chacun pour ensuite la traduire tactiquement. Si un entraîneur ne fait pas l’effort de connaître celui qu’il dirige, il va vers l’échec.
Alors que vous entraîniez à Rosario, vous êtes parti sur un coup de tête en Espagne.Toute une aventure ! En 2002, je suis parti en Espagne avec très peu d’argent et Jorge Decio, mon préparateur physique. Son frère jouait à Alavés. On a commencé à faire le tour d’Espagne, à assister à tous les entraînements, à observer les méthodes de travail. Ensuite, on est allés en Italie et on a analysé tout ce qu’on a vu. On a tout fait en train, à l’arrache comme des backpackers. Ça a été un voyage initiatique, on a vu plein de choses, des méthodes de travail européennes. On a vu et écouté. Dans certains clubs, on s’est fait des contacts qui nous permettaient d’entrer dans les centres d’entraînement. On a pas mal appris sur nos propres méthodes de travail. On dormait dans des auberges de jeunesse, il fallait gérer les sous intelligemment pour rester le plus longtemps possible.
Votre premier modèle reste Marcelo Bielsa…Je l’espionnais ! J’allais voir tous ses entraînements à Newell, j’écoutais – et je réécoute encore – toutes ses conférences, la manière dont il transmettait ses valeurs et l’idée qu’il avait du foot, la volonté de toujours faire le jeu. J’ai ressenti une adhésion totale qui dure encore aujourd’hui. L’essence pure de Bielsa et toutes ses idées originelles viennent de cette époque. Son Newell’s était une équipe merveilleuse, il y avait tellement de passion. J’enregistrais les matchs de Newell’s, j’analysais certaines phases de jeu sur vidéo pendant des heures, je décortiquais tout. Ses entraînements aussi. Je passais quatorze heures par jour à penser à Bielsa.
![]()
Vous avez établi un contact avec lui ?Quelques coups de fil, mais très peu en vérité. Ses idées, sa vision du foot et ses concepts m’intéressaient beaucoup plus que sa personne. C’est un mythe et, parfois, c’est mieux de ne pas rencontrer un mythe, pour qu’il conserve ce statut.
Quand avez-vous mis en place votre philosophie de jeu ?J’ai toujours essayé de développer un jeu qui a de la personnalité, basé sur la possession, la volonté d’attaquer. Quand je suis devenu professionnel, j’ai tout de suite pensé que j’avais trois matchs pour faire mes preuves. Comme je n’étais pas un coach connu, je serais viré facilement, je ne durerais pas beaucoup plus que cela si ça ne fonctionnait pas. L’idée était de marquer les esprits. Je ne pouvais pas faire quelque chose de banal, je devais être différent. J’ai préparé mes équipes ainsi et j’ai réussi à faire de mes équipes des équipes dominatrices.
Comment faites-vous pour sortir vos équipes de l’ordinaire ?En faisant l’inverse de ce que font tous les entraîneurs aujourd’hui : je pense beaucoup plus au but d’en face qu’à préserver le mien. Même si on a une petite équipe, il faut avoir l’idée de regarder l’adversaire dans les yeux et la volonté d’imposer son rythme.
Tactiquement, vous avez plusieurs schémas de prédilection, notamment le 3-4-3… Je crois qu’au fond, le 3-4-3 est mon schéma favori, même si on lui a apporté pas mal d’ajustements. L’idéal, pour développer un jeu de possession et soumettre l’adversaire, c’est le 3-4-3 de Cruyff. L’idée, c’est d’être toujours dominateur. Mais le dispositif en soi peut changer : en 3-1-3-3, en 4-3-3, il doit juste être un moyen de soumettre l’adversaire. Si on est neutralisé sur les cotés, alors attaquons par le centre.
La possession est l’essence de votre football ? Pour arriver à dominer l’adversaire, tu dois avoir le ballon. Il n’y a qu’un seul ballon sur le terrain, donc il est obligatoire de l’avoir plus de temps que l’adversaire pour le dominer. Surtout, la récupération est la clé. Quand tu perds le ballon, il faut le récupérer en moins de cinq secondes pour pouvoir le garder à nouveau. Si tu perds le ballon dans la surface adverse et que tu ne parviens à le récupérer que dans ta surface, les transitions sont alors favorables à l’adversaire.
Avec le Chili, vous avez évolué avec un vrai 10.Tout dépend des joueurs que tu as à disposition. Mais on fait en sorte, avec mon staff, de toujours avoir dans le groupe un joueur capable de porter l’estocade dans les 30 derniers mètres, de donner une passe décisive. Il fallait trouver des variantes offensives pour engendrer plus d’incertitude, d’incommodité à ceux qui défendaient contre nous. Valdivia nous donnait cette possibilité. Il était capable en une passe de casser les lignes, de mettre l’attaquant face au gardien adverse. C’est un joueur unique, il a une vision des mouvements de ses partenaires extrêmement rapide. Il voit le jeu avant de recevoir le ballon. On dit qu’il n’a jamais eu sa chance en Europe à cause de sa condition physique, mais moi, je ne voulais pas qu’il coure, je voulais qu’il joue, qu’il crée!
Ces meneurs sud-américains, comme Valvidia ou Riquelme, connaissent généralement des fortunes diverses en Europe, mais sont des idoles dans leurs pays. Pourquoi ?Quel dommage, ils manquent tellement. Le football maintenant, ce sont des joueurs qui regardent leurs GPS pour savoir combien de kilomètres ils ont couru pendant la rencontre. Je veux qu’ils se demandent comment ils ont joué, pas combien ils ont couru. Ce changement me peine, car le foot se transforme en un sport où il vaut mieux être un bon athlète qu’un bon footballeur. Le physique est devenu la priorité numéro un. Les joueurs se focalisent plus là-dessus que sur le jeu. Mais le plaisir est dans le jeu, pas dans l’athlétisme ! Un joueur comme Valdivia est l’un des derniers à profiter, à s’amuser quand il joue.
Et Lionel Messi ?Messi, c’est un type d’une autre planète. On ne peut pas le critiquer, et on ne peut pas non plus l’évaluer, c’est impossible. Si tu as Messi dans ton équipe, tu es quasiment sûr de gagner, c’est le seul joueur comme ça. Aujourd’hui, le talent est complètement sous-évalué dans le football mondial.
C’est-à-dire ? Le talent n’a pas disparu, il est juste bloqué, contrarié. Ça fait un moment que le footballeur est devenu un fonctionnaire et qu’il ne profite plus du jeu de la même manière. C’est devenu un métier comme un autre. Avant, les footballeurs s’amusaient, il y avait de l’art, de la créativité !
L’aspect psychologique a été important lors de votre mandat sur le banc du Chili ?Oui, psychologiquement, il a fallu inculquer la gagne à cette équipe qui vivait de triomphes moraux. On a beaucoup travaillé cet aspect en faisant en sorte de toujours attaquer. L’idée, c’était d’attaquer quatre-vingt-dix minutes, sans répit, et de voir comment ça fonctionnait. Si tu attaques, tu peux soumettre l’adversaire, et il se réfugie dans son camp. Peu importe qu’on mène 1, 2 ou 3-0 ou si on perd, il faut attaquer pendant quatre-vingt-dix minutes. Il faut établir cette domination.
Il paraît que vous travaillez avec un drôle de logiciel… Qui ressemble beaucoup à la Playstation, oui. L’ordinateur fait l’adversaire, en répliquant plus ou moins les mouvements de ses derniers matchs, et mes joueurs jouent avec des manettes pour déstabiliser ce bloc qui représente l’adversaire. Les joueurs se déplacent avec leurs manettes et quand ils font un mouvement que j’estime mauvais, j’arrête la simulation.
Malgré vos succès, les Chiliens ont beaucoup critiqué votre départ.Les médias ont essayé de créer une distance. Mais je dis toujours que l’affection que je reçois au Chili est incroyable. Ce pays m’a beaucoup apporté et je lui ai beaucoup apporté. Des quatre titres internationaux que le Chili a gagnés en cent ans, j’en ai gagné deux en quatre ans (une Copa Sudamericana avec la U de Chile et une Copa América). La presse peut dire ce qu’elle veut, mais c’est exceptionnel.
Vous avez dit que c’était dur de gérer un groupe de jeunes millionnaires. Vous pouvez développer ? Parfois, c’est compliqué de motiver des types de 25 ans qui savent déjà qu’ils ont assez d’argent pour toute leur vie. Les motiver pour faire, par exemple, ce qu’ont fait Medel ou Vidal pendant le mondial en mettant leur intégrité physique en danger, c’est compliqué avec beaucoup de joueurs. Mais quand tu as des exemples comme ça dans un groupe, les autres suivent. Gary Medel transmet ces valeurs amateurs, de jouer pour le plaisir, pour les couleurs, de tout donner. Et ça, dans une équipe, ça n’a pas de prix.
C’est pour cela que vous n’aviez pas viré Vidal après l’épisode de la Ferrari ? Dix minutes après avoir appris l’incident, je savais que je le conserverais. J’ai évalué ce qu’était Vidal dans le groupe. Il était fondamental, c’était impossible de le virer. Sans lui, on n’aurait pas gagné la Copa América. On pouvait l’engueuler, mais le virer, jamais, même si la presse voulait sa tête. J’avais une dette par rapport à lui. Au mondial 2014, il avait mis son genou en jeu, il a joué la compétition blessé, la Juventus ne voulait pas qu’il joue. Et il a tout donné pour le Chili. Il suffit de voir tout ce qu’il donne à l’entraînement, Vidal est un crack. L’enjeu n’a aucune prise sur lui, qu’il joue le match le plus important de la saison, ou un petit match de quartier, il est toujours pareil. Il y a très peu de joueurs comme lui ou Medel aussi, que les grands matchs rendent meilleurs. Ce sont des joueurs de barrio, de l’école de la rue.
En Europe, il y a très peu de joueurs comme ça. La plupart sont en centre de formation depuis leurs 14 ans…Certes, mais il doit y en avoir peu, je vais aller les chercher et je vais les trouver. Il faut retrouver ce sentiment d’appartenance à l’endroit. Par exemple, lors de la saison 2014-2015, la population de Marseille s’identifiait pleinement à son équipe et avait cette sensation d’appartenir à quelque chose quand Bielsa entraînait. Il a su créer cette ambiance qui a fait que la ville entière a adhéré à son projet, et que les joueurs ont suivi.
Vous avez sorti un livre qui s’appelle No escucho y sigo qui peut se traduire par quelque chose comme « Je n’écoute personne et j’avance ». C’est votre credo ? Oui, c’est le titre d’une chanson de Callejeros. La chanson dit que tout ce qui t’est interdit t’incite à y aller. Je rapporte cette chanson à mon histoire personnelle. Quand j’étais à Casilda, tout le monde me disait de continuer à bosser à la banque, de ne pas tout laisser tomber pour le football. Je n’ai écouté personne et j’ai continué à faire ce dont j’avais envie. Depuis toujours, j’ai un objectif clair, qui est de réussir dans le football, devenir le meilleur entraîneur du monde et je suis sur la bonne voie.
Propos recueillis par Arthur Jeanne, à Santiago du Chili en 2016