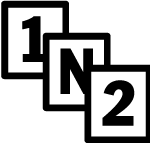Vous êtes né à Auckland, mais vous avez passé les six premières années de votre vie aux Tonga. Quel souvenir gardez-vous de cette époque ?
Je me revois pieds nus, à courir partout, toujours en liberté. Il y avait aussi la mer et les bagarres. Je me souviens aussi de mes oncles et à quel point ils étaient gros. Mais je ne repense pas trop à cette époque. Je suis une personne qui regarde simplement ce qui se passe devant et qui poursuit son chemin.
Pourquoi vos parents ont-ils choisi de quitter les Tonga ? Ils voulaient nous donner une meilleure éducation et de meilleures opportunités. Cela n’aurait pas été possible là-bas. Mes deux parents travaillaient dans une usine.
À Auckland, vous avez grandi dans l’un des quartiers les plus durs de la ville. Cette violence a-t-elle marqué votre personnalité ? Dans le coin où j’ai passé ma jeunesse, tout le monde connaît tout le monde, mais cela ne signifie pas que tu es en sécurité pour autant. Si tu baisses ta garde, tu peux avoir des ennuis. Et même si tu es sur tes gardes, des gens essaient quand même de te causer des ennuis. À South Auckland, si tu ne sais pas te battre, tu te fais tout le temps cogner. Donc, il fallait gagner le respect et cela prenait du temps, tout simplement parce que si tu montrais ne serait-ce qu’un instant de faiblesse, tu savais que les gens allaient en profiter. Je crois que ça m’a appris à être vigilant. J’y retourne parfois. Le problème, c’est que les choses dans ce quartier sont toujours les mêmes. Comme tout le reste, la situation empire avant de pouvoir s’améliorer.
Quelle place avait le rugby là-bas ?
C’était un élément incontournable de la vie du quartier. Tout le monde aimait jouer. C’était aussi un bon apprentissage pour les enfants. On avait l’habitude de jouer sur le béton, dans la rue.
Mais vous jouiez sans contact ?
Ah non, on se plaquait (rires).
Vous pratiquiez d’autres sports ?
J’ai commencé le rugby sérieusement à 14 ans. Avant, et même après, je me suis intéressé à d’autres sports : le kick-boxing, la boxe, l’athlétisme… Dans ma famille, on donne plutôt dans les sports de combat. L’un de mes cousins entraîne : Ray Sefo, qui a combattu Cyril Abidi et Jérôme Le Banner (deux légendes du K-1 en France, ndlr). C’est chez lui que je m’entraînais. Je ne pensais pas que j’allais devenir un joueur de rugby. Je pensais qu’en grandissant, je finirais boxeur. J’ai même pensé à devenir pro. J’aimais ça et je m’entraînais beaucoup. Je m’en suis d’ailleurs servi pour le rugby, que ce soit mentalement ou physiquement.
Et l’école dans tout ça ?
Vous savez, il existe deux types d’élèves : ceux qui s’assoient au premier rang et ceux qui dorment au dernier. Je dormais (rires). Pourtant, j’étais plutôt pas mauvais à l’école, mais à cause de l’endroit d’où je venais, j’avais appris à ne pas être trop malin. Après, ma mère m’a envoyé dans un internat. J’ai mis beaucoup de temps à m’adapter là-bas. Je n’aimais pas être privé de liberté.
À South Auckland, si tu ne sais pas te battre, tu te fais tout le temps cogner. Donc, il fallait gagner le respect et cela prenait du temps, tout simplement parce que si tu montrais ne serait-ce qu’un instant de faiblesse, tu savais que les gens allaient en profiter
La liberté, comme prendre votre BMX et arpenter tout Auckland avec votre bande…
Je le fais encore, vous savez! Ça m’a beaucoup manqué. C’était juste la liberté à l’état pur que de monter sur le vélo et aller où je voulais. Mes amis et moi avions l’habitude de pédaler de chez moi jusqu’à la plage, ce qui fait bien quatre ou cinq heures aller-retour. On adorait ça, toute cette liberté, on découvrait le centre-ville d’Auckland. C’était une ville complètement différente. Pendant la journée, les gratte-ciel, et la nuit, l’agitation des boîtes de nuit, des bars, des gens qui se saoulent, qui s’embrouillent, qui se battent, qui se font poignarder. Enfin, c’était comme ça à l’époque, quand j’étais jeune.
Vous avez souvent dit que le rugby vous avait écarté du mauvais chemin. Comment l’expliquez-vous ?
Quand tu découvres le rugby, tu apprends comment te contrôler. Comment contrôler la violence, surtout. Si tu peux contrôler cette violence, tu réussis dans ce que tu fais. Si tu es agressif, sans contrôle, alors tu vas perdre. Dans le rugby comme dans la vie.
Et à quel moment vous prenez conscience d’être un joueur différent des autres ?
Il y a beaucoup de gens qui veulent être les meilleurs. Moi, ce n’était pas « je veux être le meilleur » , c’était « je veux voir à quel point je suis bon contre les meilleurs » . Et si j’étais assez bon pour les battre, alors j’espère que j’étais le meilleur. C’était juste ma façon de jouer. Je respecte mon adversaire mais je ne le crains jamais.
Tout est allé très vite pour vous. À 19 ans, en 1994, vous débutez et perdez avec les All Blacks contre la France. Vous aviez été très critiqué à l’époque. Il paraît que vous aviez failli signer avec les Sydney Bulldogs en XIII. C’est vrai ?
Je pense que c’était juste parce que j’étais le plus jeune. J’avais l’impression d’avoir été traité de manière injuste. À ce moment-là, j’étais persuadé que je venais de jouer mon dernier match avec la sélection. J’ai commencé par le XIII, et je suis passé à XV en pension. J’ai toujours pensé que j’y retournerais. Mais non, finalement.
Vous avez beaucoup souffert physiquement lors de la longue préparation pour la Coupe du monde 1995. À l’époque, vous aviez déjà des problèmes de rein. Pourquoi n’avoir rien dit ?
Parce que je ne voulais pas susciter la compassion. Je voulais juste être choisi pour mon niveau. Si je suis assez bon pour être dans l’équipe, je suis assez bon pour être dans l’équipe. Si je le ne suis pas, je rentre à la maison.
Dès le premier match contre l’Irlande, vous crevez l’écran en quelques actions. On vous propulse star de la compétition. Cela ne doit pas être facile à gérer à 20 ans.
Pendant la Coupe du monde, je ne lisais pas les journaux, je regardais juste des films, aucune chaîne de télévision. Donc je ne savais pas ce qui se racontait à l’extérieur sur moi. Je n’en ai jamais eu la moindre idée. Moi, je tenais juste à jouer pour mon pays et mon équipe.
Quand on vous voit marcher sur vos adversaires comme l’Anglais Mike Catt en demi-finale, on a l’impression d’un adulte qui s’amuse avec un enfant. Vous aviez aussi cette sensation de facilité ?
Pour moi, Mike Catt était au bon endroit au mauvais moment. C’est comme ça que je l’explique. Au bon endroit pour moi, mais au mauvais moment pour lui. J’étais en train de trébucher sur cette action. S’il avait été peut-être à deux pas ou même un seul en arrière, j’aurais pu m’effondrer à ses pieds. Mais sa présence à cet endroit précis m’a aidé à retrouver mon équilibre. Je lui en suis reconnaissant à chaque fois que je le vois. Mais nous n’en parlons pas, j’ai trop de respect pour Mike et sa carrière.
Tony Underwood a lui aussi passé un sale moment ce jour-là. Avant le match, il avait expliqué que vous aviez croisé des ailiers faibles et qu’il avait un plan pour vous stopper. Vous étiez décidé à lui répondre sur le terrain ?
Oh oui. J’adore quand quelqu’un essaie de me défier. En fait, le rugby est un sport de combat : apporte ce que t’as de mieux, j’apporte ce que j’ai de mieux, et on verra qui est le meilleur.
Vous étiez un joueur craint pour votre physique, mais vous n’étiez pas trop bagarreur sur un terrain. Vous n’aviez pas besoin de l’être ?
Pour moi, ce n’était pas nécessaire. Le rugby est un jeu magnifique où tu joues selon les règles. Si tu es là pour quoi que ce soit d’autre, comme essayer de blesser ton adversaire, tu ne devrais pas jouer. Qu’est-ce que j’aurais gagné à faire mal à quelqu’un ? J’aurais pu être suspendu et mon équipe se serait retrouvée punie. Pourquoi ? Pour avoir été stupide. Ça ne valait pas le coup.
Si nous avions gagné en 1995, les gens ne se souviendraient pas de cette Coupe du monde. C’était quelque chose de plus grand, de bien plus important que le rugby. C’était un mouvement, une nation, l’Afrique du Sud, qui était en passe de se réconcilier avec elle-même
On dit parfois que l’équipe des Blacks en 1995 était la meilleure qu’on n’ait jamais vue, et pourtant, vous avez perdu en finale contre l’Afrique du Sud. Comment l’expliquez-vous ?
C’est l’essence même du rugby. À quel point vous êtes forts n’a pas d’importance, c’est ce qui se passe pendant 80 minutes qui compte. Mais il faut rendre le respect qu’elles méritent aux équipes qui nous ont battus. Les Français en 1999 et les Sud-Africains quatre ans plus tôt ont bien joué. Je les ai toujours respectés, parce qu’ils arrivaient et jouaient leur jeu pour nous contrer. C’est la beauté du sport, non ? Parfois, tu gagnes, parfois, tu perds. C’est comme la vie.
Après vos quatre essais en demi-finale, les Springboks avaient préparé un plan anti-Lomu. Vous l’aviez tout de suite perçu sur le terrain ?
Je savais qu’ils prévoyaient quelque chose. Mais notre problème, c’est que nous n’avons pas réussi à terminer nos actions. Je prenais des trous, j’ai eu des occasions, mais nous avions des problèmes de finition. Il y a des jours comme ça. Pour moi, le tournant de cette finale arrive quand je reçois le ballon de Walter Little et que je suis arrêté pour une passe en avant. Ce moment-là (il marque une pause)… À mes yeux, il n’y avait pas en-avant. L’arbitre était très loin de l’action donc je ne sais pas comment il a pu le voir. C’est sa décision et tu dois l’accepter. Pour moi, quand on parle de souvenirs douloureux, je pense à ce moment précis. J’ai eu l’occasion de marquer l’essai qui aurait pu faire toute la différence.
Il y a aussi toutes ces rumeurs sur l’empoisonnement dont certains de vos partenaires auraient été victimes…
Dans le fond, ce ne sont que des rumeurs. Nous n’étions juste pas assez bons pour gagner cette finale. Et puis, ce match appartient aux livres d’histoire à présent. Donc, on ne peut plus débattre sur ce sujet. Pour vous dire la vérité, quand je pense à cette défaite en 1995, je pense que si nous avions gagné, les gens ne se souviendraient pas de cette Coupe du monde. C’était quelque chose de plus grand, de bien plus important que le rugby. C’était un mouvement, une nation, l’Afrique du Sud, qui était en passe de se réconcilier avec elle-même. Les Sud-Africains avaient besoin de ce résultat pour être tous réunis sous un seul drapeau, un président et un capitaine. C’est plus grand que tout. Ce jour-là, nous étions 22 joueurs mais nous affrontions 44 millions de personnes. Lorsque vous vous dites ça, ça veut dire beaucoup. Je ne peux pas parler pour mes coéquipiers, mais pour moi, ça a en quelque sorte apaisé la douleur de la défaite. Peu de joueurs, peu d’équipes peuvent dire qu’ils ont joué un match qui a changé l’histoire d’un pays.
Vous avez pu parler avec Nelson Mandela à cette occasion ?
Je lui ai parlé avant le tournoi, lorsqu’il est venu nous voir. Le plus drôle, c’est quand vous essayez de penser à quelque chose d’intelligent à dire à quelqu’un comme lui et quand il arrive, vous bloquez et dites simplement : « Salut, heureux de vous rencontrer. »
L’Australien John Eales a dit que vous avez fait découvrir le rugby au monde entier en 1995. Vous aviez conscience de votre importance ?
J’en avais conscience. C’est difficile de mettre le doigt dessus mais je suppose que c’est ce qui arrive quand vous jouez un type de rugby unique et que les gens aiment regarder. Après, ils veulent en savoir plus, en voir plus. Je trouve ça marrant maintenant que des enfants qui n’étaient même pas nés quand j’ai commencé avec les All Blacks regardent mes vidéos sur YouTube et qu’ils soient là, genre : « Wow Jonah ! » C’est un phénomène intéressant la célébrité (rires).
On a aussi l’impression qu’il manque un joueur qui sort du lot comme vous à l’époque pour parler au grand public. Comment l’expliquez-vous ?
Il y a beaucoup de joueurs qui essaient de se projeter, de devenir des superstars, mais ce sont les gens qui décident pour vous. S’ils ne veulent pas faire de vous une superstar, cela n’arrivera jamais. Vous savez, je jouais au rugby parce que j’aimais ça et je pense que les gens l’ont compris, que ce soit avec les All Blacks, Auckland ou Wellington. Je ne sais pas si les jeunes de nos jours jouent pour la passion ou pour la paye. Quand tu vois la passion que les joueurs avaient, comme Serge Blanco après son essai contre l’Australie en 1987, c’était juste de l’émotion à l’état pur. Ces gars avaient cet amour du maillot qu’ils portaient alors qu’ils étaient encore amateurs. Je crois que j’ai eu la chance d’être amateur pendant deux ans puis professionnel pendant le reste de ma carrière. Les jeunes de maintenant n’auront jamais cette chance. Ils ne sauront jamais ce que c’est de jouer juste par passion. À présent, ils ne pensent plus qu’à leur contrat, leur prochain club et tout le reste. Je n’ai rien contre, mais les priorités sont différentes de celles de l’époque.
L’argent serait-il en train de changer la nature profonde du rugby ?
C’est l’évolution logique de ce jeu. Mais cela pourrait être préjudiciable pour certains pays en matière de développement. Quand vous avez un tel afflux d’étrangers dans un pays, vous ne donnez pas leur chance aux joueurs locaux qui vont se retrouver barrés par des internationaux néo-zélandais ou australiens. C’est une histoire compliquée. Il y a des joueurs fantastiques en France, par exemple, mais l’afflux d’étrangers n’aide pas votre rugby. C’est bien pour les clubs et c’est ce que veulent leurs propriétaires, mais la sélection ne dispose plus de ce terreau propice à l’éclosion d’un grand nombre de jeunes. On devrait vraiment trouver une solution pour réguler cela.
Les Français estiment ne pas avoir de grands joueurs au niveau international, d’ailleurs…
Thierry Dusautoir reste un grand leader. Et ce n’est pas le seul. Mince, quel est son nom ? Un demi d’ouverture… Il a été blessé très tôt pendant la finale en 2011. Je l’aime bien. Mince! Il a été blessé parce qu’il avait plaqué Ma’a Nonu et il s’est assommé.
Morgan Parra ?
Ouais, c’est lui!Très bon buteur. S’il ne s’était pas blessé, je pense que vous auriez été en mesure de mieux jouer au pied et de gagner le match. J’essaye toujours de m’intéresser au rugby des autres pays. Là, il y a des Samoans qui sont en train de percer mais aussi des Fidjiens. Beaucoup de jeunes sont en train d’éclore, des joueurs très excitants.
Est-ce qu’une de ces équipes peut rêver d’une victoire en Coupe du monde un jour ?
C’est tout à fait possible. Beaucoup de Fidjiens, Tongiens ou Samoans viennent en France. C’est bien pour eux, c’est aussi ce que les clubs veulent et cela profite à ces sélections. Ils sont de plus en plus forts grâce à leur expérience du très haut niveau en Top 14 ou en Coupe d’Europe. Mais encore une fois, je pense que cela contribue à ce que le réservoir des jeunes joueurs français s’amenuise, puisqu’ils disposent de moins de temps de jeu.
À la fin du match en 1999, je suis resté pour serrer la main à chaque joueur, les féliciter et leur souhaiter bonne chance pour la finale, parce que les Français avaient livré une performance digne d’une finale
En parlant des Français, vous avez réussi à comprendre cette défaite incroyable de 1999 ?
Avant la demi-finale, la question était de savoir de combien de points vous alliez gagner. C’était quasiment un match où chaque équipe a eu sa mi-temps. Si vous regardez bien, je pense qu’il y a quelque chose comme 18 ou 20 minutes avant même que je touche le ballon en seconde période. Quelle frustration! Nous avons dévié du plan de jeu et les Français ont trouvé un second souffle. C’était l’une de ces fois où rien ne fonctionnait pour nous alors que tout souriait aux Français. Leurs coups de pied atterrissaient où ils voulaient, le ballon rebondissait exactement comme ils en avaient besoin… Mais c’est typique des Français. Quand ils décident d’appuyer sur le bouton, c’est une équipe magique à regarder. J’ai une très grande admiration pour leur style. À la fin du match, je suis resté pour serrer la main de chaque joueur, les féliciter et leur souhaiter bonne chance pour la finale, parce que les Français avaient livré une performance digne d’une finale.
Il n’empêche que le retour en Nouvelle-Zélande a dû être difficile…
Je suis très vite passé à autre chose. Je m’occupais de ce dont je devais m’occuper. Je me suis préparé pour la saison suivante. J’adore juste jouer au rugby, c’était la chose la plus importante pour moi. Je n’ai jamais considéré le rugby comme un travail.
En 2004, on vous transplante un rein. Après cette opération, vous n’avez plus été le joueur dominant de vos jeunes années. Comment avez-vous vécu cette situation et les critiques qui sont allées avec ?
Pour dire la vérité, ça n’a même pas été un problème. Les choses que j’ai dû vivre afin de pouvoir rester en bonne santé de nouveau, je ne pense pas que quelqu’un d’autre aurait réussi à les supporter. C’était un autre type de bataille, de domination. C’était une domination mentale dont j’avais besoin. Je devais être fort mentalement pour être en mesure de dominer les grands démons que représentent la maladie et une greffe de rein. Un jeu différent. Pas seulement un match de rugby, mais un match sur la vie. Je devais juste me préparer mentalement et physiquement pour être en forme et continuer à vivre.
Et maintenant, comment vous sentez-vous avec votre traitement, qui reste très lourd ?
Ça va bien. Aussi bien que je puisse l’être. Je suis toujours en attente d’une greffe de rein, je fais encore des dialyses mais je suis heureux dans mon mariage et j’ai deux enfants que j’aime à en mourir. Qu’est-ce que je peux demander de plus ?
Dans le documentaire Le Souffle de la colère, vous expliquez que vous aviez 0,001% de chance d’avoir des enfants à cause de tous vos traitements. Devenir père tient du miracle pour vous ?
À cause de l’un des traitements que je devais suivre, si je voulais avoir des enfants, je devais stocker mon sperme. C’est ce qu’on m’a expliqué à l’époque. Et j’avais effectivement 0,001% de chance d’avoir des enfants à cause de mon nombre de spermatozoïdes selon les statistiques des médecins. J’étais dévasté quand j’ai appris la nouvelle. C’était un sujet dont je devais parler avec ma femme : si elle voulait des enfants, je n’étais pas vraiment la bonne personne… Heureusement, elle pensait le contraire. Nous avons eu Brayley en 2009 et Dhyreille en 2010. Notre plus jeune est né en France, à Marseille. Je suis très heureux. La vie est vraiment bonne avec moi.
Quel souvenir gardez-vous de votre passage à Marseille ? C’était assez improbable pour vous d’évoluer dans un club amateur en Fédérale sur des petits terrains.
Les gens et la ville étaient fantastiques, ainsi que la nourriture. Mais le club n’était tout simplement pas honnête avec moi. Ce n’était même pas à propos des structures ou du niveau. Ils n’ont seulement pas été honnêtes dès le début sur beaucoup de choses, en matière de sécurité pour ma famille notamment. Je ne veux pas en dire plus… Mais avec ma femme, on se dit que si on en avait l’occasion, on retournerait en France demain. Parce que nous avons toujours aimé ce pays. Notre plus jeune fils a 5 ans et continue de nous dire : « Je veux retourner à Marseille. » Il est né là-bas, alors c’est notre petit Français. Il y a beaucoup d’influence française en lui. Par exemple, il aime vraiment le fromage. Je n’ai jamais vu un Tongien qui aimait autant le fromage.
Dernièrement, vous étiez à Salt Lake City. Une ville importante pour vous puisque vous êtes mormon. Vous racontez avoir perdu la foi avant de découvrir cette religion.
C’est une très longue histoire mais la version courte est que ma femme est membre de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et que je me suis converti. Mais il y a aussi des membres dans ma famille. Je n’ai jamais perdu la foi, je la cherchais juste. J’ai toujours récité des prières avant le match. La religion a toujours occupé une grande place dans ma carrière. C’est jusque que je ne m’étais jamais vraiment engagé dans une seule foi. Je crois en ce que je crois, mais je ne cherche pas à dire à qui ce soit ce qu’il doit faire, ce qui est juste ou pas. C’est un choix très personnel.
Après votre carrière de joueur, vous vous êtes essayé au culturisme. C’était une façon pour vous de combler le vide laissé par le rugby ?
J’ai fait un tas de choses. Du culturisme, de la boxe aussi. C’était juste une question de plaisir, une façon de profiter de la vie. Simplement m’amuser. Mon pote, la vie est trop courte pour être trop sérieux et se laisser retenir par les « vous ne devriez pas être ci ou vous ne devriez pas être ça » . Je me suis juste amusé. Pour moi, c’est le plus important. Prendre du plaisir et profiter de mes deux fils.
L’actuel sélectionneur de la Nouvelle-Zélande, Steve Hansen, estime qu’on n’a jamais pu voir le vrai Lomu à cause de vos problèmes de santé. Et vous, avec le recul, comment jugez-vous votre carrière ?
Je suis définitivement fier. Aussi courte que fut ma carrière, j’en chéris tous les moments. Je suis vraiment heureux d’avoir participé à 63 test matchs. Je ne voudrais rien changer, pas même les défaites. Tout simplement parce que cela m’a fait moi, ça a fait de moi une meilleure personne, mais ça m’a aussi appris beaucoup de choses très utiles sur la vie. Je pense aussi aux grands amis que je me suis faits à travers le monde : Émile Ntamack, Brian O’Driscoll et Ronan O’Gara, Jonny Wilkinson… Ces gars-là, je peux les appeler mes amis. Je me suis aussi fait des amis dans la génération précédente, comme Serge Blanco. C’était l’un de mes héros, je l’admirais en tant que joueur. Philippe Sella aussi, Philippe Saint-André… Je suis très chanceux d’avoir frayé avec ces gars-là, de jouer avec mes pairs, comme Michael Jones, Ian Jones ou Andrew Mehrtens, de jouer dans une grande équipe de All Blacks. Je ne changerais rien.
Comme pour toutes les éditions précédentes, les Néo-Zélandais débarquent dans cette Coupe du monde 2015 comme les grands favoris…
On a l’habitude. On a commencé beaucoup de tournois en tant que favoris et on n’a jamais gagné à l’extérieur (les Blacks ont remporté la Coupe du monde 1987 et 2011 devant leur public, ndlr). Je n’aime pas être le favori. Passons déjà la phase de poules et après, j’espère que ce sera un replay entre la Nouvelle-Zélande et la France. Sauf que cette fois, les All Blacks vont gagner, je suppose (rires). En 2011, une équipe de télévision française est venue m’interviewer chez moi. J’ai annoncé une finale avec une victoire d’un point des All Blacks contre la France. Et je crois que j’ai eu raison. Après le match, les journalistes sont venus vers moi en courant et m’ont demandé : « Mais comment est-ce que tu savais ? » Comme on jouait à la maison, je savais qu’il y aurait la même finale qu’en 1987, dans le même stade.
Vous avez conscience que Jonah Lomu Rugby est un jeu vidéo culte pour toute une génération ?
Ah oui, bien sûr. C’est drôle parce qu’il est toujours numéro un Mondial des ventes de jeux vidéo de rugby. Et j’en suis l’heureux et fier propriétaire. Il a cartonné parce qu’il était vraiment facile à jouer. Tout le monde pouvait s’amuser avec. Vous pouviez même jouer avec votre petite amie. Et puis les commentaires étaient drôles. C’était un succès à l’époque et je trouve qu’il se défend encore.
PSG : rêvons dans l’ordre