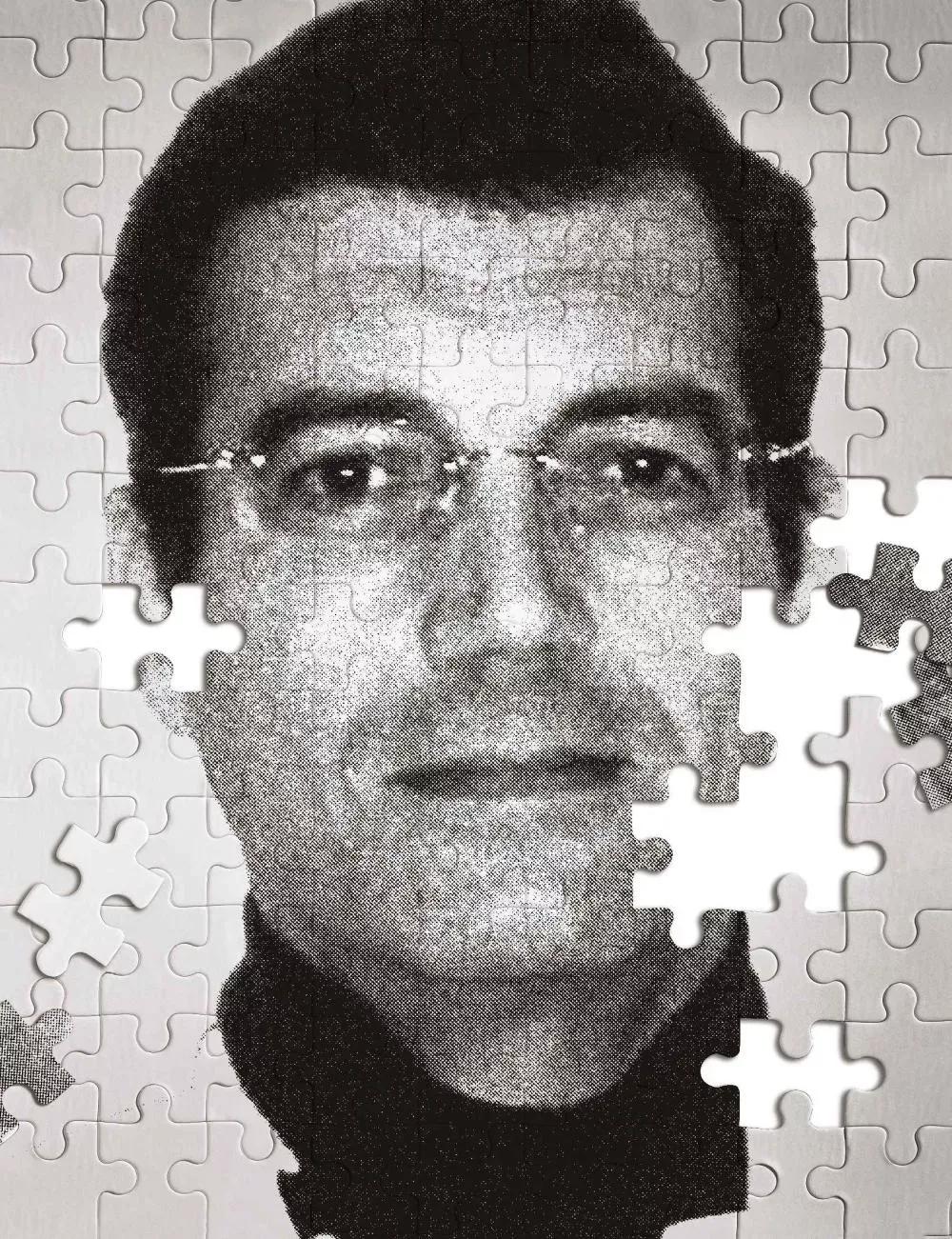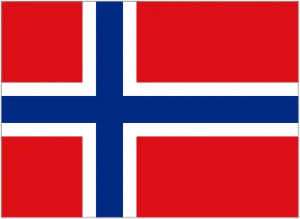Bonjour Joël. En ce moment, plusieurs entraîneurs au chômage se retrouvent au siège de la FFF, boulevard de Grenelle, pour participer au programme « dix mois vers l’emploi » …
Oui, même si c’est un vœu pieu, c’est la mission de l’UNECATEF que d’essayer de procurer un job à tous les entraîneurs. Il y a douze ans, on a décidé de créer ce programme pour accompagner des garçons qui se retrouvent au sol. Entraîner, c’est un métier prenant où on est confrontés tous les jours aux joueurs, aux dirigeants, aux supporters et aux adversaires. Et puis, du jour au lendemain, on se retrouve seul, dans l’ombre. Quel que soit le niveau, la solitude, c’est extrêmement difficile à vivre. Professionnel ou amateur, le ressenti est le même. Les garçons ont besoin d’accompagnement.
Comment vous les aidez ?
On propose une formation continue de dix sessions d’une semaine réparties sur dix mois, axée sur les nouvelles priorités du métier, pas forcément acquises auparavant. Comme l’anglais par exemple, qui est devenu indispensable si on veut travailler à l’étranger. On enseigne aussi la vidéo, la gestion des réseaux sociaux, on apprend à certains comment faire un power point… Cette année, le premier rassemblement a eu lieu à Autrans, près de Grenoble. Les gars étaient en altitude, ils ont fait de la spéléologie, de l’alpinisme. C’est comme un stage de début de saison avec une équipe, on sort du contexte habituel afin d’apprendre à se connaître. C’est important, car il y a de vraies différences d’âge et d’expérience entre les participants. Mais bon, tout se passe bien. Il n’y a qu’à voir cette année : Jean-Luc Vasseur et Philippe Hinschberger, qui sont des entraîneurs reconnus, vivent dans le groupe sans prétention. Ils ont encore l’esprit amateur, cette humilité, l’envie de partager avec les autres…
En matière d’enseignement, à quel point pouvez-vous répondre à la fois aux exigences du monde amateur et du monde professionnel ?
Les logiques à l’œuvre restent les mêmes, qu’on soit en CFA ou en Ligue 1. Chacun d’entre eux va se retrouver face à un président qui cherche un entraîneur, et il faut essayer de le convaincre qu’on est le meilleur choix par rapport à la concurrence. Donc c’est une question de confiance, de sérénité, d’ambition et puis surtout il s’agit de savoir présenter son projet de manière convaincante.
Le problème reste le même pour tous, il y a énormément de demandes et peu d’offres…
Ce n’est pas tant qu’il y a peu d’offres. C’est juste que la demande explose. Aujourd’hui, le nombre d’entraîneurs diplômés augmente tous les ans, alors que le nombre de clubs professionnels, lui, n’augmente pas (sourire). Quant au monde amateur, les difficultés économiques sont réelles. Les stades ne sont plus remplis comme il y a quarante ans, les communautés d’agglomération ne peuvent plus aider de la même façon, donc forcément tout le monde souffre. Le marché de l’emploi est moins ouvert aujourd’hui, il y a moins de possibilités. Pour s’en sortir, il faut se tourner vers l’étranger.
À part sur le continent africain, les entraîneurs français s’exportent peu…
Tout est relatif. On a quand même à l’heure actuelle plus de 80 adhérents qui travaillent à l’étranger. Et je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas adhérents. C’est vrai que l’Afrique reste une destination privilégiée, mais il y en a de plus en plus qui vont en Chine par exemple. Le Canada et les État-Unis commencent aussi à s’ouvrir. La preuve, Laurent Guyot vient de trouver une académie aux USA. Après, il faut bien reconnaître que la concurrence internationale est rude.
Combien d’entraîneurs sont actuellement au chômage ?
L’année dernière, sur près de 800 adhérents, issus de tous les niveaux et de tous les pays, on en comptait entre 150 et 160.
Quels sont vos résultats en matière de reconversion ?
Dans cette promo, sur les 20 sélectionnés, il y en a déjà deux qui ont retrouvé un emploi. Sur les cinq dernières années, niveau pourcentage, on est plutôt aux alentours de 30%. Si on arrivait 50%, on sauterait de joie.
Un sur trois, cela reste pas mal quand même, vu le contexte…
Quand on veut entraîner, il faut accepter de n’avoir aucune certitude. Il y a pas de numerus clausus, personne ou presque n’a de boulot à plein temps. Si quelqu’un s’engage dans ce métier, il ne peut pas dire qu’il ne savait pas, il doit accepter les conséquences. Certains réussissent bien, d’autres moins bien. Nous, on essaie de remettre les chômeurs en état, on leur redonne le moral et on les accompagne dans leur quête d’un nouveau défi. Cependant, en cas de chômage prolongé, il est de notre devoir d’envisager parfois autre chose que le métier d’entraîneur. On peut tenter de les orienter vers des métiers périphériques, comme recruteur, ou préparateur vidéo, etc. Il y a deux ans, un des participants a ouvert une salle de fitness ! Mais cela dépend aussi des compétences et des volontés.
Personnellement, pendant votre carrière d’entraîneur, quel a été le plus gros moment de doute ?
C’est quand je suis passé d’entraîneur du centre de formation du FC Metz à entraîneur de l’équipe première. Comme tout le monde en cas de promotion, je me suis interrogé : est-ce que j’en ai les capacités ? Est-ce que j’en ai les moyens ? J’arrive à la tête du FC Metz au mois de décembre. Pour mes trois premiers matchs, on gagne deux fois et on fait un nul. Pas mal. Premier match de la reprise, en janvier, à Mulhouse, on joue à 15h. On finit sur un match nul, un but partout. À un moment donné, je passe dans le vestiaire, près des douches. Il y avait sept ou huit joueurs dans le bain à remous, et je les entend râler : « On a beaucoup trop travaillé cette semaine, ça ne m’étonne pas qu’on soit cuits. » Moi, je débutais dans le métier, j’entends déjà des critiques. Je rentre chez moi, et je me demande : qu’est-ce que je vais faire cette semaine ? Est-ce que je me suis trompé dans la préparation ? Ces joueurs, ils ont quand même un autre vécu que moi, ils étaient dans le foot depuis longtemps. Tout le week-end, je me suis demandé si je devais changer mon programme d’entraînement.
Et alors, qu’avez-vous décidé ?
Je suis revenu le mardi à l’entraînement, et j’ai demandé exactement la même chose en matière d’intensité physique. Je n’ai presque rien changé aux exercices. Derrière, on va à Nantes et on gagne. Après le match, les mêmes mecs qui m’avaient critiqué viennent me voir et me disent : « Putain, coach, on était vraiment bien physiquement. C’était super, on s’est bien entraînés cette semaine. » Et c’est à ce moment que je me suis rendu compte de toute la difficulté du métier. À partir du moment où le doute s’insinue dans ta tête, par rapport à ce que tu peux entendre autour de toi, venant des supporters, des joueurs ou des dirigeants, c’est très difficile. Si tu commences à écouter les autres, tu n’as plus d’idées directrices. Moi, cela m’est heureusement arrivé très tôt dans ma carrière. Après, je ne me suis plus jamais demandé si je devais changer, ou seulement à la marge.
D’où vous est venue la confiance nécessaire pour rester fidèle à vos convictions ?
Quand j’étais encore coach au centre de formation, je suis allé passer une dizaine de jours en stage à l’Inter Milan et au Benfica. À l’époque, l’entraîneur de l’Inter, c’était Trapattoni. Extraordinaire. Il m’a accordé deux fois une heure et demie d’entretien. J’ai plus appris en trois heures avec lui qu’en beaucoup de stages de formation que j’avais fait avant (rires). J’étais au quotidien avec lui sur le terrain. Il m’a appris à avoir confiance en moi, et à avoir une forme de certitude dans le travail que je pouvais exiger.
Concrètement, qu’est ce qu’il vous a enseigné ?
Il m’a expliqué que quel que soit l’âge ou le niveau de notoriété des joueurs, il ne fallait faire aucune différence au niveau des exercices. S’il fallait faire 50 passes de l’intérieur du pied, il fallait le faire. Quand tu vois Matthaus et Klinsmann accepter de se faire des passes de l’intérieur du pied pendant dix minutes, pied droit, pied gauche, contrôle, tu comprends tout. Ces mecs-là, ce sont des stars, et ils acceptent de bosser sans relâche sur des trucs basiques. Moi, à l’époque, si j’avais demandé ça à mes joueurs, au bout de trois minutes ils m’auraient dit que c’était un truc de centre de formation, que ça les faisait chier… Pareil du point de vue des mises en place tactiques : les coachs italiens, ils travaillent et font circuler le ballon pendant 30 minutes, et si c’est pas bien, on recommence. Faire ça en France, c’est compliqué. Grâce à ce stage, j’ai acquis des convictions quant au travail que je demandais. Si un mec ne voulais pas faire l’exercice, après avoir vu ça, je pouvais lui rentrer dedans. Mais au final, je n’ai jamais eu de problèmes, j’utilisais d’autre moyens pour leur faire comprendre que c’était dans leur intérêt.
Vous trouvez que la mentalité des joueurs français est nulle ? Pourtant ils s’exportent assez bien…
Ce n’est pas ça. Je ne critique pas la mentalité du joueur français. Personnellement, j’ai pu travailler comme je voulais avec mes joueurs. Mais si je n’avais pas eu l’entretien avec Trapattoni, j’aurai pu craquer sous la pression et renoncer à mes principes. Ce que m’a apporté Trapattoni, c’est la certitude quant à la validité de certains exercices. Après, même dans le doute, j’ai toujours fait confiance à ces piliers, avec mes qualités et mes défauts.
Ah, quelles étaient ces qualités et ces défauts ?
Je ne sais pas. Demandez à Philippe (Hinschberger, ndlr) qui est juste là (rires).
Avec le recul, cela ne vous manque pas trop, Metz ?
Il y a un âge pour tout. Et puis, les présidents ne veulent plus trop m’avoir comme coach. Aujourd’hui, 70% des dirigeants ne veulent pas s’emmerder avec un syndicaliste. Ils se disent que je vais venir les faire chier toutes les semaines pour un oui ou un non. Ils ont peur aussi que je ne passe pas tout mon temps au club à cause de mes engagements. Donc je me suis fermé pas mal de portes. Après, il y a des présidents qui sont prêts à faire la part des choses. Quand j’étais coach à Lens et à Metz, j’étais déjà président de l’UNECATEF, mais je venais seulement une fois de temps en temps, tous les huit jours. Là, après les élections de 2012, on m’a demandé de m’engager à temps plein. J’ai donc mis un terme à ma carrière, j’ai quitté l’encadrement technique du FC Metz. Maintenant, je vais avoir 64 ans. À un moment donné il faut savoir tourner la page. Et pas seulement en tant qu’entraîneur, mais aussi en tant que président du syndicat. Il y a les élections l’année prochaine, je vais me poser la question de savoir si je continue.
En treize ans de présidence, qu’est-ce qui vous a rendu le plus fier ?
(Il réfléchit) La fierté, c’est tout simple. C’est juste quand quelqu’un passe un coup de téléphone en disant : « Je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi. » Quand un entraîneur est seul, se fait licencier, ou est massacré dans la presse, je l’appelle. Comment je peux t’aider ? Le but, c’est de le rassurer, de lui faire sentir qu’il y a de la solidarité. Sans mentir, neuf fois sur dix, on arrive à régler plus ou moins vite la situation, et ils nous remercient pour le coup de main.
C’est gratifiant…
Oui. Bon, c’est tout à fait déplacé, mais c’est un peu comme le médecin en qui on a confiance et qui à un moment donné trouve le bon diagnostic. On a un problème et, dix jours plus tard, on est guéri. Les gens qui sont au comité aujourd’hui, on a tous cet état d’esprit-là. On passe des heures à montrer qu’on existe, qu’on veut aider, qu’on a des idées, qu’on veut se faire respecter.
Comment vous est venue cette vocation de syndicaliste ?
Quand je suis devenu joueur, j’ai très vite adhéré à l’UNFP. J’y suis resté douze ans, j’ai même fini vice-président. Cela a commencé comme ça. En devenant entraîneur au centre de formation de Metz, j’ai ensuite adhéré à l’UNECATEF. Je me suis retrouvé quelques années dans le comité directeur, avant d’être élu président en 2001, quand Guy Roux s’est arrêté. À l’époque, on avait 80 membres, uniquement des professionnels. En 2001, le comité a décidé d’inclure tous les gens dont l’activité principale est le football, que le gars gagne 1500 euros en DH ou qu’il en gagne 100 000 en première division. L’échelle n’est plus la même, c’est devenu plus difficile d’accompagner et de protéger.
C’est quoi pour vous le syndicalisme ?
Pour moi, c’est d’abord essayer d’être responsable. Il ne s’agit pas de faire du syndicalisme primaire, où on est contre tout à tout moment. Il ne suffit pas de critiquer et de ne jamais prendre d’engagements. Moi, je m’engage. C’est une question de nature et de tempérament. J’ai toujours voulu exprimer mes idées. Et puis, je pense que j’ai aussi un besoin évident de relations humaines. Ma carrière, je l’ai basée sur les relations humaines. J’étais pas du genre à dire : « Voilà, c’est comme ça, donc tu fais ça, tu fais ça et tu fais ça. » Parfois, j’étais obligé, mais j’essayais toujours d’avoir l’adhésion de mes joueurs. Il y a une forme d’envie de rendre service aux autres tout en se rendant service à soi. Je crois que ma priorité, ça a toujours été de participer, en tant que joueur et entraîneur, à l’évolution du métier.
Justement, qu’est-ce qui a fondamentalement changé dans le métier de coach ces dernières années ?
Ce qui a beaucoup changé, c’est la relation aux autres. La communication, avec les médias et le public, a pris une dimension énorme. Avant, on n’avait pas besoin de prendre des cours d’expression et de langage. Maintenant, chaque fois qu’on prend la parole, tout ce qu’on dit va être augmenté, amplifié, dénaturé. Donc l’entraîneur, il doit non seulement posséder la compétence du métier en plus de trouver les mots justes.
Il y a un entraîneur que vous trouvez bon dans ce domaine ?
Je trouve que la communication d’un type comme Rolland Courbis est judicieuse. Très subtile. Même englué dans des situations difficiles, il arrive toujours à trouver les mots justes pour répondre aux questions. Son vocabulaire fait de chaleur et de réserve lui permet de communiquer sans faire la gueule, mais sans rigoler non plus. Il est toujours très adroit, tout en étant irréprochable par rapport à ses dirigeants. Il est très habile.
Vous trouvez le métier plus difficile qu’avant ?
Oui. Le deuxième élément qui a énormément changé, c’est le comportement des joueurs. Des joueurs qui font leur formation au club, qui s’y sentent bien, et qui ont envie de vivre un certain nombre de choses sous ces mêmes couleurs, ça n’existe presque plus. Aujourd’hui, les jeunes footballeurs pensent d’abord en priorité à améliorer leur ordinaire, parfois sous la pression des agents. Pour eux, la reconnaissance, c’est de partir vite et de signer un beau contrat dans un autre club, pour se sentir considérés. Ils ne s’installent plus dans une progression naturelle : ils veulent tout tout de suite. Et comme maintenant, les groupes sont composés de 30 joueurs, contre 18 par exemple de mon temps, cela multiplie les difficultés… car ceux qui ne jouent pas, on le sait, ont toujours quelque chose à dire.
Les clubs ne sont pas non plus exempts de tout reproche dans ce phénomène…
Tout à fait. Plus que jamais, la priorité des clubs, c’est d’équilibrer leur budget en fin de saison. Pour ça, très souvent, il faut transférer. Parfois même, on met sur le marché des joueurs qui n’ont pas envie de partir. Par exemple, Lyon l’a fait avec Gomis l’année dernière. On a donc un double phénomène : d’une part, les joueurs ont du mal à s’installer dans la durée, et d’autre part, les clubs sont de plus en plus obligés de vendre pour faire des plus-values. Du coup, les entraîneurs ne peuvent plus travailler dans le temps, ils sont toujours dans la gestion de l’immédiat. Forcément, cela rend leur métier beaucoup plus délicat.
Le Barça et le Real reculent sur l’interdiction du port de maillots adverses