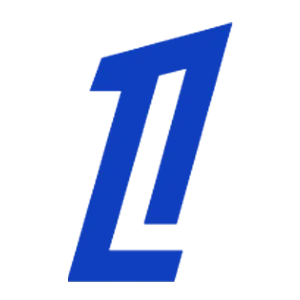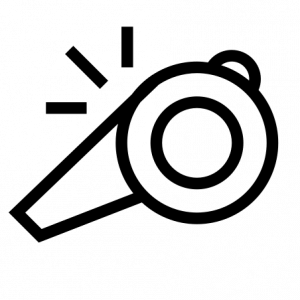- Ligue 1
- J28
- AS Monaco-FC Nantes
Jean-Luc Ettori : « Je me disais, surtout ne baisse pas les yeux »

Solide comme le Rocher. Jean-Luc Ettori a disputé 602 matchs de match de championnat avec l’AS Monaco, le seul et unique club de sa carrière. Il a remporté trois championnats et autant de Coupes de France. Copropriétaire de plusieurs établissements avec ses neveux à Tours, l’ancien gardien revient sur ses challenges et difficultés passés et évoque quelques spécificités de Monaco, un club, une ville, un pays, si particuliers.
Jean-Luc, qu’est-ce qui vous rend heureux en ce moment ?La vie tout simplement, les affaires marchent et Monaco est leader en Ligue 1, donc tout va bien.
À l’époque où vous jouiez à Monaco, vous veniez à La Turbie en 2 CV.Elle existe toujours, elle est chez mes parents en Corse. J’aime bien cette voiture, en plus je prenais le contre-pied de tout ce qu’on pouvait dire sur les footballeurs. C’est une voiture qui montait partout, décapotable. Quand vous êtes au soleil, c’est l’idéal.
Quel était le regard des autres joueurs ?Ça les faisait toujours sourire, mais ils se sont habitués, il n’y avait pas de chambrage particulier et puis j’ai eu d’autres voitures aussi.
Vous aviez la volonté de ne pas vous conformer.C’est un peu le propre des gardiens de but, on a une place un peu à part. Rouler en 2CV, c’était un peu pour l’accentuer.
Le gardien de but se sent-il un peu exclu ?Non, mais il a énormément de responsabilités. C’est l’alibi parfait pour tout le monde. C’est toujours plus facile de dire que c’est le gardien de but qui n’a pas été bon plutôt que l’équipe, mais c’est ce que j’ai toujours dit aux jeunes gardiens qui arrivaient à Monaco : vous serez le meilleur alibi de votre entraîneur et vous allez être jugé par les gens qui ne savent pas ce que c’est. Il n’y a qu’un gardien de but pour comprendre l’émotion, le stress du moment, quels sont les ballons compliqués. Combien de fois je suis sorti du terrain et j’ai entendu : « Tu n’avais rien à faire aujourd’hui » , alors que tu as été décisif sur un ballon merdeux que personne n’a vu. On s’extasie sur un plongeon, et même les gens du milieu du foot le font… C’est pour ça qu’il y a un gros respect entre tous les gardiens de but. On dit qu’il faut être fou pour être gardien de but, mais il faut surtout l’être pour accepter autant de responsabilités.
Vous étiez un gardien bondissant, rapide, nerveux, élu étoile d’or (récompense le joueur le plus performant et régulier de la saison) en 1990. Le style est un peu en fonction de ton physique. Si, à l’époque, il n’y avait pas que des gardiens de grande taille, c’est vrai qu’avec la mienne (1m73), si je n’avais pas eu cette détente, ça aurait quand même été compliqué. Je l’ai développée à l’INF Vichy. J’étais un peu kamikaze, mais je possédais une bonne lecture du jeu. Le foot a pas mal évolué. Mes qualités physiques ont fait que j’ai pu m’adapter. À l’époque, il y avait plus d’espace. C’était plus facile de se déplacer. Les gardiens de but d’un petit gabarit pouvaient exister. Aujourd’hui, on ne les voit plus se promener dans la surface comme on pouvait le faire.
Vous êtes l’homme d’un seul club et on vous a appelé Tonton avant Patrice Évra.Comment vous savez ça ? (Rires) J’ai été capitaine pendant onze ans. C’est quand même une grosse fierté d’être l’homme d’un seul club même si c’est quand même plus facile de jouer à Monaco plutôt qu’à Dunkerque. J’ai eu la chance de jouer dans une équipe qui jouait toujours les premiers rôles. Je n’avais pas de raison d’aller voir ailleurs. J’étais le garant d’un certain état d’esprit. J’ai joué avec trois générations de joueurs, donc j’étais le pont entre elles. Je leur faisais comprendre que porter le maillot de Monaco, c’était différent que de porter celui de Saint-Étienne ou autre. Vous portez les couleurs d’un club, d’une ville et d’un pays aussi. C’est le drapeau de la principauté. Ce sont des responsabilités supplémentaires. J’espère que les générations actuelles et futures garderont ça en tête.
Qu’est-ce qu’un Monégasque ?C’est quelqu’un qui a un attachement profond à la famille princière, à son petit pays. Ça transpire au niveau du club et des joueurs, mais après il faut aussi que le joueur ait la volonté de s’imprégner de ça. Tout le monde n’y arrive pas. J’ai joué avec des générations de joueurs qui l’étaient vraiment. Je ne dirais pas qu’on était en mission, mais presque.
Parlez-moi du prince.Le prince Albert est accro au foot. Il aime son équipe, même si ce n’est plus vraiment la sienne aujourd’hui. Je vais vous raconter une anecdote. C’était en 1991-1992, on rencontrait Marseille en finale de la Coupe de France, on était installés pour prendre le repas de midi avant le match dans notre hôtel parisien. On m’annonce : « Vous avez un appel téléphonique. » Au bout du fil, c’était le prince Rainier. Il m’a demandé comment j’allais, comment l’équipe était. On a parlé trois minutes, pas plus, et juste à la fin de l’appel, il me dit : « Je vivrais mal une défaite contre Marseille. » On a gagné 1-0, but à la 90e minute de Gérald Passi. Je l’avais dit à certains joueurs, ils étaient touchés. Le prince Rainier était beaucoup moins avare de ce genre d’intervention que peut l’être son fils, mais ça résume un peu l’état d’esprit de la Principauté.
En passant votre carrière à Monaco, n’avez-vous pas eu l’impression de passer à côté de certaines grosses ambiances de D1 ?Si, bien sûr. On va dire que c’est le seul manque, mais il y a eu quand même des matchs où c’était plein, mais je dirais que ça fait aussi partie des qualités qu’il faut avoir pour jouer à Monaco. Il ne faut pas chercher dans les tribunes le soutien, mais au fond de son ventre, au fond de son estomac. C’est toujours plus difficile de s’imposer dans une équipe comme Monaco que partout ailleurs. Il n’y a pas cette pression des supporters, mais quand vous allez chez le boulanger, le poissonnier ou chercher des légumes, vous entendez toujours : « Les gars, il faut s’accrocher. » Ça existe quand même. Quand vous jouez et que vous avez 40 000, 50 000 personnes qui vous poussent, c’est toujours plus facile d’aller plus haut, plus vite, plus loin. En Principauté, ce n’est pas ça, il faut aller chercher ça ailleurs : dans le travail toute la semaine, dans nos tripes, dans le collectif, titulaires comme remplaçants.
Quelles différences entre votre Monaco et celui d’aujourd’hui ?On a connu les baraquements à La Turbie. Arsène Wenger fait partie des pionniers à ce niveau-là. Aujourd’hui, le club a beaucoup évolué et c’est normal, s’est beaucoup professionnalisé, même si je crois savoir qu’ils y sont un peu à l’étroit. Au niveau style de jeu, l’équipe d’aujourd’hui me rappelle un peu celle de 88 championne de France avec Arsène Wenger. Un système de jeu similaire, un joueur un peu au-dessus des autres : Silva me rappelle un peu Glen Hoddle. Bon, on ne va pas comparer les foots, mais les deux équipes se ressemblent un peu : deux gros milieux récupérateurs, deux joueurs de côté qui font la différence avec leur style et puis deux attaquants.
Danijel Subašić vous ressemble ?Non, pas du tout, mais c’est un bon gardien. Le style importe peu. Ce sont les résultats qui comptent. Je ne le connais pas, mais on le sent imprégné de l’identité monégasque. Il est content de jouer dans cette équipe, dans ce club, ça me plaît.
Vous avez fumé toute votre carrière, ça ne vous a jamais gêné ?Non. Enfin peut-être que j’aurais été meilleur sans, non je plaisante.
Lors de la Coupe du monde 82, vous êtes propulsé gardien numéro 1 sans avoir disputé le moindre match de qualification. Comment l’avez-vous vécu à l’époque ?C’était une immense joie, une immense fierté, une grosse pression. C’était quand même la Coupe du monde. J’avais tout fait pendant un mois pour que ça se réalise. J’ai bien vu pendant le mois de préparation que j’étais au-dessus des deux autres. J’ai un peu forcé l’entraîneur à s’en rendre compte, mais j’étais loin de penser que Michel Hidalgo allait prendre ce risque. Risque entre guillemets de mettre quelqu’un qui n’avait que très peu joué avec cette équipe. C’est ce qui explique je pense cette Coupe du monde en demi-teinte, mais je n’ai aucun regret.
Vous avez subi de vives critiques de Bernard Pivot, Jean-Michel Larqué et Thierry Roland notamment.Oui, il y a eu des moments assez compliqués, notamment après la Coupe du monde, mais d’une part je n’ai rien volé et puis, j’avais fait le maximum pour être bien. Ma plus grande victoire, c’est que les gens qui m’avaient critiqué pendant la Coupe du monde aient retourné leur veste. Et puis, on ne fait pas 750 matchs pour un club sans avoir un peu de qualité. Une contre-performance peut toujours arriver, mais l’important, c’est la constance. Ce n’est pas en se lamentant lorsqu’on est en bas qu’on peut remonter, ce n’est pas possible. Si vous n’y arrivez pas, c’est qu’il y a peut-être un manque de qualité, mais de passion, d’envie de travailler. C’est toujours le travail qui vous remet sur les bons rails. Tu n’as pas le choix ou alors tu fais un trou et tu t’enterres et tu n’en sors plus, ou alors tu te dis : « Je vais montrer que… » , mais l’environnement joue aussi. J’étais dans un club où on savait de quoi j’étais capable. Ma position en club n’a jamais été ébranlée par tout ce qui pouvait se dire. Ça a été une force aussi. J’ai pu compter sur le soutien des gens de l’AS Monaco. Ça m’a aidé à surmonter tout.
Parfois, ça a quand même été dur.C’est vrai que toutes ces critiques à la télévision ou dans les journaux font que dès que j’allais à l’extérieur, les gens sifflaient, ça m’a fait une carapace aussi. Ça m’a rendu plus fort. Je ne dis pas que ça n’a pas été compliqué, mais ça m’a donné de la force : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi à l’entraînement. Je me disais : surtout ne baisse pas les yeux. Je me suis accroché pour faire mentir tous ces gens. Lorsqu’il y avait ma famille dans les tribunes, c’était compliqué. Ils étaient au milieu des gens, certaines paroles peuvent blesser. Quand on est frère, parents, c’est toujours compliqué. Ma seule angoisse était de savoir comment eux allaient réagir. Moi, je me disais, tout ce qui compte, c’est la performance sur le terrain. Il y a trente millions de personnes qui rêveraient d’être à ma place.
Votre famille a donc déjà été affectée.Oui, dans certains stades, c’était chaud. À Nantes, la sortie du stade avait été compliquée. Il y a quelques stades où c’était marrant, enfin marrant… à un moment donné, tu te dis, trop c’est trop. Je suis rentré dans la foule, en voyant ma tête, je pense qu’ils ont dû avoir peur. Mes coéquipiers sont arrivés, ils m’ont pris, la police aussi, donc ça s’est calmé. Ce n’était pas tous les jours faciles, mais les choses ont évolué. J’ai toujours eu un bon contact avec le public à la maison et à l’extérieur.
De quoi êtes-vous le plus fier ?De mes dix-sept ans au plus haut niveau, plus de 750 matchs officiels avec l’AS Monaco. Malgré tout ce que les gens ont pu dire, j’ai duré à un bon niveau. Et puis je suis fier de mes enfants et de mes petits-enfants.
Un gardien bien connu des pelouses de France prend sa retraitePropos recueillis par Flavien Bories