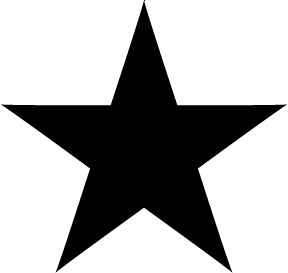- France
- Interview Lilian Laslandes
- Partie 3
« J’ai organisé un apéritif avec les fans niçois pour expliquer mon départ »

Il y a plus de vingt ans, la crinière blonde de Lilian Laslandes débarquait sur le championnat de France. Parfois loin de son Médoc natal, toujours proche des tribunes. Retour en trois actes, d'Auxerre à Bordeaux en passant par Sunderland, sur quinze ans de foot français. Troisième partie, à la découverte de l'homme.
Vous aviez une relation forte avec les tribunes…C’est quelque chose qui vient de loin. Quand j’étais petit, j’allais régulièrement au stade. Et voir la joie des gens sur un but, ça motive. Surtout quand c’est toi qui marque, la joie est double. Elle est même indescriptible. Tu as l’impression d’être un dieu. Un stade entier chante ton nom. La communion, c’est avant tout l’envie de partager avec les gens. J’ai connu des joueurs qui n’allaient jamais applaudir les supporters à la fin. Ils faisaient leur métier et, pour eux, le fait de venir les voir jouer était normal. Moi, quand je marquais et sautais par-dessus le panneau publicitaire au Ray, à Furiani ou à Lescure, c’était pour croiser des regards de personnes qui vibraient comme moi. Un jour, à Bordeaux, face à l’OM, il y a 1-1, je marque à la dernière minute. Là, tu ressens l’hystérie, tu as ça dans les yeux pendant des semaines.
Lorsque vous marquez ce ciseau avec Nice contre Monaco à la dernière minute, est-ce que vous savez que c’est le dernier but ?Non, pas du tout. Je m’attends encore à une année. En revanche, avec ce but-là, j’ai eu l’impression, sur un jour de derby, d’avoir rendu ce que l’on m’avait apporté dans le club et chez les supporters. D’un côté, je me suis dis que j’avais bouclé la boucle. J’ai pensé à un signe du destin. J’ai joué encore quelques matchs dont un dernier contre Caen. La communion avec le public m’a toujours porté.
C’est ce que vous étiez allé chercher en repartant à Bordeaux quelques mois plus tôt ?Oui, j’étais allé voir le président Cohen parce que Michel Pavon m’avait contacté pour revenir. Il venait de reprendre l’équipe et voulait mettre des anciens comme Micoud avec des jeunes autour de nous. Mon ex-femme était enceinte, donc c’était le moment, mais je savais que ça ne serait pas facile. Le président de Nice ne voulait pas au départ. Rohr pareil. Je ne voulais pas entrer dans un conflit, donc je me suis occupé de l’expliquer aux supporters. J’ai organisé un apéritif dînatoire avec environ une centaine de personnes et ça s’est passé naturellement. Ils venaient de me donner leur aval.
Le plus dur pour vous n’est pas de ne pas avoir pu dire au revoir à ces gens lors de votre deuxième passage ?J’aurais aimé faire mes adieux devant mes proches. C’est un regret. Je n’ai jamais su que je jouais mon dernier match. J’avais quand même appelé Antonetti, le président Cohen, pour leur expliquer ma déception. Je m’attendais au moins à un coup de téléphone. Quand j’étais arrivé, j’avais analysé les installations à leur demande, j’avais remis de l’ambiance dans le groupe, apporté mon expérience… J’avais même gratté un brassard de capitaine. J’attendais plus de franchise. J’aurais pu signer deux ans en décembre, mais, sur le moment, j’ai refusé, car je voulais attendre. Ils ne m’ont pas respecté sur ce coup-là. Quelques mois plus tard, ils m’ont appelé pour une demi-finale de Coupe de la Ligue contre Vannes pour venir faire le coup d’envoi. L’idée était de donner au public l’occasion de me dire au revoir et, surtout, de s’expliquer en face. Je suis allé voir le président le soir du match, je n’attendais pas d’excuses, mais une explication entre hommes.
Vous n’avez jamais dépassé ce palier équipe de France. Avez-vous eu l’impression à un moment donné que vous auriez pu taper plus haut ?Je pense qu’à mon époque, il y avait meilleur que moi. Après, à la Coupe du monde 98 où le choix a été fait entre Stéphane Guivarch et moi, tu peux y penser après coup. Quand tu es champion du monde et que l’avant-centre ne marque pas un but… Mais je ne suis pas comme ça. J’étais plus triste qu’autre chose pour Stéphane. Peut-être que ça aurait pu se passer d’une autre façon pour moi, oui, parce que ça aurait pu éventuellement me lancer pour l’Euro. J’ai fait quelques matchs, avec un but en Autriche, un autre en Arménie, mais j’ai compris que Trezeguet et Henry étaient déjà très haut. Trop haut. Et moi, j’étais encore en France. Ces garçons étaient peut-être plus appréciés que d’autres dans le groupe. Moi, je n’étais que de passage. Je me demandais parfois si j’étais à ma place au niveau foot et dans la vie de groupe.
Vous aviez l’impression de dénoter en matière d’état d’esprit par rapport au groupe ?J’avais juste une vision différente. Après, ça s’est toujours bien passé. Mais dans les relations humaines, j’avais l’impression d’être là par défaut. Souvent, à Clairefontaine, après les repas, je montais dans ma chambre avec Jo Micoud ou Wiltord quand il était là. Bixente, Duga, Zizou restaient surtout entre eux.
C’était un autre monde ?Une fois que les mecs ont gagné la Coupe du monde, tu arrives dans un groupe de champions du monde avec tout ce que cela implique. Tu te dis que tu es exclu, que tu n’as pas fait partie de ça et tu sais que tu viens en remplacement de certaines personnes et non parce que tu es meilleur qu’un autre.
Ce n’était pas le cas dans la plupart des clubs où vous êtes passés. Auxerre, Bordeaux, Bastia, Nice… L’état d’esprit collectif était très fort. Quelle importance, ça avait pour vous ?Ce sont surtout les humains que je retiens. Partout où je suis passé, tout le monde tirait dans un sens commun. C’est ce qui faisait le charme du foot d’il y a dix ans.
L’esprit famille ressenti à Auxerre ou Bordeaux, vous pensez que c’est quelque chose qui a disparu en France ?Dans le foot moderne, je ne pense plus que ça existe. À une certaine époque, tu avais Lens et Sochaux. Ou encore le Nantes de la grande époque. C’est terminé. Pour moi, c’est comme dans la vie de tous les jours : le respect a disparu aujourd’hui. Le foot a évolué. Quand on regarde la demi-finale 82 et le foot de mon époque, tu avais déjà une différence. On avait l’impression que les mecs marchaient. Tout se jouait dans les trente derniers mètres, mais le ballon était remonté tranquillement. Pourtant, c’était Platini, Tigana, Giresse. Aujourd’hui, on fait davantage des sportifs que des mecs qui sentent le jeu.
Une affaire Aurier, au-delà de l’aspect réseau social, était quelque chose d’assez impensable…J’y pensais justement. L’autre jour, je redescendais de Paris et quand j’ai appris ça, je me suis dit qu’il ne devait même plus rentrer au Camp des Loges. Prends tes clés de voiture et va-t-en. Le comportement d’Aurier ne peut pas passer dans un club qui se veut un grand club. Si le PSG laisse passer ça, ce sont tous les autres qui vont s’en mordre les doigts. Nous, ce qui se passait dans le vestiaire restait dans le vestiaire. S’il y avait quelque chose à dire, il y avait des leaders de vestiaire pour le faire. Aujourd’hui, je suis sûr qu’il y a des mecs qui viennent dans le vestiaire, qui pointent, et s’en tapent des autres. À notre époque, les mecs de la sécurité qui nous entouraient en permanence, on les emmenait quand on faisait des visites de château. C’était une récompense et ça nous faisait plaisir. Aujourd’hui, certains ne leur disent même plus bonjour.
Vous le voyez aussi dans votre travail auprès des nouvelles générations ?En fait, j’ai l’impression que les joueurs pensent que tout est déjà arrivé. Surtout les jeunes. Quand Michel Pavon a eu son problème cardiaque au moment où il était entraîneur des Girondins, j’étais sur la route. J’ai entendu ça à la radio, je me suis arrêté et j’ai de suite appelé le président pour lui proposer mon aide pour l’entraînement ou n’importe quoi. Bénévolement, hein. Et je me suis alors aperçu que des garçons de vingt ans comme Anthony Modeste et Cheikh Diabaté, du même groupe, ne voulaient pas jouer ensemble. Oh, devant un stade de 35 000 personnes, en Ligue 1 ! Ils disaient qu’ils n’étaient pas compatibles. Pour un match contre le PSG ? Mais on est où, là ? On a donc été obligés d’en mettre un sur la pelouse et un sur le banc, alors qu’on devait jouer à deux attaquants. Mais ils avaient prouvé quoi, eux, pour exiger ça ? Selon moi, pour être reconnu, c’est minimum dix buts par saison qu’il faut mettre. Je pense que les premiers contrats sont trop élevés, ça peut faire tourner la tête. Ils vont en équipe de France, ils discutent avec leurs potes qui jouent en Angleterre et se la racontent avec leurs gros salaires.
Est-ce que vous avez l’impression que le football est devenu davantage un travail qu’un plaisir ?Il y a de ça, oui. Pas pour tout le monde, hein. Mais aujourd’hui, le respect envers le président, le coach, les valeurs d’un club, est trop souvent bafoué. Comme dans la vie de tous les jours, en fait. Les jeunes sont ailleurs, ils peuvent laisser une grand-mère tomber par terre sans l’aider. Nous, notre plaisir, c’était jouer au foot dans la rue, eux c’est jouer au foot à la Playstation. Ils veulent reproduire une roulette, un beau geste, plutôt qu’être efficace.
Vous n’avez pas la langue dans la poche. D’où ça vient ?De ma famille. C’est comme ça qu’on se dit les choses. C’est une famille d’origine italienne, un peu de rugby aussi, donc on a toujours avancé comme ça, sans arrière-pensées.
Vous voulez faire quoi, maintenant ?Transmettre ma connaissance aux attaquants. Pourquoi, au rugby, tu as des coachs spécifiques pour chaque poste, et pas au foot ? Au foot, tu as des entraîneurs pour les gardiens. Alors oui, un gardien peut te sauver un match, mais un attaquant aussi a beaucoup d’influence sur un match. Moi, quand je suis arrivé à Auxerre et que je marquais des buts, Guy Roux m’a dit que je ne savais pas où je mettais la balle quand je frappais. Il m’a fait travailler mes têtes, que je devais mettre entre le poteau et un piquet. Tant que je n’avais pas atteint la perfection, je ne quittais pas l’entraînement. Il m’a appris à placer le cuir où je voulais.
Comment arrive-t-on à dissiper un doute dans la tête quand on est buteur ?Il ne faut pas se dire à tout prix qu’il faut marquer. L’important, c’est le travail dans le jeu, que tes partenaires sentent que tu es avec eux et non dans l’obsession du but.
Un attaquant ne serait pas égoïste, alors ?Certains peuvent se le permettre. Comme Pauleta par exemple. Quand je jouais avec lui, j’ai compris que j’allais me mettre à son service et il m’a toujours remercié pour ça. Moi, je prenais les miettes et le servais parce qu’il nous faisait gagner les matchs. Ce n’était pas une star et c’était la clé. Il aimantait le ballon.
Propos recueillis par Maxime Brigand et Florian Cadu