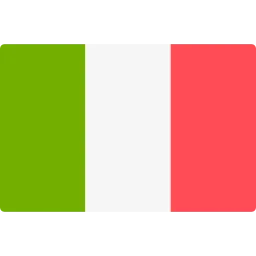- Média
- Interview de Jacques Vendroux
Jacques Vendroux : « Je n’ai jamais dit qu’un joueur était un con »

« Ce métier est le plus beau du monde, il faut le faire très sérieusement, sans se prendre au sérieux. » À 70 ans, Jacques Vendroux passe sur les ondes depuis cinquante-deux ans. Mais courant 2018, le petit neveu par alliance du général de Gaulle et légendaire gardien du Variété Club de France coupera le micro. L’occasion de revenir sur son parcours, ses amitiés, ses souvenirs et sa vision du journalisme.
Débutons par une citation : « J’ai besoin qu’on m’aime pour aimer encore plus. »
Ça a toujours été mon moteur. Plus j’ai été aimé, plus on m’a encouragé, plus j’ai eu envie de donner, me surpasser, chercher à faire encore plus plaisir. J’irai jusqu’au bout de mon rêve, je ne lâcherai rien, même si je prends ma retraite courant 2018. Aimer est la chose la plus agréable au monde. Ce n’est pas forcément la normalité dans ce métier.
Le « rêve » , un mot que vous employez beaucoup.Je voulais devenir commentateur sportif ou le meilleur gardien de but du monde. Tous les dimanches après-midi quand j’étais gamin, j’allais voir la BBC chez mon grand-père, député-maire de Calais, où j’habitais. C’était le seul qui avait la télévision. Il y avait une émission, Match of the Day, que je regardais avec mon père et lui. J’avais 12 ans et voulais être Gordon Banks.
Quand j’étais gardien de but du Racing Club de Calais, je m’habillais comme lui : bas blanc, short blanc et maillot jaune. Mais je n’ai pas pu réaliser ce rêve et mon père s’est rendu compte que j’avais des problèmes avec les études. J’étais dans la même classe que ma sœur qui avait trois ans de moins que moi. Nous étions en mars, avril 1966. Il n’existait qu’une chaîne de télévision et qu’une seule station de radio : France Inter. Mon père, chef de cabinet de Maurice Herzog, le ministre des Sports de De Gaulle, a donné un coup de téléphone à Raymond Marcillac, patron des sports à la télévision : « Mon fils est un branleur, peux-tu l’aider ? » J’ai été engagé en quinze minutes. Je dois tout à mon père et à Thierry Roland qui m’a beaucoup aidé. Évidemment, les mauvaises langues diront que je suis un pistonné. Je le suis et je l’assume. J’emmerde tout le monde. J’ai pu l’être pendant une année, mais pas durant cinquante-deux ans !
Pourquoi les footballeurs, toutes générations confondues, vous apprécient tant ?Parce que je n’ai jamais dit qu’un joueur était un con. Je ne leur ai jamais manqué de respect. Ils savaient qu’ils pouvaient compter sur moi parce que quelque part, je rêvais d’être eux. J’essayais de les comprendre. J’étais l’ami, le copain fidèle de toutes les générations. Je suis très proche de Platini, tout le monde le sait.
Déontologiquement, qu’est-ce qu’un bon journaliste sportif ?C’est très complexe. On a tous des préférences, on manque tous un peu d’objectivité. Après, c’est une question de courage. J’ai toujours dit que j’aimais l’équipe de France, que j’étais derrière elle. J’assume mes amitiés d’avant et d’après. Un bon journaliste ne doit pas raconter n’importe quoi. J’ai beaucoup de défauts, mais tout ce que j’ai raconté, je l’ai vu. On va me reprocher mes amitiés… Oui, j’étais très ami avec Tapie, Bez, Platini… j’ai une proximité avec un certain nombre de joueurs de 1958, 1984 et 1998. Mais même si Didier Deschamps est le sélectionneur et si l’on est proche, il ne m’a jamais accordé de faveurs incroyables. Beaucoup sont membres du Variété Club de France, donc on se connaît, on s’apprécie. Il y a un mélange entre le Variété et mon métier évidemment. Ce serait lâche et faux cul de ne pas dire la vérité, mais à force de côtoyer des joueurs dans les vestiaires et au cours de voyages, vous obtenez des informations exclusives. Au passage, j’étais le plus mauvais gardien de but avec lequel ils ont joué. Mais j’ai réalisé mon rêve, me suis mis arbitrairement dans les buts de cette équipe. J’ai joué dans les plus grands stades du monde. Devant moi, j’avais quand même Marius Trésor et Maxime Bossis. Ce n’était pas normal ! J’ai eu une vie incroyable.
Comment trouver le juste milieu entre compassion et critique ?Si vous êtes très ami avec quelqu’un que vous devez interviewer, vous lui dites avant : « Je vais te mettre dans l’embarras. » Il le sait, je ne le trahis pas. Il m’est arrivé d’interviewer Platini, Blatter, Valcke, dans des moments un peu compliqués de leur vie. Jamais je n’ai eu un problème de refus, parce que je pose mes questions de manière bienveillante. Je ne vais pas dire à Platini : « tu es un voleur » mais « explique-moi comment ça s’est passé » . Et puis ce qui m’intéresse, c’est d’avoir un grand nom à l’antenne.

Quelle est la plus belle preuve d’amitié de Michel Platini à votre égard ?Il était quasiment toujours là quand j’étais à l’hôpital après l’incident de Furiani.
Six mois plus tard, je voulais absolument rejouer dans les buts du Variété, mais j’avais peur. Il m’a emmené dans un stade pourri dans la forêt de Saint-Cloud avec deux ballons. Je me suis mis dans les buts et il me faisait des tirs. Il m’allumait, me rendait fou. Quand on a terminé, j’étais épuisé, mais je voulais absolument jouer le jubilé de Dominique Bathenay contre les vrais Verts de Saint-Étienne. Il m’a permis de disputer vingt minutes.
C’est votre meilleur ami ?Il fait partie de mes meilleurs amis. C’est le mec sur qui je peux compter. Il a toujours été d’une fidélité exemplaire. On m’a reproché de l’avoir défendu sur des chaînes de télévision ou ici à France Info, mais je l’ai fait parce que je pense qu’il est innocent et puis, on me demandait un avis sur un ami. Michel fait partie de ma famille et je fais partie de la sienne. C’est le parrain de mon fils Baptiste. Être copain du président de l’UEFA, du meilleur numéro 10 du monde, il n’y a rien de plus facile. Être son ami, c’est être présent lorsqu’il a besoin d’affection.
Vous avez commencé la radio en Guyane durant votre service militaire.Le général de Gaulle avait décidé qu’aucun membre de sa famille n’obtienne de faveur durant le service militaire. Ils voulaient qu’on l’effectue comme tous les Français. J’ai choisi l’outre-mer pour voyager. En Guyane, on s’occupait bien de moi ! J’étais d’abord dans une compagnie de commandos, je construisais des ponts sur le fleuve Maroni, mais j’en ai plein le dos et je monte l’un des plus gros mensonges de ma vie. Je fais croire au colonel que je viens d’avoir le général de Gaulle au téléphone et qu’il a dit qu’il fallait me mettre dans un bureau, au calme. Le colonel m’a cru et deux jours après, j’étais muté comme secrétaire du capitaine, à ne rien branler. J’allais faire du ski nautique avec un zodiac, je jouais au foot. En Guyane, j’ai rencontré Jérôme Bellay, devenu mon patron ici et qui était à l’époque rédacteur en chef de FR3 Cayenne. Il m’avait déjà vu à la télévision : « Je n’ai pas le droit de te payer, mais tu vas aller commenter des matchs de football. » J’ai découvert la radio grâce à lui, puis j’ai demandé à être muté de la télévision à la radio alors que tout le monde souhaitait faire le chemin inverse. J’étais déjà un cas particulier, mais la radio m’excitait plus.
Vous dites que votre seul regret est de n’avoir jamais remercié le général de Gaulle.Un jour, il a envoyé une lettre à ma grand-mère : « J’ai vu votre petit-fils Jacques Philippe à la télévision un soir, c’est très bien ce qu’il fait, il faut l’encourager dans cette voie. » J’aurais voulu lui dire « mon oncle, c’est grâce à vous tout ça. Si mon père n’avait pas été le fils de votre beau-frère, tout cela ne serait sans doute jamais arrivé. » J’ai été sur sa tombe il y a une vingtaine d’années et je l’ai remercié.
Le 30 septembre dernier, votre fils Baptiste a commenté pour beIN Sports le match Amiens-Lille, rencontre durant laquelle une tribune s’est écroulée. Ça vous a renvoyé à la tragédie de Furiani ?J’ai passé l’une des pires soirées de ma vie. J’étais à l’antenne. Je vois ce qu’il se passe, c’est un symbole terrible. Forcément, je pense à Furiani. Je l’ai appelé tout de suite même si je savais qu’il n’avait rien. Je savais qu’il avait pensé à moi. Les deux drames n’ont rien à voir, mais psychologiquement… D’ailleurs, je n’ai jamais revu les images de Furiani.
Racontez-moi.On prend l’avion avec Thierry Roland et Jean-Michel Larqué.
J’arrive au stade, on va saluer Joël Quiniou, les joueurs de Bastia et ceux de l’OM. C’est une demi-finale de Coupe de France et il fait un soleil magnifique. Je monte dans la tribune, m’installe. À 20h27, on me dit de faire l’ouverture du journal et après, c’est la fin. Je me retrouve à l’hôpital, tombe dans le coma. Il fallait m’opérer des vertèbres, de la vessie, tout était pété. C’est un miracle si je suis en vie. Les sept mecs à droite, les sept mecs à gauche sont morts. Je me sens chanceux et privilégié.
Une leçon de foot-boulimiePropos recueillis par Flavien Bories